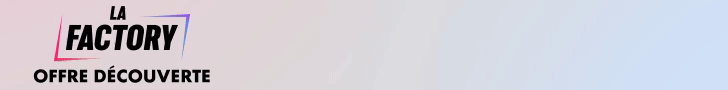La France dépense toujours plus pour sa santé, mais sans réel gain d’efficacité. Alors que la part publique recule, les ménages paient davantage pour un système à bout de souffle.
Une dépense publique record, mais un système inefficace
333 milliards d’euros (39 960 milliards de francs CFP) : c’est le montant vertigineux de la dépense courante de santé en France en 2024, selon le dernier rapport de la DREES.
Cela représente 11,4 % du PIB, un niveau supérieur à la moyenne européenne, mais sans amélioration notable de la qualité des soins ni de l’accès aux médecins.
La Consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) atteint 254,8 milliards d’euros (30 576 milliards de francs CFP), en hausse de 3,7 %. Les hôpitaux engloutissent près de la moitié de cette somme, avec un secteur public qui reste inférieur de 3,5 % à son niveau d’activité de 2019.
Autrement dit, on dépense plus pour produire moins.
Cette inflation des dépenses est alimentée par la hausse des tarifs, la multiplication des dispositifs médicaux et une bureaucratie sanitaire hypertrophiée, dont les coûts de gestion progressent de 4,9 % en un an.
L’administration de la santé pèse désormais presque autant que certains pans entiers de la production nationale.
Les ménages paient plus cher pour un service en recul
La part financée par la Sécurité sociale recule à 79,4 %, quand celle des organismes complémentaires grimpe à 12,8 % et celle des ménages à 7,8 %. En clair, les Français paient deux fois : par leurs cotisations et par leurs dépenses directes.
Le reste à charge moyen atteint 292 euros (35 040 francs CFP) par personne, en hausse de près de 6 % sur un an. Loin du « 100 % santé » promis, les franchises doublées et la baisse des remboursements dentaires illustrent la lente érosion du modèle solidaire.
Cette évolution traduit une désocialisation rampante du financement des soins : l’État se désengage, tandis que les mutuelles — financées par les ménages — absorbent de plus en plus la facture.
Pourtant, le niveau de remboursement public reste présenté comme un succès politique, alors qu’il masque une perte d’autonomie financière pour nombre de foyers modestes.
Une comparaison européenne flatteuse… mais trompeuse
La France reste parmi les trois pays européens qui dépensent le plus pour la santé, derrière l’Allemagne et l’Autriche. Mais cette performance budgétaire ne se traduit pas par une meilleure efficacité.
Le pays affiche un taux d’hospitalisation encore inférieur à celui d’avant-crise, une démographie médicale en berne et des délais d’attente record dans les urgences.
Les États-Unis dépensent davantage (17,2 % du PIB), mais la comparaison est biaisée : notre système se veut universel, or il ne parvient plus à assurer l’accès rapide et équitable aux soins.
En revanche, le reste à charge français (10,2 % de la DCSi) demeure l’un des plus faibles de l’Union — un indicateur trompeur quand on sait combien les impôts et cotisations masquent la véritable charge financière pesant sur les actifs.
Derrière ces chiffres flatteurs, le modèle de santé français vit à crédit. Sa croissance repose sur une dépense publique massive, un État-providence surendetté et une bureaucratie pléthorique. Pendant ce temps, les hôpitaux publics manquent de bras, les médecins désertent les campagnes, et les files d’attente s’allongent aux urgences.
Les comptes de la DREES mettent en lumière l’urgence d’une réforme structurelle : moins d’argent distribué, plus de responsabilité individuelle. L’État ne peut plus tout financer.
La France a besoin d’un modèle de santé durable, où la prévention, la liberté de choix et la transparence des coûts remplacent la dépendance aux transferts publics.
Tant que la dépense publique servira à entretenir un système administratif inefficace, chaque euro dépensé le sera au détriment des soins réels.
La question n’est plus de savoir combien la France consacre à sa santé, mais ce qu’elle en fait réellement.