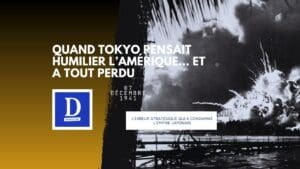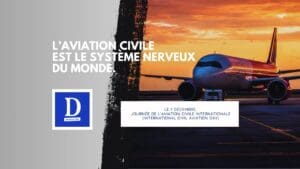Parler chiffres, c’est parler vérité. Et les chiffres de l’Insee le prouvent : la France, loin des fantasmes agités par certains, reste un pays où l’immigration est contenue — mais durable.
Une immigration stable mais structurelle
Selon l’Insee, 6,0 millions d’étrangers résident aujourd’hui en France, soit 8,8 % de la population nationale. C’est un chiffre qui, loin des caricatures, place notre pays sous la moyenne européenne (9,6 %). Mais cette stabilité apparente cache une réalité profonde : l’immigration est devenue une composante durable de la société française.
Sur ces 6 millions d’étrangers, 5,1 millions sont nés à l’étranger et sont donc également immigrés. Les 900 000 restants sont nés sur le sol français — pour la plupart des mineurs, appelés à devenir Français à leur majorité. Cette distinction entre étrangers et immigrés illustre une nuance souvent négligée dans le débat public : tout immigré n’est pas étranger, et inversement.
L’histoire démographique montre que la France a toujours été une terre d’accueil régulée. En 1921, elle comptait déjà 1,5 million d’étrangers. En un siècle, le chiffre a quadruplé, mais sans explosion ni submersion migratoire. Depuis les années 2000, les flux augmentent modérément (+3,2 % par an en moyenne), traduisant une immigration continue mais non massive, essentiellement liée au travail, à la famille et à l’éducation.
Une géographie migratoire en mutation
Les origines des étrangers installés en France ont profondément changé. En 1968, près de 75 % d’entre eux étaient européens, majoritairement espagnols, italiens ou portugais. Aujourd’hui, près de la moitié des étrangers viennent d’un pays africain et un tiers d’un pays européen. Le Maghreb demeure un pôle majeur, mais l’Afrique subsaharienne et l’Asie progressent fortement, notamment le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Chine et le Vietnam.
Cette diversification reflète les transformations économiques et géopolitiques des dernières décennies : crises africaines, mondialisation, ouverture des frontières européennes. Mais elle traduit aussi une évolution culturelle : la France attire moins ses voisins européens, déjà intégrés à l’espace Schengen, et davantage des populations plus éloignées, souvent issues d’aires culturelles moins francophones.
Ces mutations interrogent la cohésion nationale et le modèle d’intégration républicain. Si l’immigration européenne s’intégrait facilement par la langue et les valeurs communes, les flux récents posent des défis nouveaux : logement, emploi, école, transmission du français. Le creuset républicain fonctionne encore, mais il s’effrite lorsqu’il se heurte à des logiques communautaires ou religieuses importées.
Naturalisation : un processus sélectif et révélateur
Autre enseignement fort du rapport : un tiers des immigrés vivant en France sont désormais Français. Au total, 2,6 millions d’immigrés ont acquis la nationalité, souvent après plusieurs années de présence et d’efforts d’intégration. L’Insee note que la naturalisation est plus fréquente chez les immigrés d’Afrique (37 %) et d’Asie (35 %) que chez ceux d’Europe (28 %).
Mais la tendance s’oriente à la baisse depuis quinze ans. Depuis la fin des années 2000, le nombre annuel de naturalisations recule, conséquence directe du durcissement des critères administratifs : maîtrise du français, durée de résidence, casier judiciaire, stabilité professionnelle. Parallèlement, certains États — comme la Chine — interdisent la double nationalité, freinant la démarche de naturalisation.
Cette baisse n’est pas neutre : elle crée une zone grise entre intégration et précarité. Des personnes vivant depuis longtemps en France, parfois depuis leur enfance, restent étrangères, faute de pouvoir remplir toutes les conditions. Or, l’accès à la nationalité, c’est plus qu’un statut : c’est l’appartenance à une communauté de destin, la possibilité de participer pleinement à la vie démocratique.
La France, dans ce domaine, n’est ni laxiste ni fermée. Elle reste plus exigeante que la moyenne européenne, mais aussi plus équilibrée : une politique d’intégration fondée sur le mérite et l’attachement à la République, ni sur les quotas ni sur l’idéologie.
Derrière les statistiques, un enjeu politique majeur : comment concilier la fidélité à l’identité nationale avec le respect de la diversité ? L’Insee ne fait pas de politique, mais ses chiffres parlent : 8,8 % d’étrangers, une part maîtrisée, mais qui appelle vigilance et lucidité.
La France n’est pas envahie, mais elle change. Sa force réside dans sa capacité à assimiler sans se diluer, à transmettre sans renoncer. À condition que l’État tienne fermement les rênes, que la citoyenneté française demeure un aboutissement, pas un droit automatique, et que la République retrouve la fierté de dire qui elle est.
Car c’est bien là le fond du sujet : la France reste attractive parce qu’elle est la France. Une nation qui doit continuer d’accueillir, mais sans s’excuser d’exister.