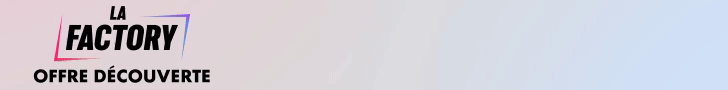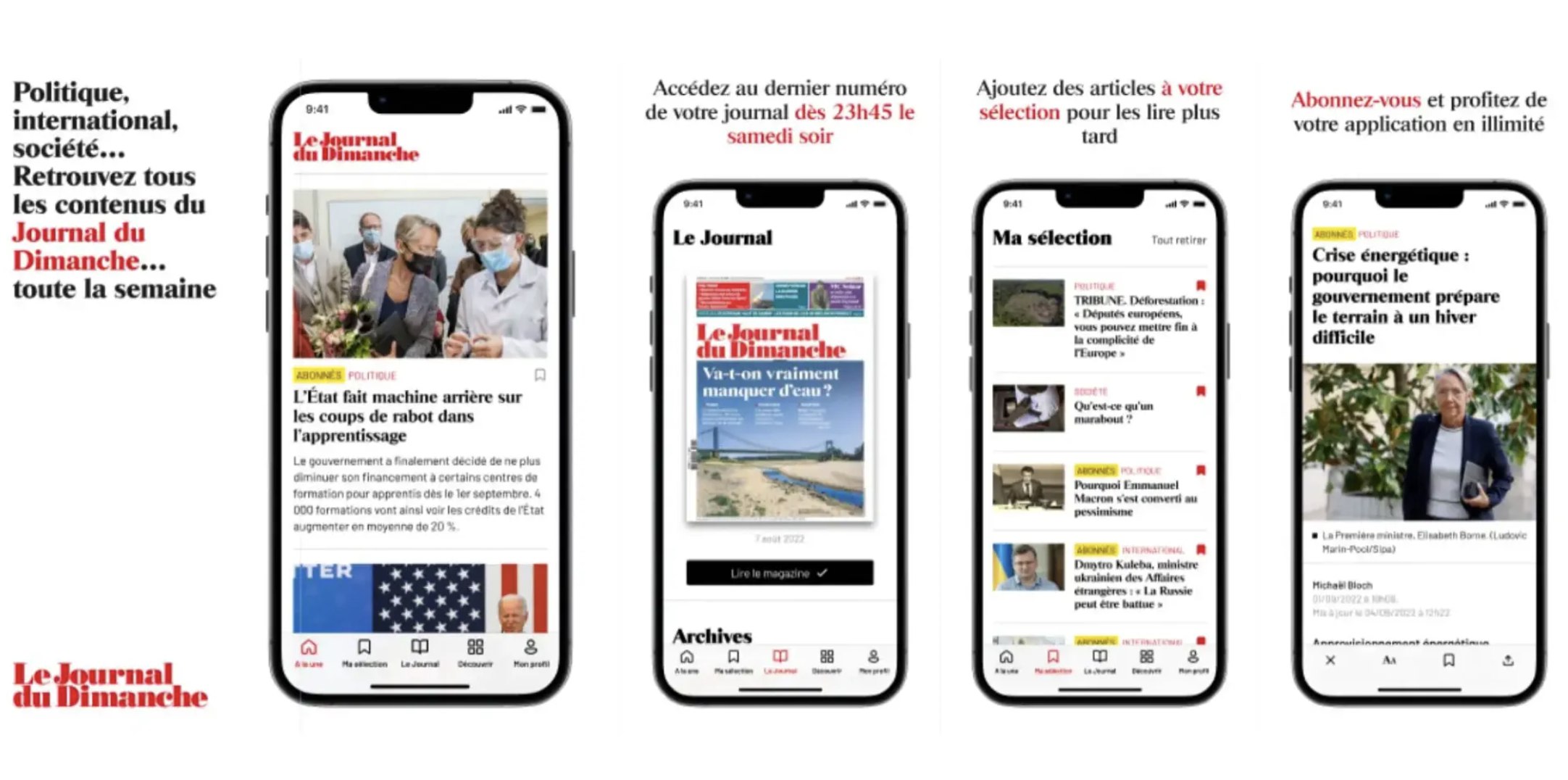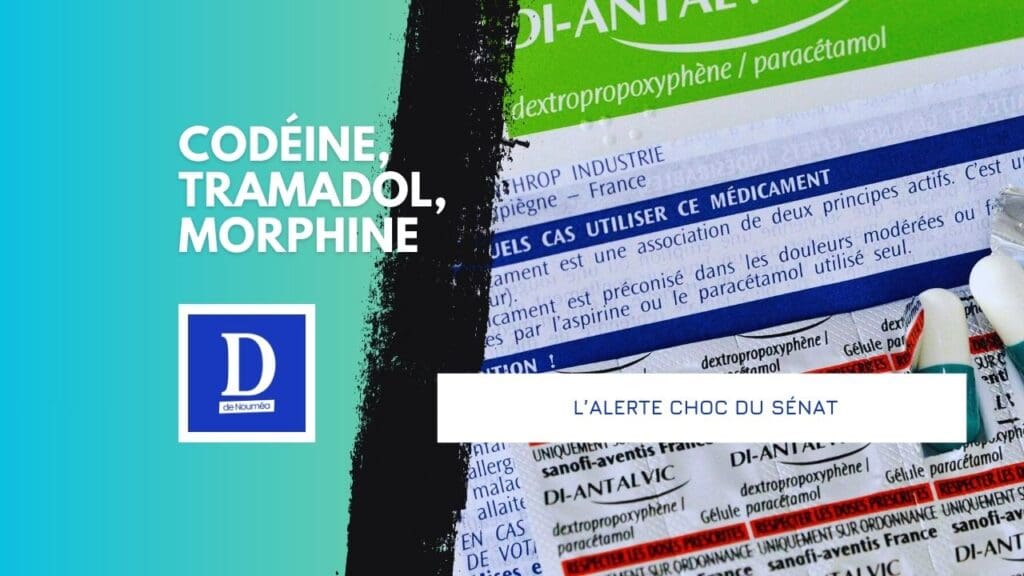Fille d’ouvriers immigrés, professeur agrégé de lettres classiques, enseignante en REP+ en banlieue durant plus de quinze ans, cofondatrice du collectif Vigilance Collèges Lycées, membre du Conseil des sages de la laïcité, Delphine Girard est en première ligne du combat citoyen contre l’islamisme et le communautarisme en milieu scolaire. Dans un livre personnel et engagé, elle appelle à un « sursaut national » pour sauver l’école, cinq ans après l’attentat contre Samuel Paty.
Le JDNews. Vous avez entamé votre carrière d’enseignante en 2004, une date symbolique qui correspond à l’interdiction du port des signes religieux à l’école. Comment le rapport au fait religieux a-t-il évolué dans les établissements scolaires ?
Delphine Girard. En 2004, lorsque j’ai commencé à enseigner, la polémique autour des signes religieux ostensibles à l’école se faisait déjà jour dans la société, mais elle n’avait pas encore pénétré les salles de classe. Il n’y avait pas encore de contestation de l’autorité du professeur ou de posture vindicative de la part des élèves. Le véritable tournant s’opère en 2015 avec l’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Quelque chose de confusément en germe chez les élèves s’est révélé à ce moment-là. L’émoi national suscité par cet attentat a été en réalité de courte durée, et l’anticharlisme a très vite pris le dessus. Depuis 2015, le message laïque et universaliste n’est plus majoritaire à l’école et la parole pédagogique est contestée, suspectée d’être une parole politique.
Mickaëlle Paty estime qu’« il n’y a eu ni réveil, ni sursaut » depuis la mort de son frère. « Nos ennemis ont encore gagné du terrain », ajoute-t-elle. Partagez-vous ce constat ?
Évidemment. Les islamistes ont gagné du terrain car le silence se fait toujours autour de l’assassinat de Samuel Paty, qui n’est plus commémoré que de manière larmoyante une fois par an. Le reste du temps, on fait comme si cela n’avait jamais existé. Il n’y a eu aucun sursaut national massif pour dire « non » à ceux qui tentent de museler l’école, pour soutenir sans réserve les enseignants qui continuent coûte que coûte de défendre la laïcité et la liberté d’expression. La culture de l’excuse et le « oui, mais… » instillés par une certaine gauche sont largement responsables de ce silence.
L’attentat contre Samuel Paty a montré que la laïcité était un principe mal compris par les élèves, mais aussi par certains enseignants, ce que vous montrez dans votre livre. Au sempiternel « pas-de-vaguisme » se sont ajoutées la lâcheté ou l’indifférence…
Certains enseignants craignent davantage l’anathème moral de l’extrême gauche que le couteau des islamistes. Cette gauche-là est extrêmement coupable car elle a choisi de placer la laïcité dans le camp des « méchants ». L’argumentaire qui voudrait nous faire croire qu’un professeur est « islamophobe » s’il fait un cours sur les caricatures de Mahomet, cette idée que la laïcité est « raciste » car dirigée spécifiquement contre les croyants musulmans, participent d’un climat général de toxicité à l’école. Un enseignant a désormais intérêt à être bien armé intellectuellement s’il veut se défendre face à ces accusations sournoises.
Un sondage de l’Ifop* montre que la moitié des 18-30 ans se déclarent favorables au fait d’autoriser le port de signes religieux ostensibles dans les collèges et lycées, une perspective à laquelle s’opposent pourtant trois quarts des Français. Comment expliquez-vous cette fracture générationnelle sur la question de la laïcité ?
La fracture se fait sur la notion de « respect ». Aux yeux de nos jeunes élèves, le respect est une vertu du silence. C’est l’idée qu’on ne débat pas de choses qui peuvent choquer. En juin dernier, dans le cadre d’un cours, j’ai par exemple présenté à mes élèves une caricature de la dessinatrice de Charlie Hebdo Coco, qui présentait Gisèle Pelicot en train d’écraser de ses talons le sexe de ses violeurs. Certains élèves se sont récriés, affirmant que ce dessin était « honteux ». En l’occurrence, la caricature n’avait aucune connotation religieuse !
« La cohabitation pacifique de toutes les populations entre elles, sur le modèle anglo-saxon, ça ne marche pas »
L’idée d’aborder un sujet grave et choquant avec un regard satirique leur était insupportable. Cela va donc au-delà du seul fait religieux, c’est un rapport à la notion plus large de « respect », ironiquement devenue sacro-sainte. J’y vois l’influence de la culture anglo-saxonne, qui a importé une forme de puritanisme dans notre pays. La tradition voltairienne du débat et de la controverse est aujourd’hui malmenée par les plus jeunes générations.
Quel regard portez-vous sur la montée de la violence extrême en milieu scolaire, qui s’exprime parfois de manière totalement gratuite ?
La plupart des affaires récentes possèdent un arrière-fond d’orthopraxie religieuse ou de tensions communautaires, comme on l’a vu avec l’agression de Samara en avril 2024 à Montpellier [passée à tabac à la sortie de son collège par trois élèves de son établissement, elle a été gravement blessée et plongée dans le coma, NDLR]. Cela pour une raison simple : plus le communautarisme fait recette dans la jeunesse, plus la fraternité et la concorde nationale sont menacées. On voit bien que le multiculturalisme et la cohabitation pacifique de toutes les populations entre elles, sur le modèle anglo-saxon, ça ne marche pas. Dès lors que la loi du clan prime la loi nationale, il n’y a plus de commun partagé et la violence s’exprime sous sa forme la plus brutale.
Vous appelez à faire de la laïcité « une grande cause nationale ». La classe politique est-elle à la hauteur de l’enjeu, selon vous ? N’est-il pas trop tard ?
Il n’est malheureusement pas exclu que l’on connaisse de nouveaux drames à l’école dans les prochaines années. S’il n’est jamais trop tard, je n’ai pas le sentiment que les gouvernements qui se sont succédé ces derniers mois aient pris la mesure de la gravité de la situation. Nous avons droit à de belles envolées lyriques sur les « valeurs de la République » et la nécessité de protéger la laïcité, mais cela ne donne lieu à aucune transcription concrète en matière de volonté politique. La volonté politique est pourtant parfois très efficace, ainsi que nous l’avons vu lorsque Gabriel Attal [alors ministre de l’Éducation nationale, NDLR] a décidé du jour au lendemain d’interdire le port de l’abaya en milieu scolaire, sans que cela provoque d’incidents majeurs. La parole de l’exécutif doit être très ferme et claire sur les questions liées à la laïcité. On ne résoudra pas le problème avec des minutes de silence.
Télécharger l’application Le Journal du Dimanche pour iPhone, iPad ou Android