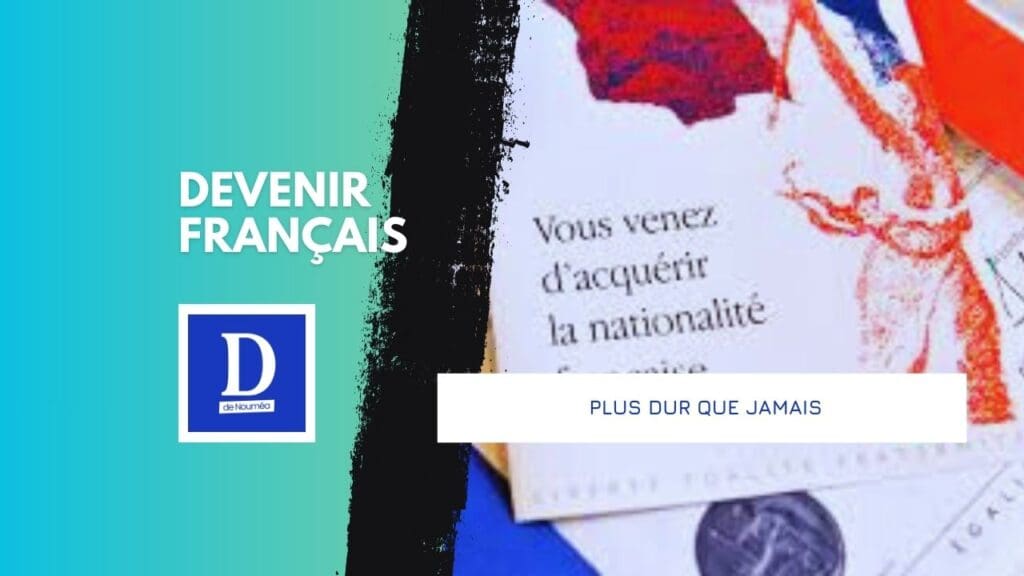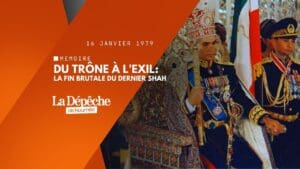Les écrans ont colonisé les chambres et les cerveaux de nos enfants. Santé publique France tire la sonnette d’alarme : dès 3 ans, la dépendance numérique s’installe.
Une génération branchée, déconnectée du réel
En 2022, les enfants de 3 à 11 ans passaient en moyenne 1 h 22 d’écrans par jour en maternelle, 1 h 53 en primaire et 2 h 33 pour les plus âgés. Des chiffres vertigineux, qui doublent les jours sans école.
Derrière ces données froides, une réalité sociale : l’enfance française glisse lentement vers la passivité numérique, entre télévision, consoles et smartphones.
La télévision reste reine, représentant jusqu’à 70 % du temps d’écran chez les plus petits. Mais dès 9 ans, le smartphone prend le relais : près de 25 % des élèves de CM2 possèdent déjà leur téléphone personnel, souvent avec accès aux réseaux sociaux, pourtant interdits avant 13 ans.
Les garçons s’enferment dans les jeux vidéo, les filles se réfugient dans les smartphones. Deux dérives, une même fracture : celle d’une enfance qui s’éloigne du monde réel.
Les parents démissionnent, l’État observe
Neuf parents sur dix affirment limiter le temps d’écran de leurs enfants, mais seulement la moitié surveille les contenus. En clair : la quantité inquiète, la qualité échappe. Les chiffres de Santé publique France révèlent un fossé criant : 52 % des parents d’enfants de 3 à 5 ans filtrent les contenus, contre seulement 36 % après 9 ans.
Une érosion du contrôle parental, précisément au moment où les risques explosent : insultes en ligne, moqueries, images inadaptées.
Les réseaux sociaux s’invitent de plus en plus tôt : 7 % des enfants de 6 à 8 ans y ont déjà accès, 25 % dès 9 ans. Des usages hors de tout cadre légal. Pendant ce temps, les pouvoirs publics se contentent de plans d’affichage, comme le site Je protège mon enfant, sans moyens coercitifs réels.
Aucune sanction, aucune vérification technique : la régulation repose sur la bonne volonté.
Résultat : une enfance surexposée, sous surveillance minimale.
Sous l’écran, la fracture sociale et éducative
L’étude Enabee met en évidence une fracture sociale et éducative profonde : plus le niveau de diplôme et les revenus des parents sont faibles, plus le temps d’exposition des enfants aux écrans augmente. Dans les foyers modestes, souvent contraints par le manque de temps ou d’espace, les écrans remplacent la présence parentale et deviennent une solution de facilité, au détriment de la lecture, du jeu ou du sport.
Cette surconsommation numérique n’est pas sans conséquences : elle altère la santé mentale, la concentration et la créativité des plus jeunes, tout en accentuant les inégalités culturelles. À force de promouvoir le tout-numérique, la société française prépare une génération dépendante à la stimulation instantanée, où le confort technologique supplante l’effort et la réflexion, un glissement inquiétant pour une République fondée sur l’éducation et la raison.
La solution ne viendra ni des plateformes ni des écrans connectés « responsables ».
Elle passera par un retour à l’autorité parentale, au bon sens et à la transmission.
Car protéger l’enfance, ce n’est pas interdire le progrès : c’est rappeler les limites, celles qui font grandir.