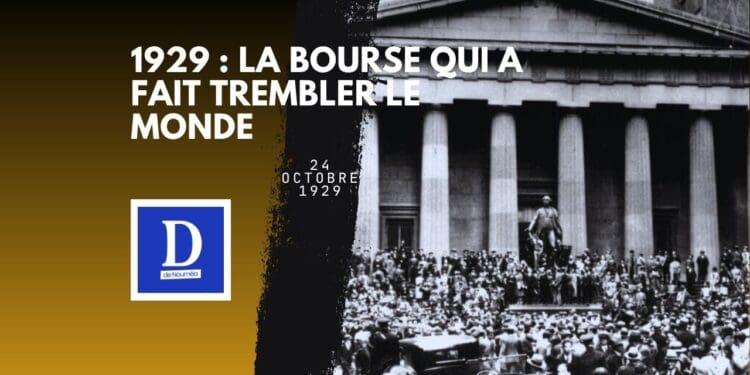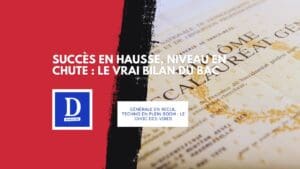Ils croyaient à l’éternelle prospérité américaine. En un jour, le rêve capitaliste vacilla.
Le 24 octobre 1929, Wall Street bascule dans la panique, marquant le début d’un séisme économique mondial.
L’illusion d’une richesse infinie
En 1929, les États-Unis sont la vitrine éclatante du progrès industriel. Les « Roaring Twenties » symbolisent l’ivresse d’une société qui croit au miracle permanent : travail à la chaîne, salaires en hausse, consommation à outrance. Henry Ford et le taylorisme incarnent la promesse d’une prospérité populaire issue de la productivité.
Mais derrière l’euphorie, la spéculation gangrène le système. Les classes moyennes s’endettent pour acheter des actions. On emprunte pour miser, on mise pour s’enrichir jusqu’à l’absurde. Quand l’économiste Irving Fisher proclame dans le New York Times que « le cours des actions est encore trop bas », le marché est déjà au bord du gouffre.
Le jeudi 24 octobre 1929, tout s’effondre. En quelques heures, 2,6 millions d’actions changent de main, pour près de quatre milliards de dollars de l’époque. Les banques tentent d’enrayer la chute, sans succès. En cinq jours, les cours s’effondrent de 30 %, et le cauchemar se confirme, le 29 octobre. Le capitalisme américain entre en crise, entraînant avec lui la confiance du monde libre.
L’Amérique, géant fragile d’un monde débiteur
L’origine du drame se niche dans l’après-guerre. Sortis riches de 14-18, les États-Unis dominent une Europe exsangue. Prêteurs, fournisseurs et maîtres du jeu monétaire, ils imposent leur puissance. Mais le protectionnisme américain, rétabli par la loi Fordney-McCumber en 1922, fragilise leur propre machine économique : les produits étrangers deviennent trop chers, la concurrence disparaît, et la spéculation devient le moteur artificiel de la croissance.
En 1925, Winston Churchill, alors chancelier de l’Échiquier, tente en vain de restaurer la grandeur monétaire britannique en rétablissant le Gold Standard. Résultat : une livre surévaluée, des exportations asphyxiées et un afflux de capitaux vers Wall Street. L’argent du monde entier afflue vers New York, gonflant la bulle jusqu’à l’explosion.
Ce déséquilibre colossal, né d’une économie sans garde-fou, révèle le talon d’Achille du libéralisme sans régulation : quand la confiance s’effondre, tout l’édifice vacille.
Le monde libre à genoux
De 1929 à 1932, les cours boursiers chutent de 87 %, des millions d’Américains perdent leur emploi et leur logement. Le chômage explose à 24 %, la production industrielle est divisée par deux.
Les banques ferment les unes après les autres, les files de miséreux s’allongent. L’Amérique découvre brutalement le prix du désordre financier.
L’Europe est frappée à son tour : les banques américaines réclament le remboursement des prêts accordés pour la reconstruction. L’Allemagne s’enfonce dans le désespoir économique, terreau idéal pour les extrêmes. Seule la France, prudente et moins financiarisée, résiste un temps avant d’être emportée à son tour.
Cette Grande Dépression n’est pas seulement une crise économique. Elle signe la fin d’une illusion : celle d’un monde capable de prospérer sans discipline, sans rigueur, sans nation forte. C’est aussi, dans le chaos des années 1930, le point de départ des fractures politiques qui mèneront à la Seconde Guerre mondiale.
Au-delà du drame financier, le krach de 1929 rappelle une vérité intemporelle : aucune économie ne survit sans ordre, sans autorité et sans responsabilité. L’avidité d’une élite spéculative a précipité des millions d’hommes dans la misère. Le rêve américain, fondé sur la liberté et le travail, s’est dévoyé dans la cupidité et l’excès.
Mais c’est aussi la résilience du modèle capitaliste régulé qui permettra à l’Amérique de se relever. Le New Deal de Roosevelt, en rétablissant le contrôle de l’État sur les banques et les marchés, sauvera la démocratie économique là où d’autres nations, comme l’Allemagne ou l’Italie, sombreront dans la dictature.
Le “Jeudi noir” demeure un avertissement : la liberté économique exige la morale et la mesure. Sans elles, même la plus grande des nations vacille.