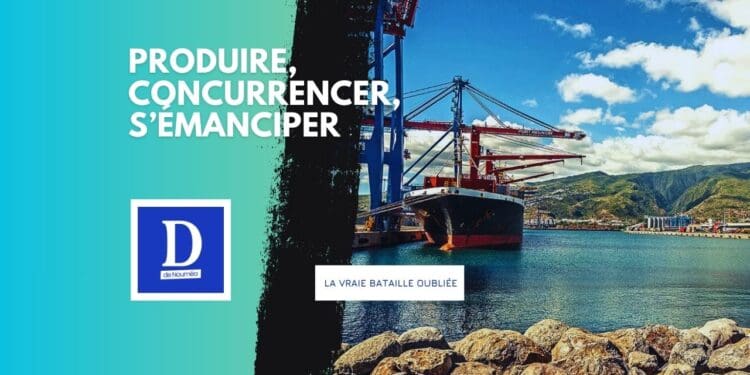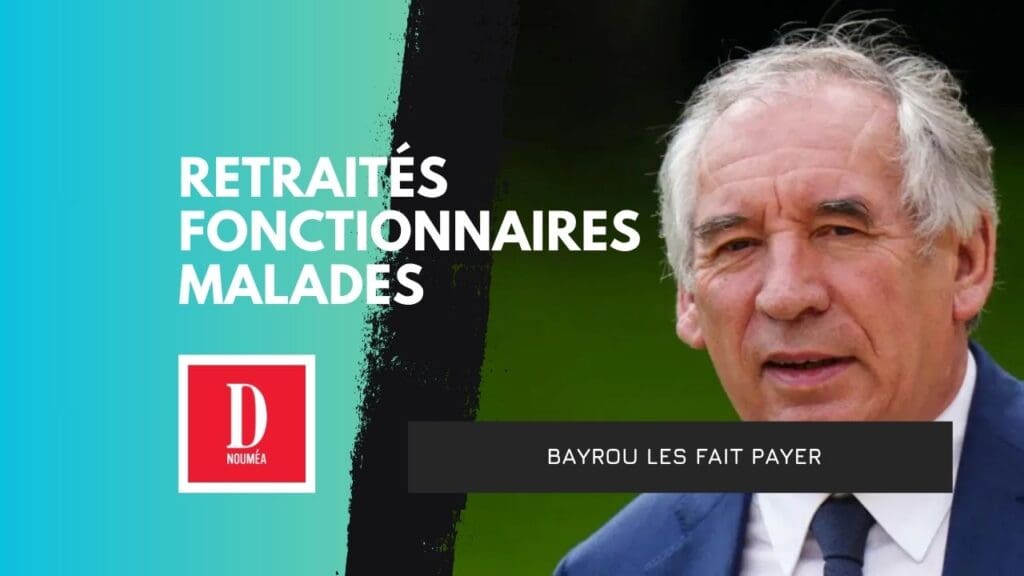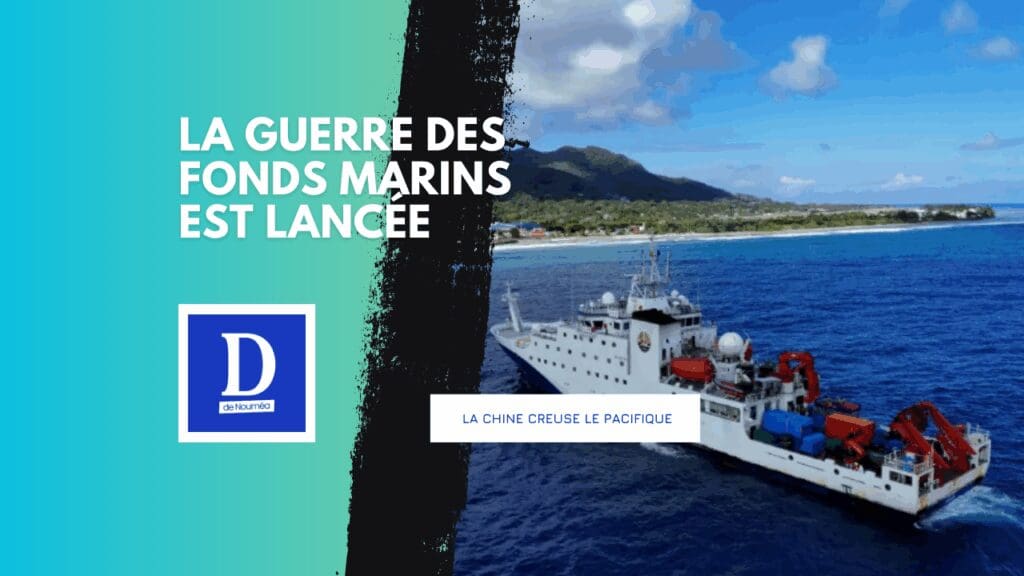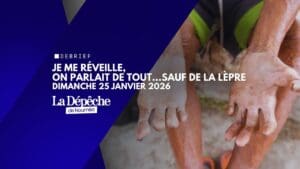Ils n’en peuvent plus de payer plus cher pour vivre moins bien. Face à l’explosion du coût de la vie dans les outre-mer, le gouvernement promet une “grande loi”. Mais derrière les slogans, le vide politique s’installe.
Voilà ce qui ressort du rapport du Sénat sur le projet de loi de lutte contre la vie chère dans les outre-mer.
Un mal français : les territoires ultramarins paient le prix fort
C’est une urgence nationale que le Premier ministre qualifie lui-même “d’urgence des urgences” : la vie chère dans les outre-mer n’est pas une lubie militante, mais une réalité économique et sociale brutale.
Les prix y sont jusqu’à 40 % plus élevés qu’en métropole, pour des revenus souvent inférieurs et une pauvreté deux à trois fois plus marquée.
Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane : les crises sociales s’y succèdent, les gouvernements changent, mais la facture reste la même.
Derrière cette flambée des prix, tout un système : importations massives, dépendance aux flux maritimes, oligopoles de la grande distribution et microéconomie étouffée.
Les PME locales, pourtant courageuses, peinent à rivaliser avec des franchises hexagonales puissantes qui dictent les marges et captent les marchés.
Résultat : chaque produit, du yaourt au bidon d’essence, est frappé par une cascade d’intermédiaires.
Et c’est le consommateur ultramarin qui paie la note.
Le Sénat le reconnaît : après quinze ans de “lois de rattrapage” Lodéom, Lurel, Érom, rien n’a vraiment changé. La France a multiplié les textes, mais sans vision économique claire.
Car la vérité, c’est que l’outre-mer vit sous perfusion d’aides et de lois, sans jamais retrouver la liberté de produire, de commercer et de grandir à armes égales.
Une réforme au rabais : l’État promet, les prix flambent
Le projet de loi présenté en juillet 2025 devait être le “tournant social” de la législature. Mais à la lecture du texte, difficile de trouver une mesure à la hauteur. Les articles se succèdent sans cap ni cohérence : quelques amendements ici, un “bouclier qualité-prix” là, des “E-Hubs logistiques” expérimentaux, et beaucoup de déclarations d’intention.
Le seuil de revente à perte ? Supprimé, car il favorisait les géants de la distribution au détriment des commerces de proximité. Le bouclier qualité-prix ? Étendu aux services, mais sans mécanisme de contrôle efficace. Le mécanisme de péréquation des frais d’approche ? Renvoyé à plus tard, “dans une ordonnance à définir”. Tout est flou, rien n’est structurant.
Plus grave encore, le texte oublie les revenus du travail, le soutien aux entreprises locales et la coopération régionale, pourtant cruciale pour sortir de la dépendance. On ne parle ni d’emploi, ni de production, ni de souveraineté économique. L’État administre, mais ne reconstruit pas.
Derrière la rhétorique sociale, c’est un aveu d’impuissance : Paris continue de gérer l’outre-mer à distance, sans s’attaquer aux racines du mal. Une loi de plus, sans lendemain.
Produire, concurrencer, s’émanciper : la vraie bataille oubliée
Le seul axe positif du texte, la transparence des marges et le renforcement de la concurrence, sonne comme une tentative de reprendre la main. La DGCCRF pourra désormais exiger les chiffres réels des grandes enseignes et sanctionner leurs abus.
Une avancée, certes, mais encore faut-il que les contrôles suivent et que les amendes tombent.
L’ouverture à la concurrence reste, elle aussi, timide. L’ajout de deux experts “outre-mer” à l’Autorité de la concurrence ne suffira pas à briser les situations oligopolistiques installées depuis des décennies.
Quant au soutien au tissu économique local, il se limite à des réservations de marchés publics pour les microentreprises, à hauteur de 20 %. Une mesure symbolique, pas une révolution.
La vraie réforme aurait consisté à libérer les forces productives locales, à favoriser les circuits courts et à baisser les charges des TPE ultramarines pour qu’elles puissent rivaliser avec les importateurs.
Mais cette France-là, celle du travail, de la production et de la dignité économique, semble avoir disparu des priorités gouvernementales.
Pendant que l’Hexagone débat du pouvoir d’achat, les Français d’outre-mer paient deux fois plus pour vivre moitié moins bien. Et ce n’est pas une fatalité géographique, mais une défaillance politique.
La France a les moyens d’assurer à ses territoires une véritable égalité économique, mais elle choisit la rustine législative plutôt que la refondation.
Derrière ce projet de loi tiède, c’est toute la question de la souveraineté économique ultramarine qui se joue.
Car la vie chère n’est pas qu’une question de prix : c’est un symbole d’abandon.
À force de croire que l’assistanat compensera l’enclavement, la République risque de perdre plus qu’un débat budgétaire : elle risque de perdre la confiance de ses outre-mer.