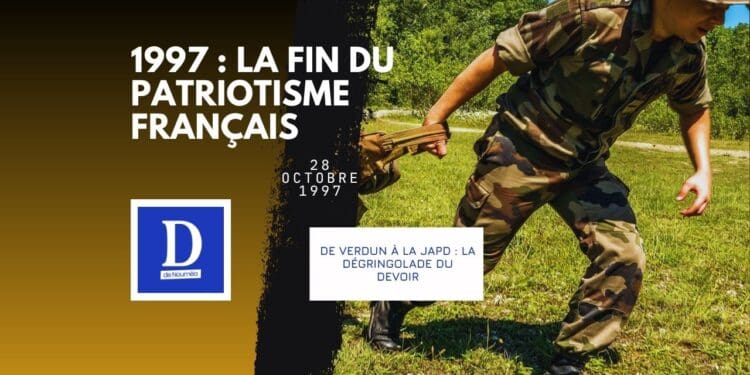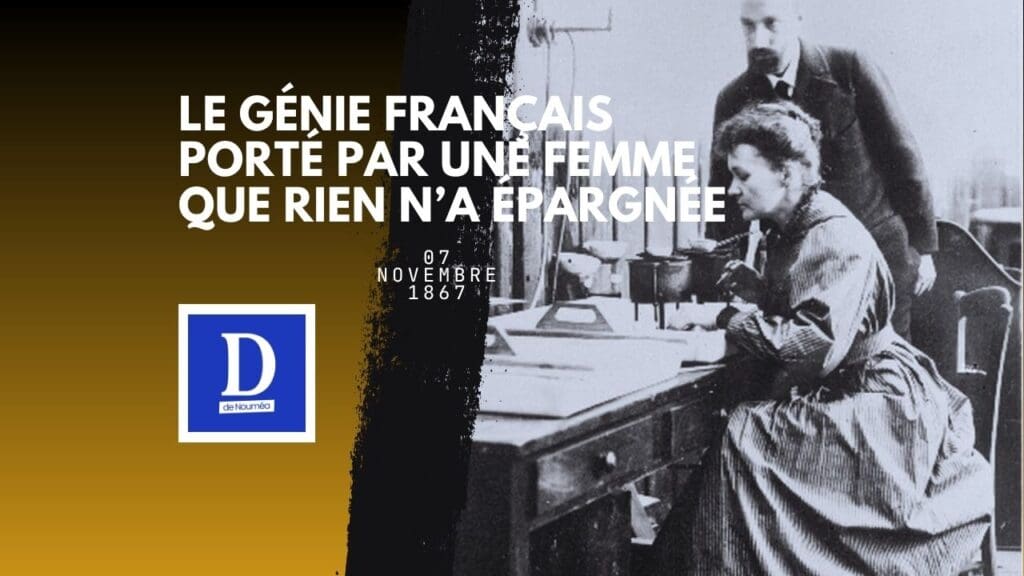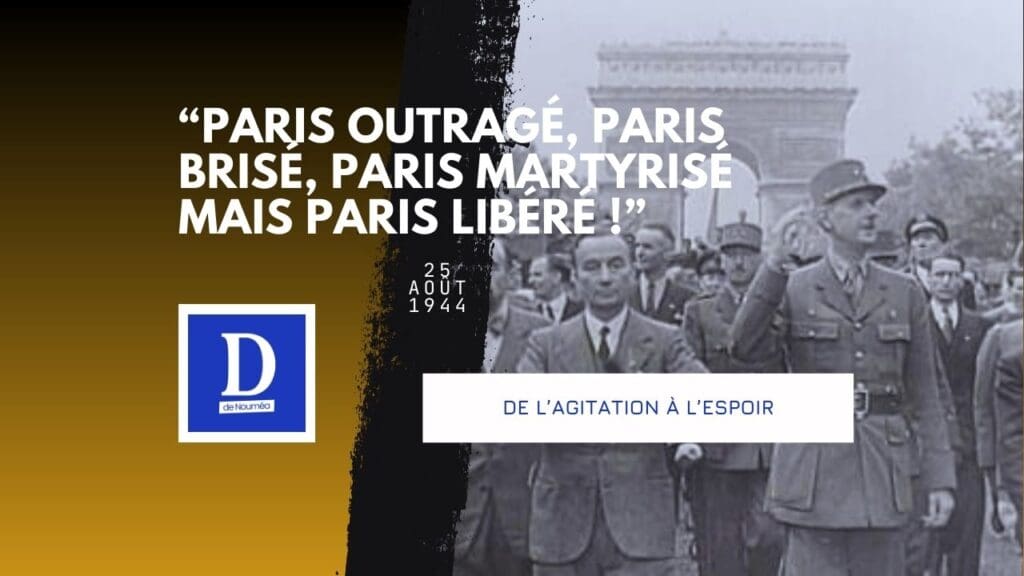Le 28 octobre 1997, la France tourne la page d’un pan entier de son histoire républicaine. En suspendant le service militaire, Jacques Chirac met fin à un rite d’intégration nationale vieux de deux siècles.
Un monument républicain sacrifié sur l’autel du modernisme
C’est au détour d’une allocution télévisée, le 28 mai 1996, que Jacques Chirac annonce la fin du service militaire obligatoire. En pleine euphorie post-guerre froide, la France croit à la paix éternelle et s’aligne sur ses voisins européens : armées professionnelles, économies budgétaires et illusion d’un monde sans conflit. Le chef de l’État veut moderniser l’armée, alléger la dépense publique et préparer l’entrée dans l’euro. Mais derrière la « suspension » de la conscription, c’est bien une rupture symbolique qui s’opère : celle d’un lien direct entre les citoyens et la défense de leur patrie.
Institué en 1798 par la loi Jourdan, le service militaire fut plus qu’un devoir : un ciment national. Dans les tranchées de Verdun ou les camps d’Algérie, les jeunes Français apprenaient à se reconnaître, à partager un même destin. En abolissant cette institution, la France renonçait à un puissant vecteur d’unité. Et si la décision fut applaudie par les éditorialistes, l’histoire en offrira une lecture plus nuancée : celle d’une désaffection nationale face à la défense du pays.
Une réforme économique avant tout, pas une vision d’État
Chirac ne s’en cache pas : il faut « faire des économies ». La fin de la guerre froide impose une réduction des budgets militaires. Charles Millon, ministre de la Défense, mène une étude et conclut que le service national coûte trop cher, qu’il est inadapté aux conflits modernes et qu’il n’assure plus le « brassage social » vanté depuis un siècle.
Le service civique obligatoire évoqué un temps, sera vite oublié. À la place, une Journée d’appel à la défense (JAPD) symbolique.
L’armée, elle, reste disciplinée. Les casernes ferment, les villes moyennes pleurent leurs régiments. Chirac promet une armée de métier de 350 000 hommes, capable de se projeter à l’étranger. Aujourd’hui, la France n’en compte plus qu’environ 250 000. Une réalité cruelle : la professionnalisation n’a pas tenu ses promesses. Le pays se découvre vulnérable, dépendant, et déconnecté de la notion même de devoir militaire.
Cette réforme, applaudit-on alors comme « libératrice » pour les jeunes, s’avère surtout une mutation idéologique : la priorité n’est plus la défense de la Nation, mais la rationalisation comptable. Le citoyen-soldat laisse place au contribuable désengagé.
La cohésion nationale en question, un quart de siècle plus tard
Les années passent, les crises s’accumulent. Attentats de 2015, guerre en Ukraine, tensions internationales : l’illusion de la paix perpétuelle s’effondre. La France redécouvre les limites d’une société sans devoir commun.
La suppression du service militaire a laissé un vide : celui de l’appartenance, du civisme, de la fraternité vécue dans l’effort collectif. Même Emmanuel Macron, héritier d’un autre monde, reconnaît la nécessité de retisser ce lien. En 2018, il relance l’idée d’un service national universel, version édulcorée d’un devoir oublié.
Car au fond, le service militaire n’était pas qu’une contrainte : c’était une école de la République. On y apprenait la discipline, la hiérarchie, l’amour du drapeau et la conscience du pays. Depuis sa disparition, la France a vu s’éroder ces repères communs au profit d’un individualisme désarmé.
Aujourd’hui, face aux menaces extérieures comme aux fractures intérieures, nombreux sont ceux qui regrettent que Chirac ait désarmé la Nation de l’intérieur.
En suspendant le service militaire obligatoire, Jacques Chirac pensait préparer l’avenir. Il a peut-être, sans le vouloir, affaibli l’esprit français. Une France forte ne se construit pas sur le confort, mais sur l’effort partagé. Et dans un monde redevenu dangereux, la question n’est plus de savoir pourquoi on a supprimé la conscription, mais quand il faudra la réinventer.