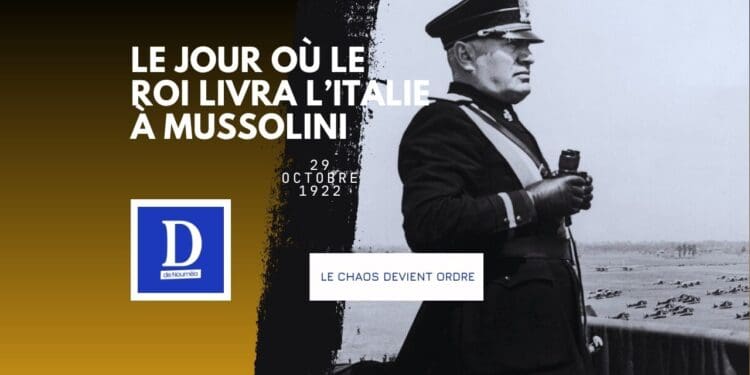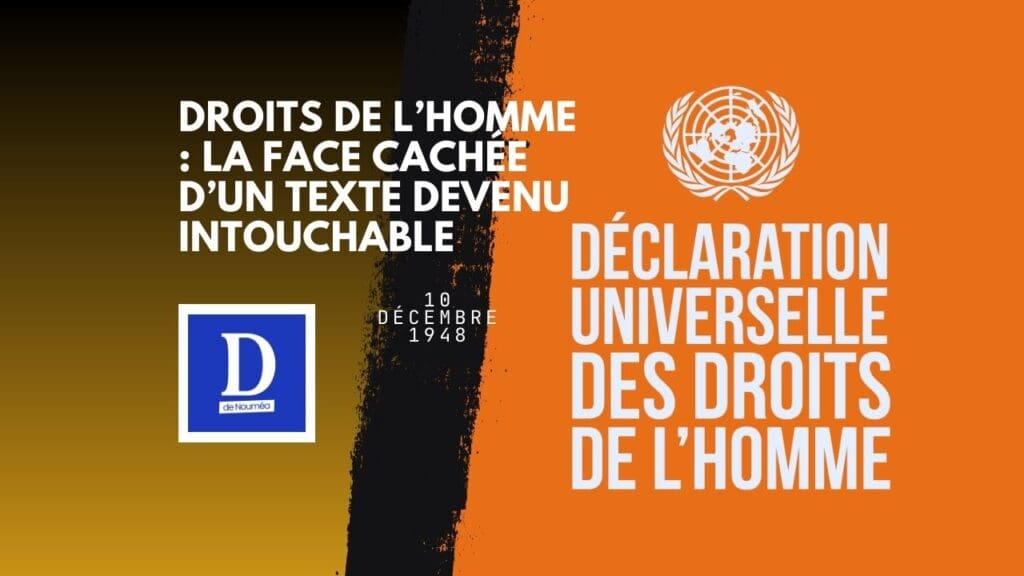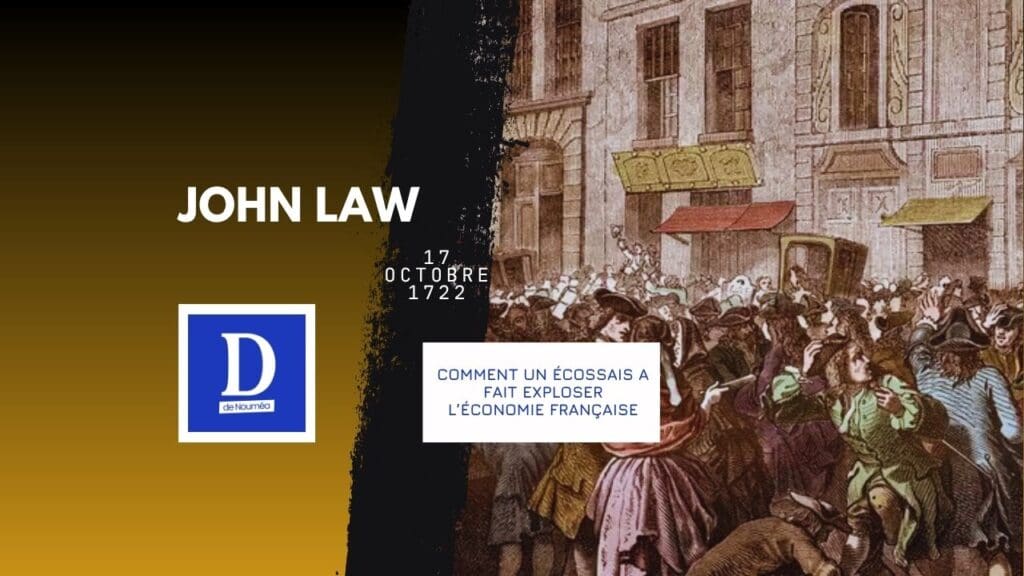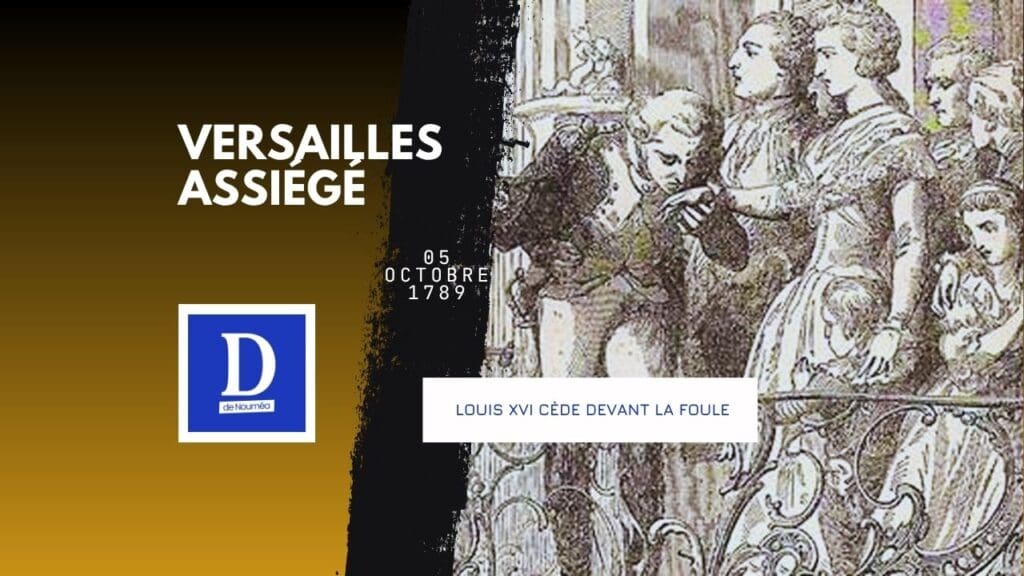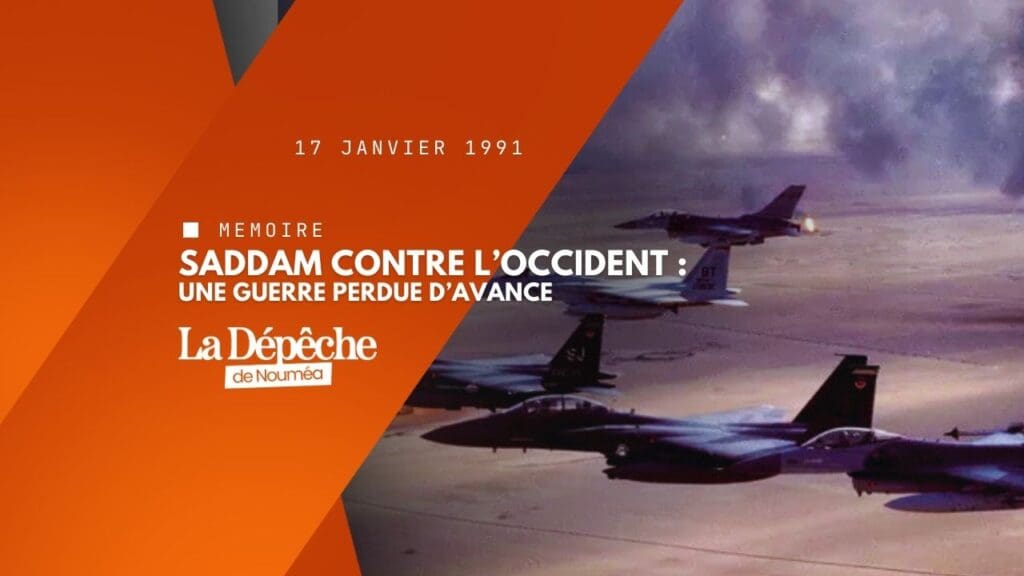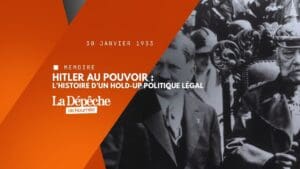Une marche sur Rome, un roi hésitant, un Duce triomphant. L’Italie bascule, en ce 29 octobre 1922, dans une ère où l’autorité remplace le chaos.
Quand Mussolini impose l’ordre à une Italie déboussolée
Mussolini, ancien socialiste converti au nationalisme, n’est plus un agitateur marginal.
En 1919, il fonde les Faisceaux italiens de combat, troupes paramilitaires qui se réclament de la force et du patriotisme.
Ces « Chemises noires », figures de la violence politique des années 1920, s’érigent en défenseurs de l’ordre face à la menace bolchevique.
Bastonnades, purges à l’huile de ricin, affrontements dans les rues : la brutalité fasciste devient un outil de réaffirmation de l’autorité dans un pays en crise.
Face à la peur du désordre, une partie de la bourgeoisie et du patronat italiens ferme les yeux.
L’État, paralysé, hésite entre répression et tolérance.
En mai 1921, Mussolini entre à la Chambre des députés avec trente-quatre élus.
Il se place à l’extrême droite, revendiquant haut et fort son rejet de l’internationalisme et son attachement à la nation.
Le coup de force de Naples et la marche sur Rome
L’été 1922 consacre le tournant. Après avoir brisé une grève générale socialiste, Mussolini prépare sa démonstration de force.
Le 27 octobre, il réunit à Naples des dizaines de milliers de miliciens et met en scène une marche sur Rome.
En réalité, le futur Duce observe les événements depuis Milan, laissant ses troupes avancer sans lui.
Mais le symbole est puissant : le pouvoir paraît vaciller, les Chemises noires se montrent prêtes à prendre la capitale.
Le roi Victor-Emmanuel III, craignant une guerre civile, refuse de proclamer l’état de siège.
Son hésitation scelle le destin du royaume.
Le 29 octobre, il convoque Mussolini et lui confie la présidence du Conseil.
À trente-neuf ans, celui qui n’a pas encore montré son visage à Rome devient le plus jeune chef de gouvernement d’Europe : un coup de génie politique plus qu’une véritable révolution armée.
Du gouvernement d’union à la dictature fasciste
Le nouveau président du Conseil forme une coalition mêlant libéraux, nationalistes et catholiques.
Officiellement, il promet le retour à l’ordre et à la stabilité.
Mais très vite, les milices fascistes, désormais encadrées par l’État, instaurent un climat de peur.
La presse est muselée, les opposants harcelés, les institutions verrouillées.
En novembre 1921, Mussolini avait déjà donné une forme légale à son mouvement en créant le Parti national fasciste, première formation ouvertement antidémocratique en Europe de l’Ouest.
En 1922, avec plus de sept cent mille adhérents, le parti ne gagne pas encore les élections, mais il a gagné la rue.
Le 31 octobre, les Chemises noires défilent dans Rome.
La monarchie, réduite à l’impuissance, entérine la victoire du fascisme.
Le peuple, fatigué des grèves et des divisions, accueille le Duce comme un sauveur.
Sous couvert d’unité nationale, Mussolini installe un régime totalitaire d’un genre nouveau, où la force prime sur le débat et la nation sur la liberté.
L’homme qui prétendait rétablir la grandeur italienne plonge son pays dans vingt et une années de dictature.
L’alliance entre le trône et le fascisme scelle le destin de l’Italie jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
Mais au cœur du tumulte de 1922, une idée s’impose : pour nombre d’Italiens, le Duce symbolise la revanche du pays humilié, la reconquête d’une fierté perdue depuis 1918.
Une illusion nationale qui finira, en 1943, dans les ruines d’une Italie brisée.