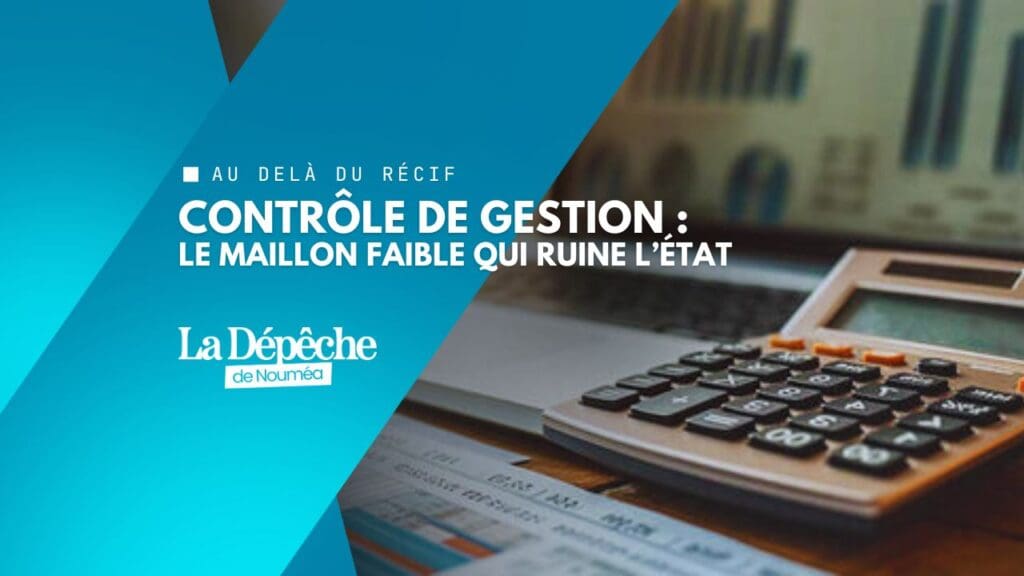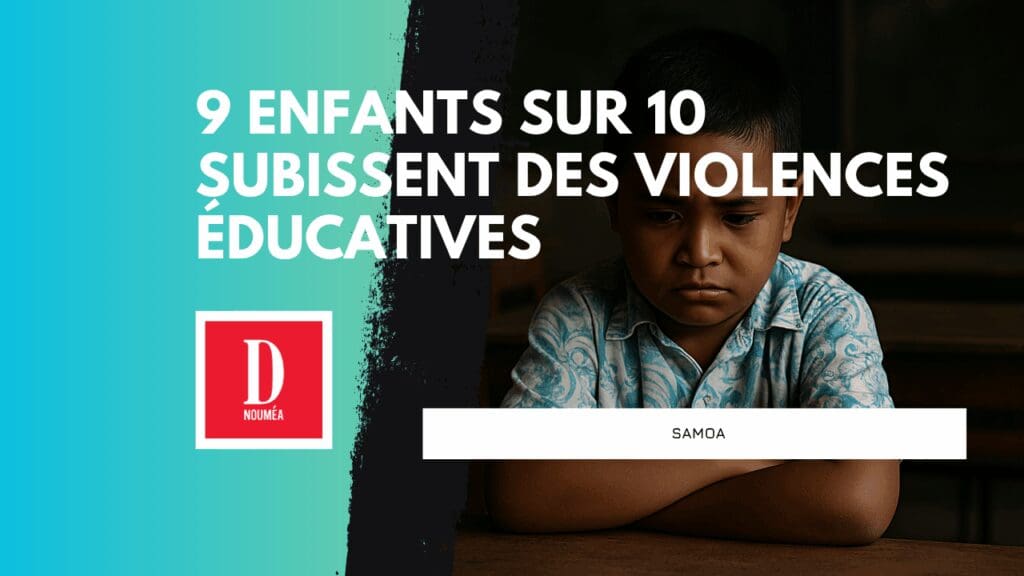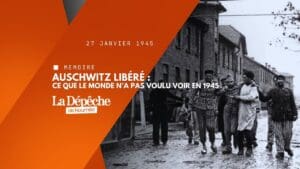La planète est à un tournant : pour la première fois, une analyse publiée par la United Nations Framework Convention on Climate Change (CCNUCC ou UNFCCC) indique que les émissions mondiales pourraient commencer à baisser si les États soumettant leurs plans les appliquent.
Mais ne vous y méprenez pas : ce scénario reste fragile, dépendant de la mise en œuvre réelle et les grands pollueurs manquent encore à l’appel.
Un bilan inédit mais limité
La CCNUCC vient de publier une synthèse des nouvelles contributions déterminées au niveau national (NDC) soumises récemment par 64 pays.
Selon cette étude, le scénario « soumission + mise en œuvre » de ces 64 pays pourrait conduire à une baisse des émissions mondiales de 11 % à 24 % par rapport à 2019, et la courbe moyenne de ce groupe pourrait atteindre son pic dans les cinq prochaines années, avec une baisse plausible jusqu’en 2035.
Cette estimation n’est pas tirée de l’un des rapports publics classiques. L’édition 2024 de la synthèse NDC de l’UNFCCC indique qu’avec les 168 NDC les plus récentes couvrant 95 % des émissions mondiales, les émissions globales seront autour de 51,5 Gt CO₂eq en 2030, soit 2,6 % en dessous du niveau de 2019.
Autrement dit : bien que la soumission semble progresser, l’impact agrégé reste bien en dessous de ce qui était annoncé (« 11 % à 24 % ») dans le scénario de référence.
Le rapport de l’AOSIS (le groupe des petits États insulaires) note à ce sujet que les 64 pays ne couvrent qu’environ 30 % des émissions mondiales et que, même dans ce cas, la baisse visée demeure très insuffisante.
Le message est clair : un progrès notable, mais sur un périmètre encore partiel.
Cette partie intègre naturellement les mots-clés : réchauffement mondial, émissions mondiales, contributions déterminées, NDC, UNFCCC.
Les absents de marque et les zones d’ombre
Le tableau est plus contrasté quand on regarde qui n’a pas (encore) soumis son plan ou dont l’ambition reste floue.
Parmi les grandes puissances, la People’s Republic of China ne figure pas dans ce groupe de 64 au 30 septembre. La Republic of India non plus, tout comme les 27 États de l’European Union.
Cela pèse lourd : ces États représentent une part massive des émissions mondiales. Sans leur mise à contribution effective, le pic d’émissions et la baisse durable restent incertains.
De plus, seuls quelques pays ont soumis leurs NDC mises à jour pour 2035. Par exemple, au 10 février 2025, seuls 13 pays avaient communiqué leurs « NDC 3.0 ».
Dans ce contexte, le message du secrétaire exécutif de la CCNUCC, Simon Stiell, est sans ambiguïté :
L’humanité est clairement en train d’infléchir la courbe des émissions à la baisse pour la première fois, même si cela reste encore loin d’être suffisant.
Voilà pourquoi les mots-clés grandes puissances, mise en œuvre, émissions, climat international s’imposent.
Pourquoi la France et l’Europe ne peuvent pas regarder de côté
Face au déséquilibre entre ambition et réalisation, la France et l’Europe ont un rôle stratégique à jouer : non seulement en tant qu’émetteurs historiquement impliqués, mais aussi en tant que modèles de mise en œuvre réelle.
Or, l’analyse note que l’Union européenne pourrait ne pas être « à la hauteur » de son image de leader climatique mondial : sans une CDN ambitieuse (contribution déterminée au niveau national) et une application rigoureuse, le risque d’une crédibilité érodée est réel.
Pour la France, il s’agit donc d’adopter une posture réaliste et volontariste, sans tomber dans la logique de la victimisation (« nous sommes de petits pays insulaires » ou « nous attendons les grands émetteurs »).
L’enjeu est d’afficher une ambition forte, des mesures concrètes et une trajectoire vérifiable. Le mot-clé mise en œuvre effective doit s’imposer.
Par ailleurs, nous devons exiger une aide financière internationale crédible lorsque cela est nécessaire (adaptation, pertes et dommages), mais sans laisser l’argument de la solidarité servir de prétexte à l’inaction domestique.
Avec les mots-clés économie verte, transition juste, adaptation, financement climat, l’Europe devra prouver qu’elle agit d’abord chez elle avant de donner des leçons aux autres.
La soumission par 64 pays de leurs nouveaux plans nationaux et la perspective d’une baisse possible des émissions dans ce groupe sont un signal encourageant.
Mais le diable est dans les détails : les grandes puissances sont absentes ou peu ambitieuses, la baisse agrégée reste modeste et la mise en œuvre est la vraie question.
La France et l’Europe ne peuvent rester spectatrices : elles doivent sortir du rôle de « bons élèves » seulement symboliques et montrer qu’elles sont des acteurs crédibles et efficaces de la transition écologique.
Le temps où l’on pouvait se contenter de promesses est révolu : désormais, la vérité se fera dans les actes.