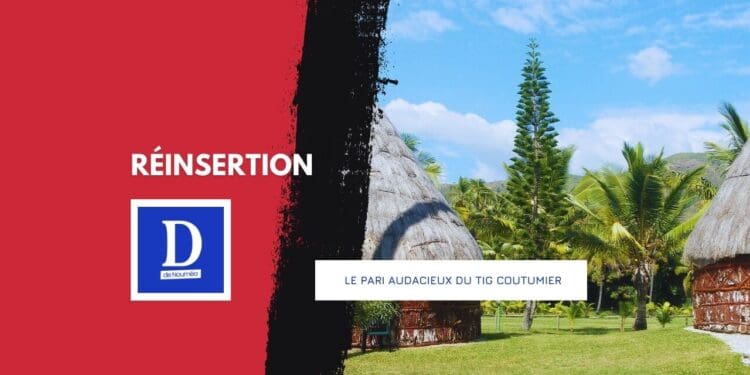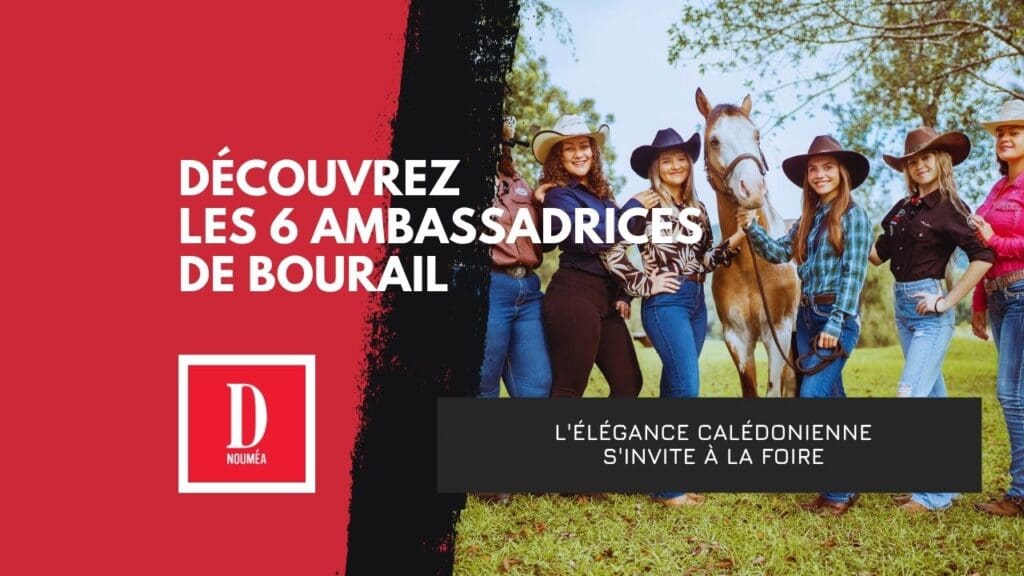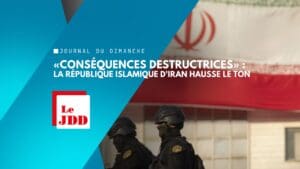Les mains au service de la communauté, le regard tourné vers la justice : en Nouvelle-Calédonie, le travail d’intérêt général en terres coutumières s’impose comme un modèle unique de réinsertion et de responsabilité partagée.
Une justice enracinée dans les valeurs tribales
Le 28 octobre, devant la presse, Ludovic Boula, président du Sénat coutumier, et Gérald Faucou, président du tribunal de première instance de Nouméa, ont rappelé l’ambition commune : reconstruire le lien entre justice et coutume. Depuis cinq ans, le travail d’intérêt général (TIG) s’expérimente dans cinq aires coutumières. Le 5 novembre prochain, un séminaire à Nouville doit en tirer les premiers enseignements et envisager son extension à l’ensemble du territoire.
Ce dispositif alternatif à la prison s’ancre dans les valeurs communautaires : solidarité, responsabilité, respect du collectif. Le Sénat coutumier y voit un outil concret pour réparer sans exclure, pour réhabiliter plutôt que punir. Chaque TIG réalisé en tribu devient un acte de réconciliation entre individu et société.
Mais le constat reste sévère : à peine cinquante places existent dans les structures coutumières, pour près de 700 personnes condamnées chaque année à cette peine. Le besoin de structuration est donc urgent, tout comme la volonté politique de faire de ce dispositif une réponse calédonienne aux défis de la délinquance.
Le travail d’intérêt général, un levier de réinsertion locale
Concrètement, le TIG en tribu s’articule autour de travaux manuels à valeur sociale : entretien des espaces verts, nettoyage, participation aux événements communautaires. Une manière de replacer le condamné au cœur de la vie tribale, en lui redonnant le sens du travail collectif.
Trois formes coexistent : individuelle, collective ou pédagogique. Dans chaque cas, la logique reste la même : réparer un tort sans exclure du groupe. Les autorités coutumières jouent ici un rôle central, en accompagnant les tigistes et en garantissant le bon déroulement des missions.
Cette approche, saluée par le Service pénitentiaire d’insertion et de probation, favorise la réinsertion professionnelle et sociale. Elle démontre que la coutume, loin d’être archaïque, peut inspirer une justice moderne, enracinée et humaine, capable de prévenir la récidive mieux que la prison seule.
Vers une justice coutumière actrice de la réinsertion
Pour le Sénat coutumier, ce programme ne s’arrête pas là. L’objectif est clair : étendre la démarche à toutes les aires, y compris Iaai, Nengone et Paicî-Cèmuhi, encore absentes du dispositif. Le séminaire du 5 novembre visera à lever les freins : crainte d’accueillir un condamné connu, méconnaissance des procédures, responsabilité des tuteurs.
« Il faut changer le regard sur le TIG », martèlent les représentants du Sénat. Car derrière les statistiques, une réalité frappe : plus de 90 % des détenus calédoniens sont Kanak. D’où cette conviction, désormais partagée : la réinsertion doit se construire au sein même des communautés.
L’institution de Nouville prévoit déjà, pour 2026, de renforcer ses liens avec le centre pénitentiaire de Nouméa afin de « recréer du lien entre le dedans et le dehors ». Dans une société marquée par les fractures, cette justice coutumière participative pourrait bien devenir une référence locale et un exemple pour l’État.