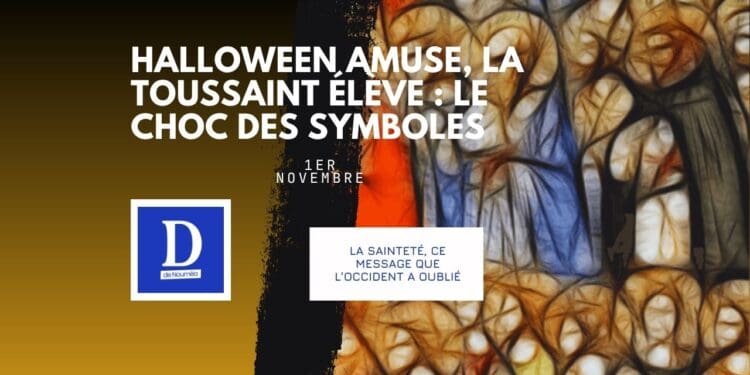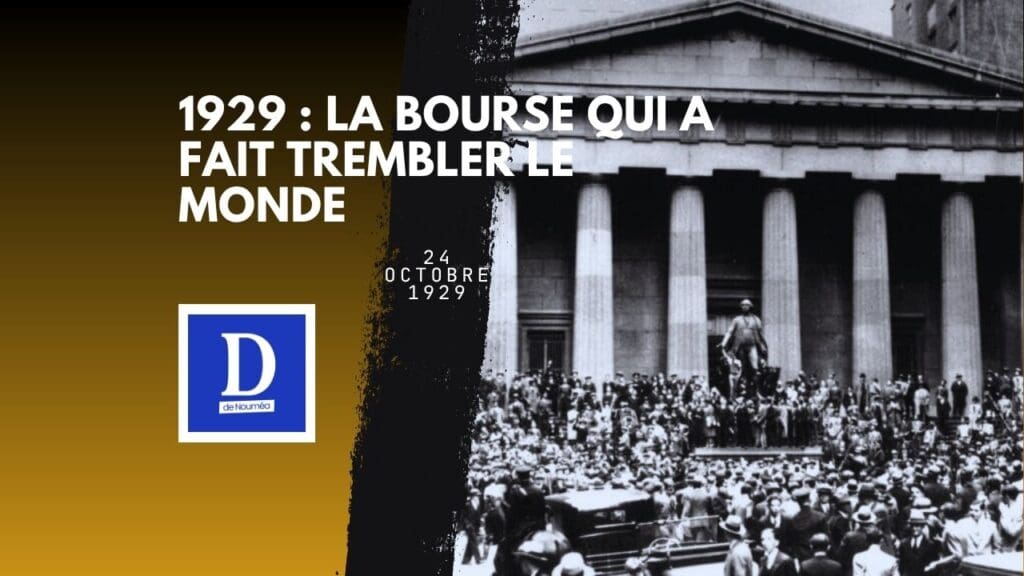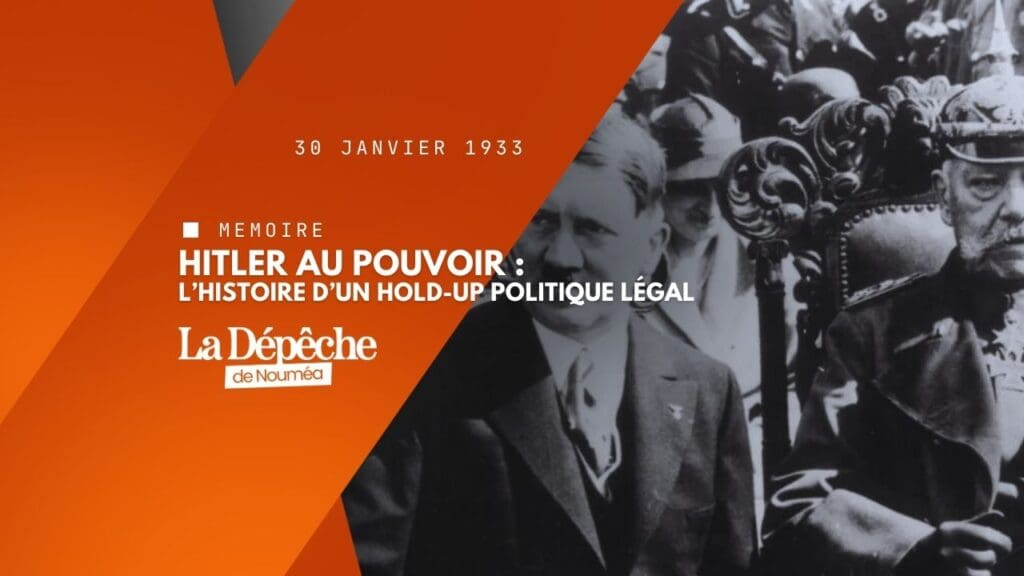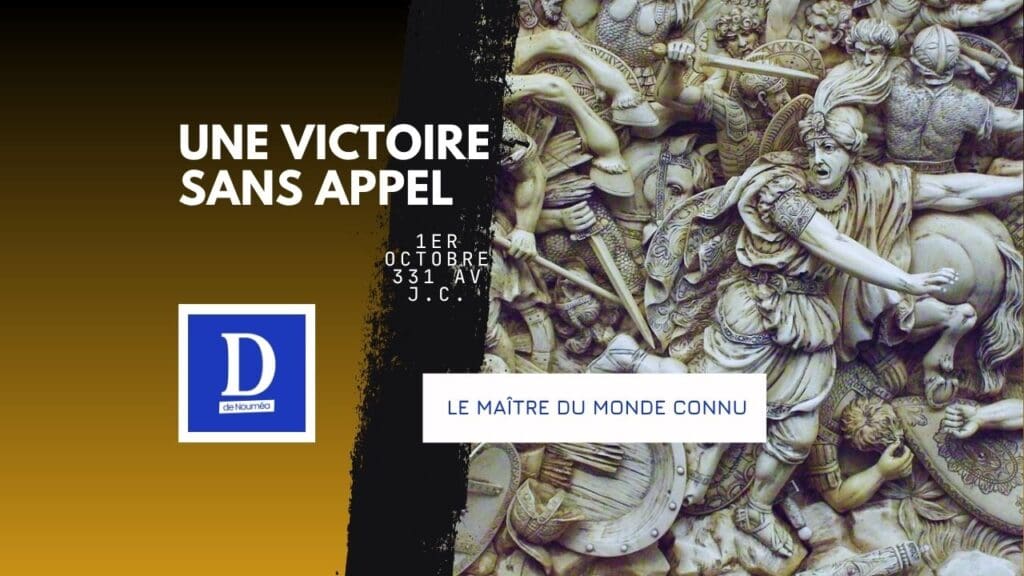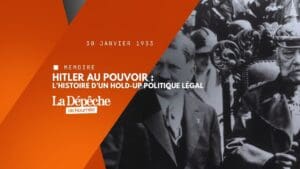Deux jours, deux sens, une même espérance : celle de la vie éternelle.
Entre recueillement et ferveur, la Toussaint rappelle à la France ses racines spirituelles bien loin des dérives commerciales d’un Halloween importé des États-Unis.
La Toussaint, mémoire des saints et fidélité aux racines chrétiennes
Instituée en 610 par le pape Boniface IV, la fête de la Toussaint est née d’un geste fort : transférer les reliques des martyrs romains vers le Panthéon d’Agrippa, transformé en église. Ce choix, à la fois symbolique et politique, marquait déjà la victoire de la foi sur le paganisme. Fixée au 1er novembre dans tout l’Occident, cette célébration honore tous les saints, connus ou anonymes, et place l’humanité entière sous le regard bienveillant de Dieu.
Le 2 novembre, jour des morts, complète ce cycle spirituel en invitant les croyants à la prière et au souvenir. En unissant les vivants et les défunts, l’Église rappelle que la mort n’est pas une fin, mais un passage vers la lumière éternelle. Dans une société où la superficialité gagne du terrain, la Toussaint demeure un repère, une boussole morale et spirituelle.
Halloween, le contre-modèle d’une société désenchantée
À l’opposé de ce message d’espérance, Halloween, héritée des traditions celtes et popularisée par les Irlandais d’Amérique, célèbre le macabre et la peur. Son nom, contraction de All Hallows Eve (« la veille de tous les saints »), n’a plus grand-chose à voir avec sa signification première. De fête religieuse, elle est devenue un produit culturel mondialisé, vidé de tout sens, où déguisements, citrouilles et commerce remplacent la prière et la mémoire.
Dans les années 1990, cette mode a tenté de s’imposer en Europe. Mais face à cette déferlante, l’Église catholique n’a pas baissé les bras. Elle a choisi de réaffirmer la joie de la sainteté à travers les soirées Holywins (« la sainteté gagne »), où musique, louange et espérance répondent à la peur et au vide spirituel. Une manière moderne mais fidèle de dire que le bien triomphe toujours du mal, même dans un monde qui l’oublie.
La sainteté, une vocation universelle et toujours actuelle
La Toussaint n’est pas qu’un hommage : c’est un appel personnel. Car la sainteté n’est pas réservée à une élite. Elle concerne tous ceux qui choisissent de vivre dans la fidélité à l’Évangile. Le pape Jean-Paul II l’avait bien compris, en canonisant des figures diverses, du père Maximilien Kolbe à Mère Teresa, en passant par Padre Pio et Édith Stein. Tous ont prouvé qu’on peut être saint dans la vie ordinaire, par le courage, la compassion, la foi vécue au quotidien.
Leur vie, souvent marquée par le doute, la souffrance ou l’incompréhension, montre que la sainteté n’efface pas l’humanité ; elle la transcende. En célébrant ces témoins, l’Église invite chacun à mettre le Christ au centre de sa vie, à retrouver le sens de l’espérance et à ne pas se laisser happer par le nihilisme ambiant.
C’est là toute la force de la Toussaint : rappeler que la foi, la fidélité et la mémoire sont des piliers d’une civilisation vivante. Dans un monde qui glorifie l’éphémère, elle oppose la lumière du spirituel, la permanence des valeurs et la promesse de la Résurrection.