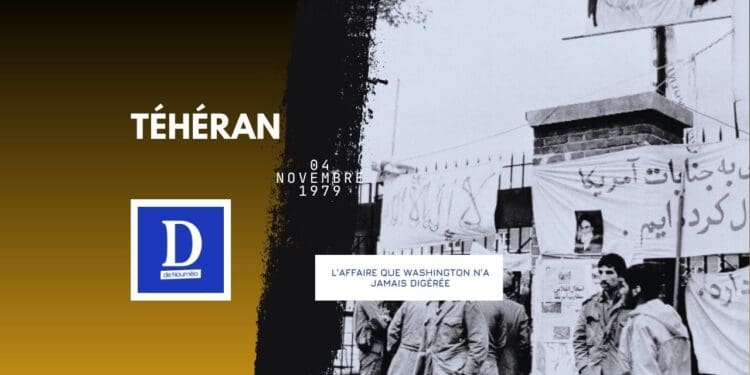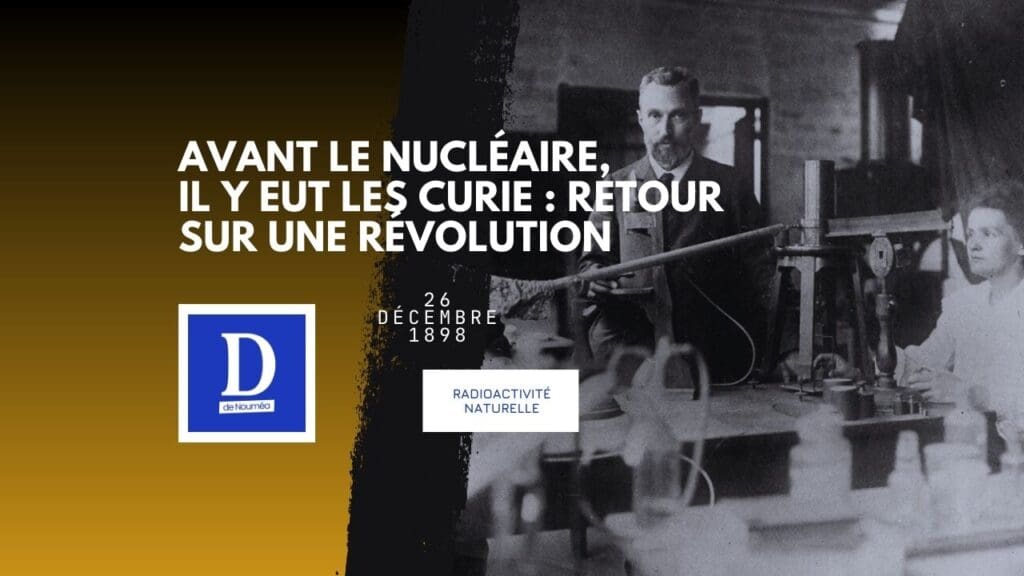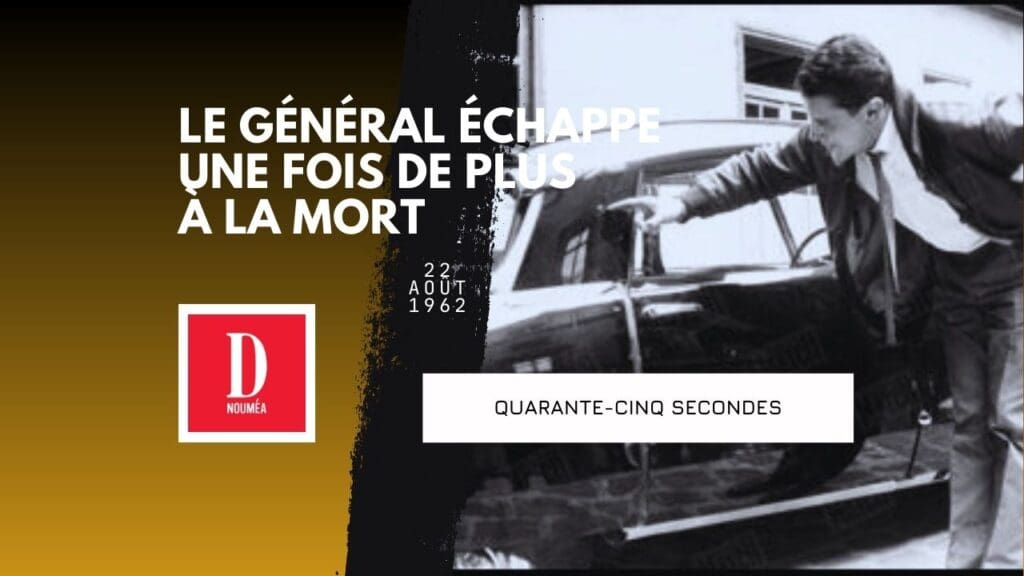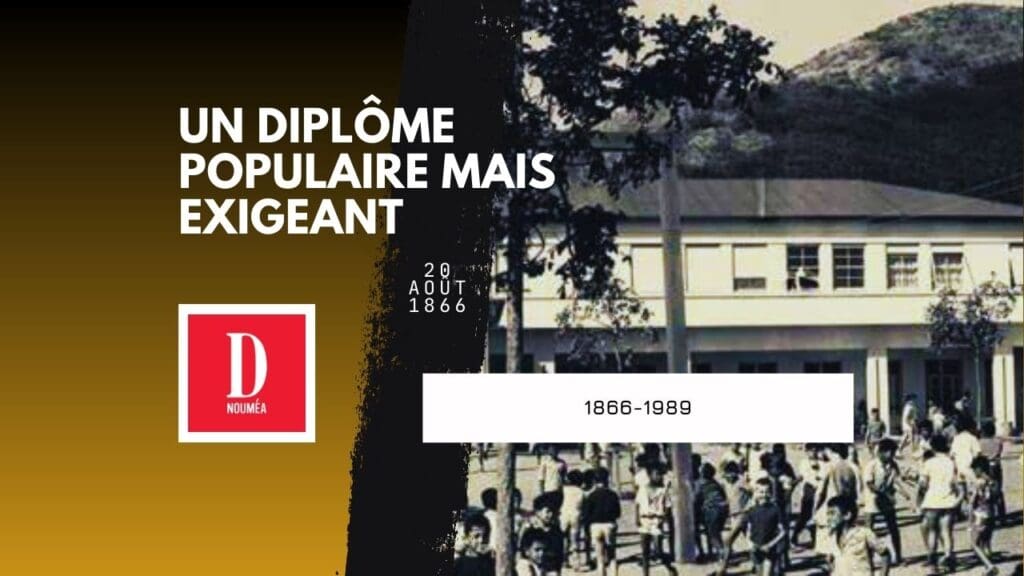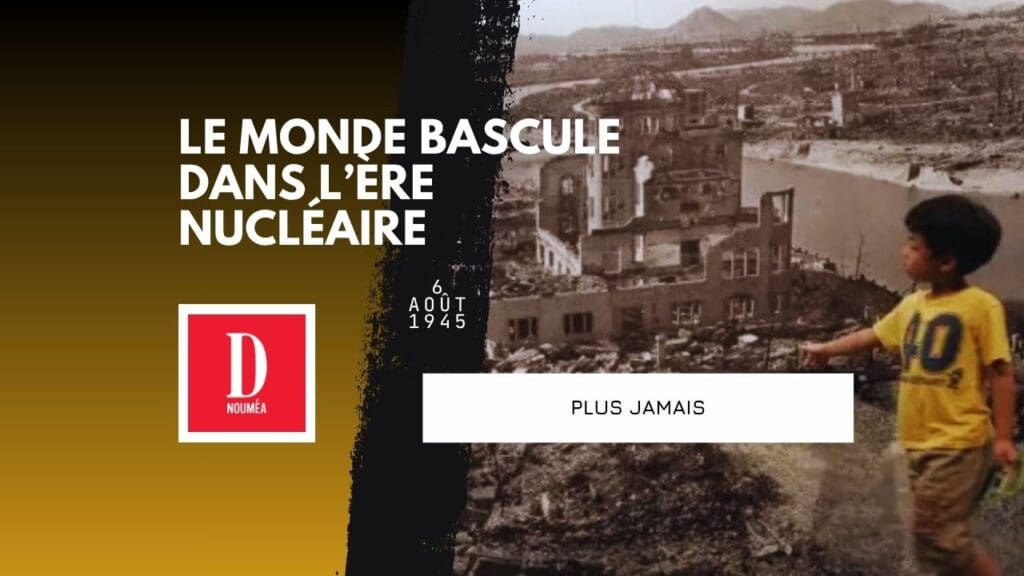Depuis des mois, l’Iran révolutionnaire s’enferme dans une dérive idéologique qui transforme la rue en tribunal et l’Occident en ennemi absolu. Le 4 novembre 1979, la fièvre anti-américaine franchit un seuil redoutable.
Une journée qui devait être une simple manifestation étudiante devient l’une des plus graves humiliations infligées aux États-Unis au XXe siècle.
L’ambassade américaine assiégée : le jour où l’Occident a reculé
Ils sont quelques centaines au départ. Des étudiants galvanisés par la propagande du nouveau régime islamiste, autoproclamés « étudiants suivant la voie de l’imam ». Khomeini, revenu triomphalement quelques mois plus tôt, incendie depuis des semaines l’image des États-Unis, qu’il accuse d’être le « Grand Satan ». Le 4 novembre au matin, près de 400 d’entre eux convergent vers l’ambassade américaine de Téhéran. Leur objectif est limpide : obtenir l’extradition du chah Mohammad Reza Pahlavi, ex-allié de Washington, désormais mourant et réfugié aux États-Unis.
En deux heures, la foule enfonce le mur d’enceinte. Les marines américains sont débordés. Le drapeau américain est arraché et remplacé par une bannière religieuse. Les diplomates tentent de fuir ; seuls quelques privilégiés y parviennent. 52 Américains restent pris au piège, yeux bandés, mains liées, projetés au cœur d’une révolution qui veut régler ses comptes avec l’Occident.
À l’extérieur, les cris « Mort à l’Amérique » rythment la scène. Un mannequin pend au bout d’une corde : « Pour le chah ». Dans les allées de l’ambassade, les étudiants brandissent des portraits géants de Khomeini, convaincus de mener une « seconde révolution ».
Carter paralysé, Washington humilié : le fiasco qui change la géopolitique américaine
Face à la gravité de la situation, le président Jimmy Carter se retranche derrière des sanctions économiques. Rien n’y fait. L’Iran exige des concessions politiques, le retour des avoirs gelés, la restitution des biens du chah. L’Amérique tergiverse. L’image de la première puissance mondiale incapable de protéger ses propres diplomates commence à s’imprimer dans l’opinion.
En avril 1980, Carter tente enfin une opération militaire. Eagle Claw doit libérer les otages. C’est un désastre absolu. Tempête de sable, hélicoptères en panne, collision dramatique : huit soldats américains meurent dans le désert iranien. Pour Téhéran, c’est une victoire divine : pour Washington, une humiliation intolérable qui poursuivra Jimmy Carter jusqu’à la fin de sa carrière politique.
Dans le même temps, le régime iranien s’enfonce encore davantage dans l’idéologie. Le gouvernement modéré de Mehdi Bazargan démissionne. Les Gardiens de la Révolution prennent le contrôle de la rue. L’anti-américanisme devient doctrine d’État, ciment d’un pouvoir qui a besoin d’un ennemi extérieur pour exister.
C’est dans ce climat que l’administration américaine, blessée et furieuse, laisse Saddam Hussein envahir l’Iran en septembre 1980. Une guerre monstrueuse s’ouvre, encouragée en sous-main par Washington et Riyad, décidés à faire payer à Téhéran son affront.
La libération des otages et l’héritage d’une crise qui redéfinit l’ordre mondial
Le chah meurt en juillet 1980, mais l’Iran maintient la pression. Téhéran pose quatre conditions : restitution des biens du monarque, dégel des avoirs, abandon des plaintes américaines, non-ingérence. Les négociations prennent des mois. Finalement, grâce à une médiation algérienne, un accord est signé le 19 janvier 1981.
Le lendemain, 20 janvier 1981, les 52 otages sont libérés. Exactement le jour où Ronald Reagan prête serment à Washington. L’Amérique interprète ce timing comme une provocation ultime. Carter quitte la Maison-Blanche avec un échec retentissant ; Reagan arrive avec la promesse de restaurer la puissance américaine face aux régimes hostiles.
Du côté iranien, l’épisode devient un acte fondateur. L’ambassade américaine, rebaptisée « nid d’espions », est transformée en musée anti-arrogance, glorifiant un geste qui, au prix de la dignité des otages, a consolidé le pouvoir des plus radicaux.
Aux États-Unis, l’humiliation nourrit un désir de revanche durable. Pendant des décennies, Washington multipliera sanctions, pressions diplomatiques, soutien aux adversaires régionaux de Téhéran. L’épisode devient le point de départ d’une méfiance réciproque qui structure encore l’équilibre stratégique du Moyen-Orient.
Quarante ans plus tard, la crise des otages reste un repère : le moment où, face à l’idéologie islamiste, l’Occident a reculé et où l’Iran a compris jusqu’où il pouvait aller. Un basculement historique qui continue d’alimenter tensions, bras de fer nucléaires et fractures diplomatiques. Une page sombre où la faiblesse occidentale a offert aux extrémistes un triomphe politique dont les conséquences résonnent encore.