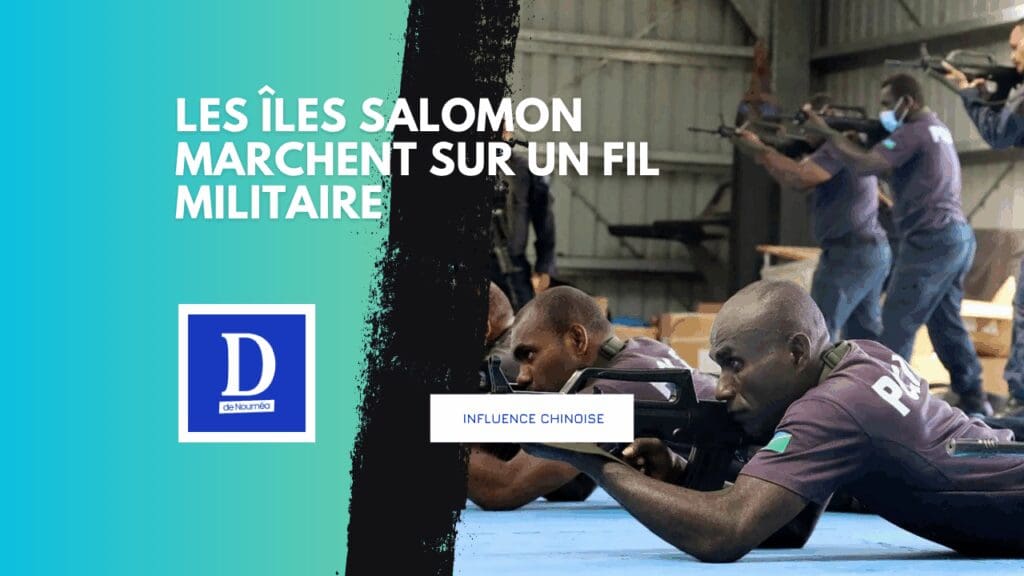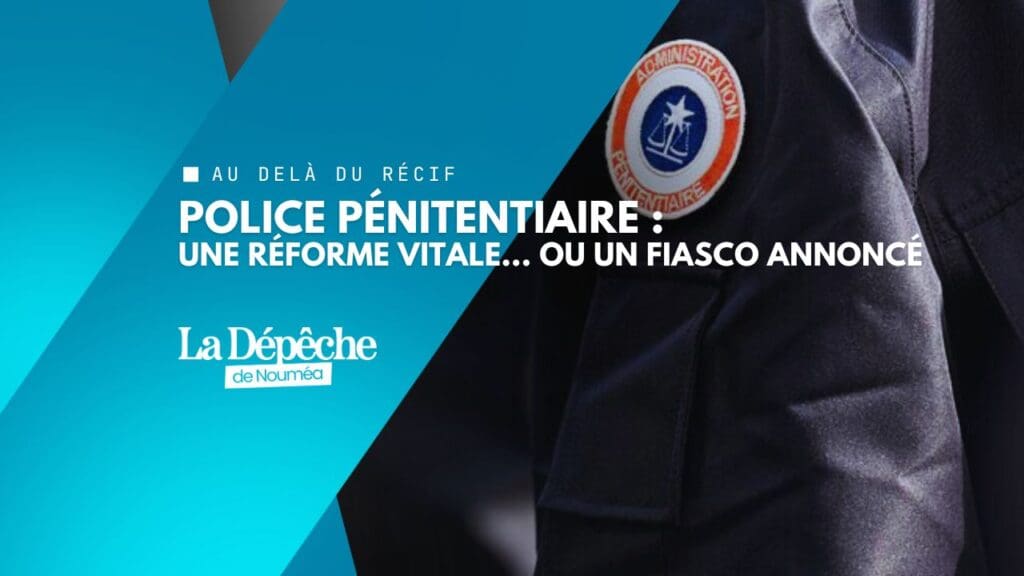Deux nations, une armée en devenir. L’Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée viennent d’unir leurs destins militaires sous un même drapeau stratégique : celui du Pukpuk Treaty, signé à Canberra le 6 octobre.
Une alliance “monogame” pour bloquer la Chine
Le traité de défense mutuelle prévoit une intégration des forces, des doctrines communes et surtout une clause sans équivoque : Port-Moresby s’engage à ne pas conclure d’accords militaires avec d’autres puissances susceptibles de nuire à cette alliance.
En clair, la Chine n’aura jamais de port naval en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un objectif poursuivi par la diplomatie australienne depuis plus de dix ans.
Déjà appliquée à Nauru et Tuvalu, cette “clause d’exclusivité” est désormais au cœur de la stratégie océanienne de Canberra, qui cherche aussi à étendre des accords similaires à Vanuatu et Fidji.
10 000 Papous dans l’armée australienne
Le Premier ministre James Marape a vu grand : jusqu’à 10 000 Papous pourraient intégrer l’armée australienne, créant un lien humain inédit entre les deux pays.
Côté australien, le Premier ministre Anthony Albanese a salué cette ouverture, y voyant un moyen d’accroître la taille de l’ADF (Australian Defence Force) tout en renforçant la présence océanienne.
Canberra prévoit une armée de 69 000 soldats d’ici 2030, et pourrait bientôt compter plusieurs milliers de recrues venues de Port-Moresby.
Les analystes parlent déjà d’une transformation profonde : “Dans dix ans, le visage de l’armée australienne pourrait être partiellement papou.”
Une union forgée par l’histoire
Cette “mariage militaire” a des racines anciennes. L’Australie fut le berceau du Pacific Islands Regiment, ancêtre de l’armée papouasienne, avant que celle-ci ne soit restituée à l’indépendance en 1975.
Le Pukpuk Treaty (du tok pisin “crocodile”) symbolise ce retour aux sources, dans un contexte de rivalités géopolitiques croissantes dans le Pacifique.
Mais Canberra reste prudente : son soutien militaire se limitera aux menaces extérieures. Le souvenir sanglant de Bougainville (1988-1998) a laissé une leçon : pas d’ingérence dans les crises internes.
Marape lui-même a promis de faire de Bougainville une “zone démilitarisée”, affirmant que la réconciliation passera désormais par la politique, pas par les armes.