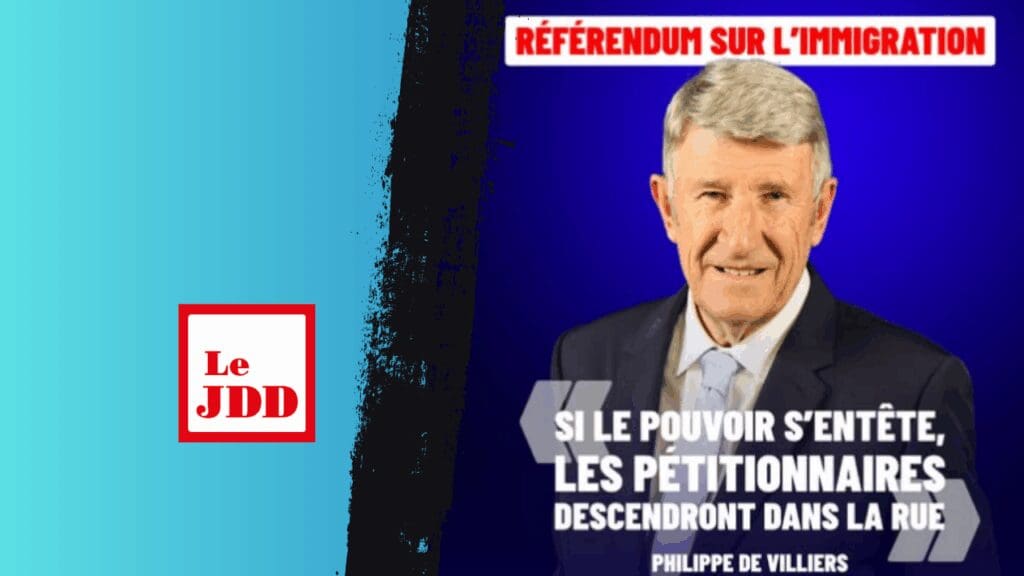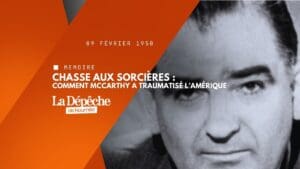Après deux ans d’un partenariat en demi-teinte, la Chine multiplie les gestes envers le Honduras avant l’élection présidentielle du 30 novembre. Objectif : éviter que le pays ne revienne dans le camp de Taïwan, après avoir rompu avec Taipei en 2023.
Pékin à la rescousse du Honduras
Promesses d’achats de crevettes, bourses universitaires réactivées, invitations officielles et dons médiatisés : Pékin s’est soudainement activé dès que les sondages ont annoncé une possible victoire de Salvador Nasralla, candidat favorable à Taïwan.
Après deux ans d’inertie, l’ambassade chinoise a signé de nouveaux contrats à hauteur de 50 millions de dollars et offert du matériel informatique au Congrès hondurien. Une diplomatie d’urgence pour contrer la menace d’un retour de Taipei, bien plus qu’une preuve d’amitié durable.
Une influence à court terme
Pour la Chine, le ralliement du Honduras avait été une victoire symbolique dans sa compétition mondiale contre Taïwan. Mais deux ans plus tard, le bilan est décevant : infrastructures promises en attente, exportations stagnantes, coopération économique quasi nulle.
Ce modèle diplomatique, fondé sur la réaction plutôt que sur la constance, expose les limites du “soft power” chinois. Pékin semble plus soucieux de sauver la façade que de construire une relation solide.
Une leçon pour le Pacifique
Pour les puissances comme l’Australie, l’enseignement est clair : la crédibilité vaut mieux que la dépense. Dans le Pacifique comme en Amérique latine, la Chine achète du temps plus qu’elle ne bâtit la confiance. Son influence se mesure en promesses rapides, pas en partenariats durables.
Le cas hondurien montre que l’influence achetée s’effrite vite : sans constance, sans transparence et sans résultats tangibles, la générosité stratégique de Pékin ne fait pas illusion bien longtemps.