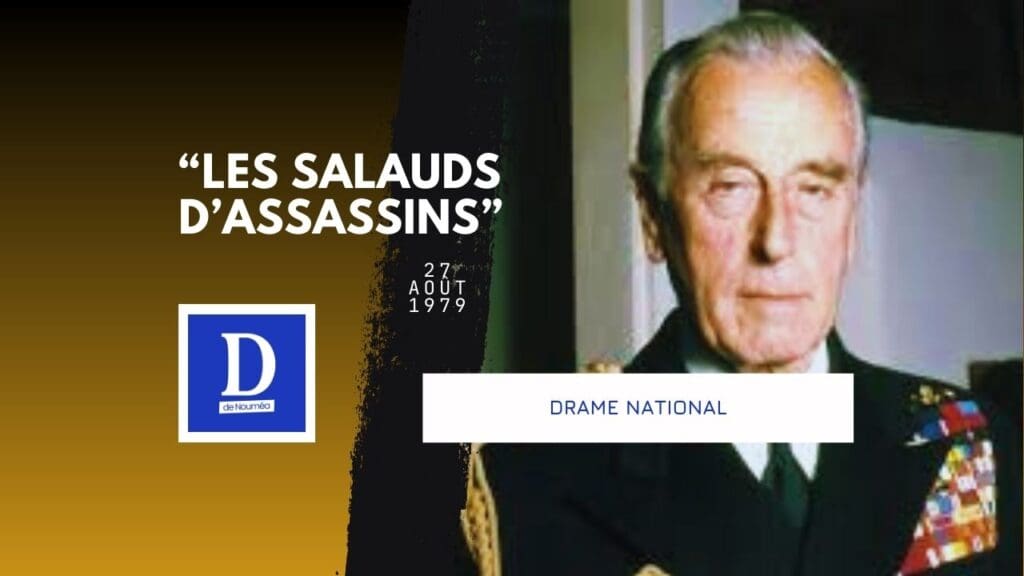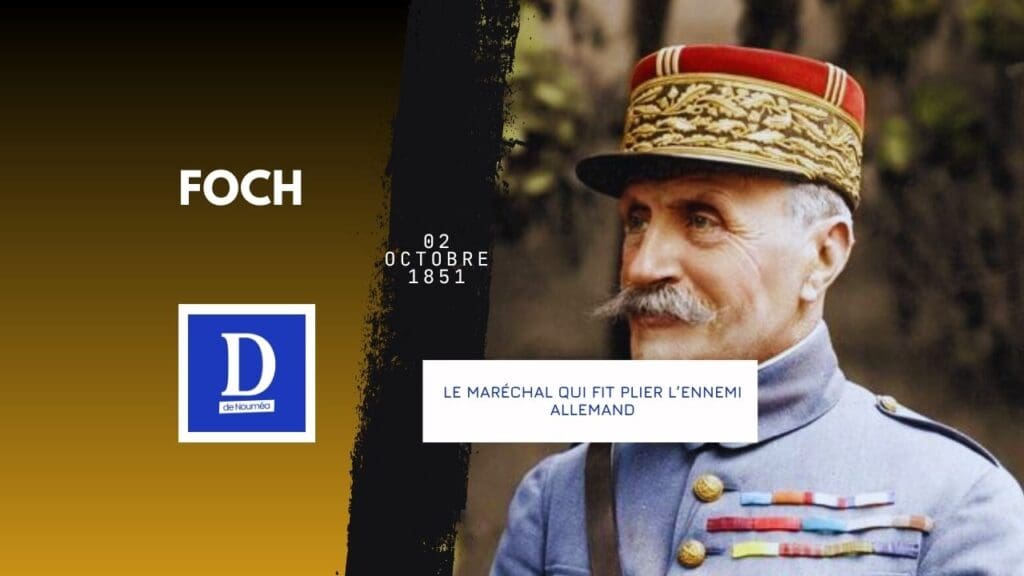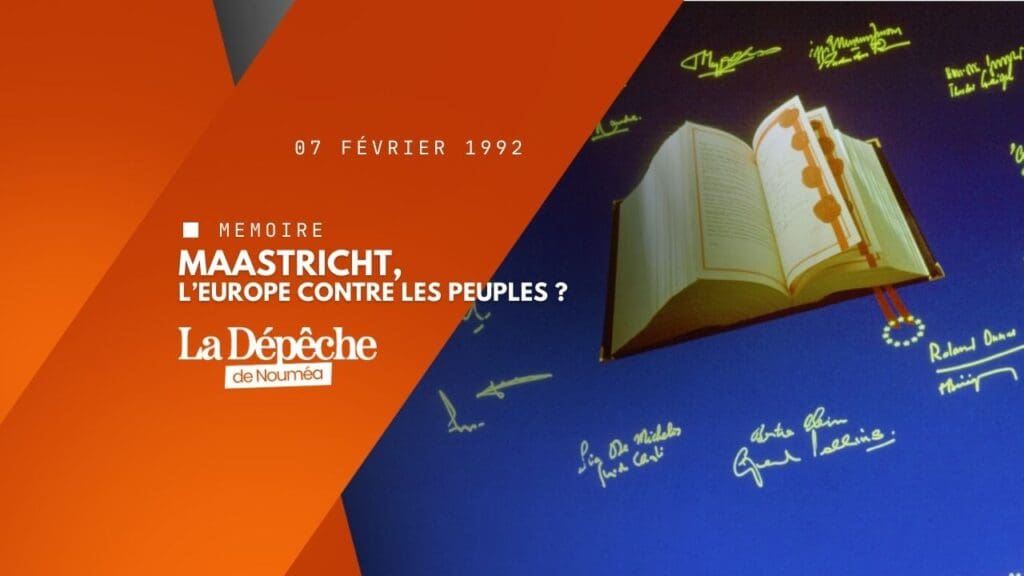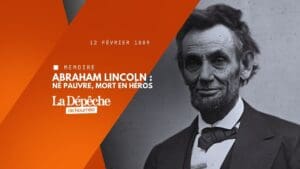La France croyait avoir tourné la page du terrorisme après l’union nationale de janvier.
Mais le 13 novembre 2015 a brutalement rappelé que la guerre menée contre notre pays ne se gagne jamais par naïveté.
La nuit où la France a replongé dans l’effroi
Le 13 novembre 2015 commence comme un banal vendredi parisien. À Saint-Denis, le match France–Allemagne se joue sous la surveillance du président de la République. Quelques minutes plus tard, trois explosions retentissent autour du Stade de France. Les terroristes n’ont pas pu pénétrer dans l’enceinte, mais se font exploser à proximité : les premiers attentats-suicides en France. Un visiteur meurt, plusieurs sont blessés, et déjà l’onde de choc commence.
Cette première attaque ne sera pourtant qu’un prélude. L’essentiel du carnage se déploie dans les rues du 11ᵉ arrondissement : fusillades en rafale contre les terrasses, explosions, panique. Puis survient l’horreur absolue : l’assaut du Bataclan, où un concert de rock se transforme en scène de guerre. Les terroristes exécutent sans hésiter, méthodiquement, avec une froideur qui glace encore le pays dix ans plus tard.
Très vite, des policiers de la BAC pénètrent dans la salle. Sans gilet lourd, sans information complète, ils s’élancent. Ils parviennent à neutraliser l’un des assaillants. Pendant ce temps, une patrouille Sentinelle se tient à quelques centaines de mètres, prête à intervenir, mais bloquée par l’absence d’ordre clair du commandement. Une incompréhension dramatique qui fera date et poussera, dans les années suivantes, à repenser la coordination police–armée lors des crises majeures.
À l’aube, Paris ressemble à une ville assommée. Les hôpitaux tournent comme des blocs de campagne. Cent trente morts, plus de trois cent cinquante blessés, et une nation meurtrie comme jamais depuis la Libération. En Europe, seule la tuerie d’Atocha, en 2004, aura été plus meurtrière.
Une riposte française qui refuse l’ambiguïté
Au lendemain de la tragédie, l’exécutif choisit la sobriété. Pas de marche blanche, pas de nouvelle communion nationale comme en janvier. François Hollande parle d’un « acte de guerre commis par une armée terroriste », visant explicitement Daech. Cette désignation claire tranche avec des années d’euphémisation et rappelle la réalité stratégique : l’islamisme radical attaque la France parce qu’elle incarne une civilisation qui lui résiste.
Dans les jours qui suivent, la traque s’intensifie. En Belgique, en France, les services de renseignement démantèlent les réseaux. Le 18 novembre, un assaut est mené à Saint-Denis contre un appartement où se cachent plusieurs terroristes. L’un d’eux déclenche sa ceinture. Parmi les morts : Abdelhamid Abaaoud, cerveau opérationnel venu de Belgique.
Au total, dix-huit complices présumés sont arrêtés, dont Salah Abdeslam, futur condamné à la perpétuité incompressible. La justice passe, lentement mais fermement. La France montre qu’elle sait frapper, enquêter, juger : un État de droit qui ne tremble pas n’est jamais un État faible.
Dix ans après : une mémoire brouillée, une menace toujours présente
Dix ans plus tard, la France n’a plus connu d’attentat de masse. Mais la menace a muté : attaques au couteau, individus isolés, profils instables revendiquant leur « allégeance » à une mouvance islamo-terroriste. Le danger n’a pas reculé : il s’est fragmenté.
Dans le même temps, un autre poison gagne du terrain : une montée de l’antisémitisme sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme en Belgique ou en Espagne, chaque tension au Moyen-Orient sert désormais de prétexte à cibler les Juifs de France. Les incidents récents notamment lors d’un concert à la Philharmonie de Paris rappellent que le fanatisme change de masque, mais jamais d’objectif.
Face à cela, le gouvernement choisit aujourd’hui de mettre en avant les victimes, d’ouvrir un futur Mémorial du terrorisme, de sanctuariser la mémoire. Un geste utile, mais insuffisant : une nation se protège d’abord en combattant l’idéologie qui la vise, non en se contemplant dans son propre malheur.
Le 13 novembre reste une blessure vive, mais aussi une leçon : la paix n’est jamais acquise, la faiblesse se paie au prix fort, et la France ne demeure forte que lorsqu’elle assume ce qu’elle est. Une civilisation qui renonce à défendre ses valeurs finit toujours par les perdre.
Aujourd’hui encore, cette nuit rouge rappelle que le courage des policiers, des soignants, des anonymes a empêché un drame encore plus grand. La France a été frappée, mais pas soumise. Et dix ans après, c’est peut-être cela, au fond, la véritable victoire.