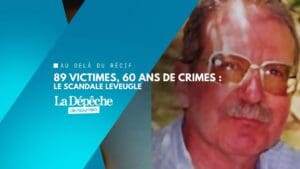Une colère froide au Camp-Est : les surveillants pénitentiaires ne veulent plus se taire. La tension monte dans le milieu pénitentiaire calédonien. Et ce matin-là, c’est une colère froide, méthodique qui attend la ministre.
Alors que Naïma Moutchou arrive au Camp-Est, les personnels ont décidé de rompre le silence.
Un face-à-face tendu entre la ministre et un personnel épuisé
Jeudi 13 novembre, 8 h. La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, devait effectuer une visite officielle du centre pénitentiaire du Camp-Est, à Nouméa. Une séquence institutionnelle classique… qui ne le sera finalement pas.
L’intersyndicale FO–USTKE–SOENC a choisi ce moment précis pour lancer une mobilisation d’ampleur, dénonçant une dérive managériale jugée insupportable par les agents.
Selon les syndicats, la direction du Camp-Est enchaîne depuis des mois des décisions « déconnectées du terrain », accumulant maladresses et injonctions contradictoires. Dans leur communiqué, le ton est sans appel : « STOP, ça suffit ! » une formule choc qui résume une exaspération profonde.
Déjà confrontés à une réalité carcérale éprouvante, les agents dénoncent le manque d’écoute, le mépris persistant et la dégradation continue des conditions de travail. Pour l’intersyndicale, la coupe est pleine : « L’inaction a assez duré ! »
Ils réclament des réponses concrètes, pas des promesses diluées dans un protocole administratif.
En choisissant de se mobiliser pendant la venue d’un membre du gouvernement, les syndicats adressent un message clair : plus de gestion silencieuse de la crise pénitentiaire calédonienne.
La colère est désormais publique, assumée, structurée.
Des revendications lourdes face à une réalité budgétaire étouffante
L’intersyndicale dénonce un « dialogue social réduit à un dialogue de sourds » et des politiques d’« asphyxie budgétaire » répétées.
Leur mot d’ordre : seule une mobilisation massive peut aujourd’hui rétablir un semblant d’équité.
Les griefs sont nombreux et ciblent des manquements essentiels :
– manque chronique de personnel ;
– conditions de travail indignes ;
– gestion budgétaire inéquitable ;
– pressions hiérarchiques injustifiées ;
– dénigrement déguisé ;
– absence de perspectives de réforme interne.
Ces doléances ne viennent pas d’une minorité capricieuse : elles sont portées par les trois syndicats les plus représentatifs du secteur. Leur appel est sans ambiguïté :
« Rejoignez-nous le 13 novembre pour une mobilisation forte ! »
Le choix du calendrier n’a rien d’anodin. En pleine visite ministérielle, cette démonstration de force veut rappeler une vérité souvent oubliée : la sécurité intérieure repose d’abord sur ceux qui la garantissent, jour après jour, dans les cellules, les coursives, les miradors loin des caméras.
Une décision de justice qui accentue la pression
Cette mobilisation intervient dans un contexte déjà explosif.
Le 29 octobre, le tribunal administratif de Nouméa a ordonné à l’administration pénitentiaire de prendre trois séries de mesures urgentes après la plainte de cinquante détenus dénonçant des conditions de vie indignes. Un camouflet juridique rare.
Le juge des référés a enjoint l’État de :
– améliorer les conditions matérielles des détenus dormant sur des matelas à même le sol ;
– procéder à une désinsectisation et une dératisation complètes ;
– installer des rideaux dans les blocs sanitaires pour préserver un minimum d’intimité dans les cellules collectives.
Autrement dit, des exigences de base celles que la France considère comme des standards élémentaires depuis des décennies.
Que le juge les rappelle en urgence révèle la profondeur de la dégradation.
Mais cette décision met aussi en lumière une réalité dérangeante : si les détenus s’organisent mieux que les agents pour obtenir des avancées, c’est toute la légitimité opérationnelle de l’institution qui vacille.
Pour les syndicats, c’est la preuve ultime d’une administration à la dérive, au détriment des personnels comme de l’autorité.
Le paradoxe est saisissant : les décisions judiciaires exigent plus de moyens, mais ceux qui doivent les appliquer dénoncent déjà une pénurie chronique.
La crise budgétaire continue d’éroder les marges d’action.
Le Camp-Est porte les stigmates d’un système épuisé, que ni circulaires ministérielles ni visites officielles ne suffiront à réparer.
En Nouvelle-Calédonie, l’autorité de l’État est attendue dans les actes, pas dans les discours une vérité que le Camp-Est incarne désormais cruellement.