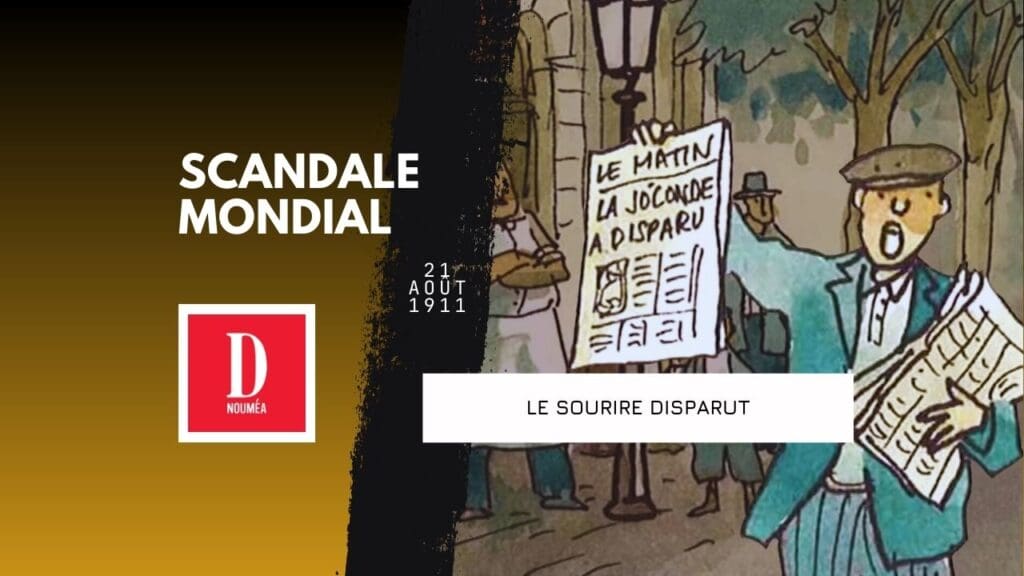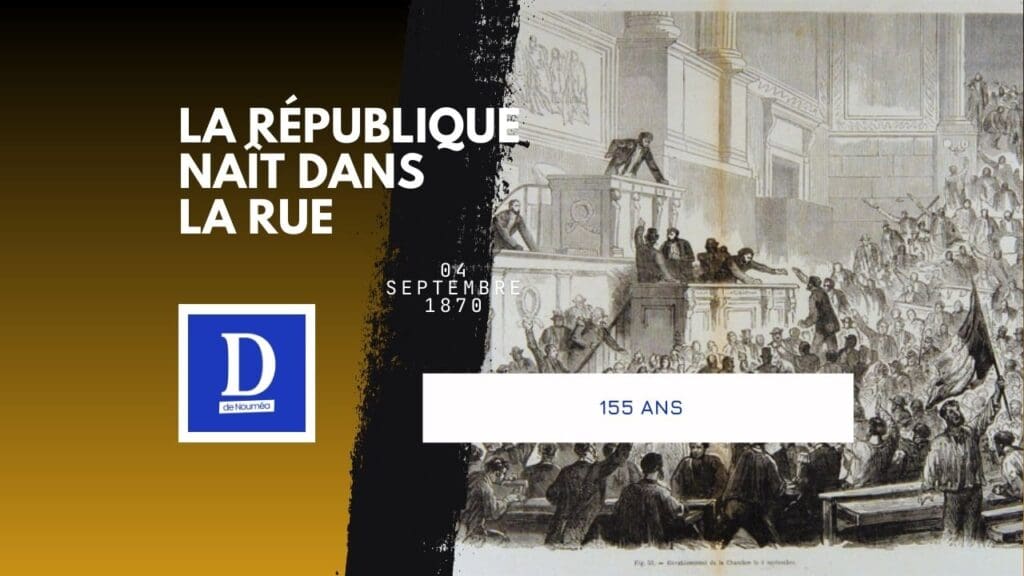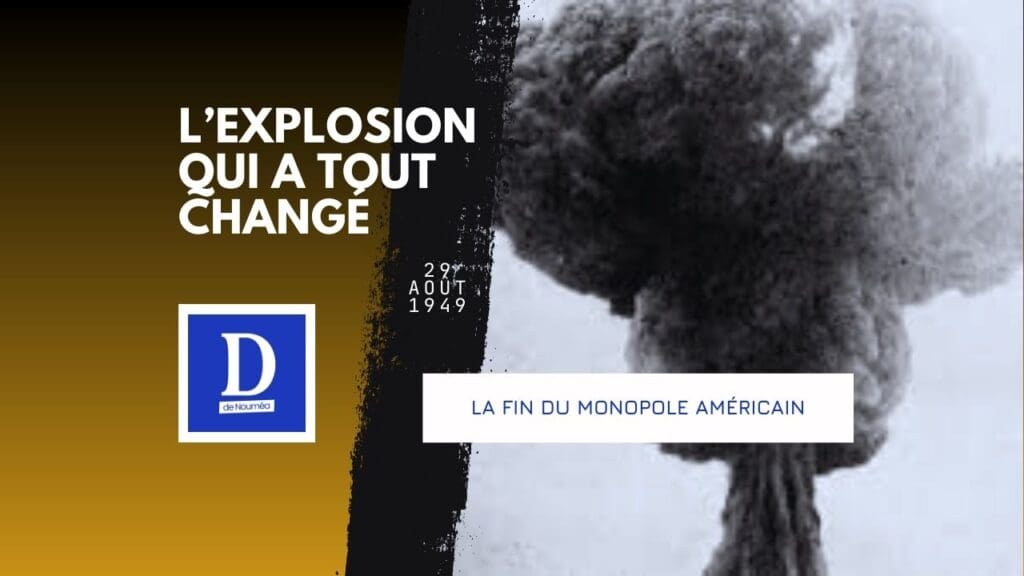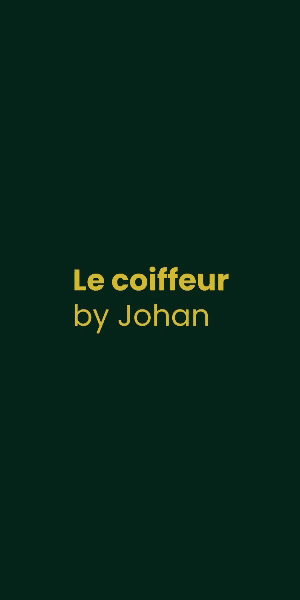Sous le soleil du Pacifique, une tour de fer dressée contre le vent et le temps.
Symbole du génie français, le phare Amédée raconte l’audace d’un empire qui éclairait le monde.
Le génie français au service de l’Empire
Dès 1859, la France impériale entend sécuriser l’entrée du port de Nouméa, jeune capitale d’une colonie stratégique arrachée à la convoitise britannique. L’archipel calédonien, pris en 1853, devient alors le joyau du Pacifique français.
Sous l’impulsion du gouverneur, le Service des phares et balises imagine un ouvrage digne du prestige national. L’ingénieur Léonce Reynaud, figure majeure du Second Empire, conçoit une tour métallique révolutionnaire, haute de 45 mètres, capable de résister à la corrosion du climat tropical.
Son projet, mariage parfait entre art et science, est présenté à l’Exposition universelle de Londres en 1862 : la France montre au monde qu’elle n’est pas seulement une puissance coloniale, mais une nation d’ingénieurs et de bâtisseurs.
Fabriqué à Paris, dans les ateliers Rigolet, aux Buttes-Chaumont, le phare est d’abord monté à La Villette pour vérification avant d’être démonté, puis embarqué à bord du navire Émile Pereire en 1864. Cinq mois plus tard, la structure arrive à Port-de-France (Nouméa), prête à être érigée sur l’îlot Amédée.
Amédée : un chantier de fer et de foi
Sous la direction du conducteur des Ponts et Chaussées Stanislas Bertin, les travaux sur l’îlot débutent en janvier 1865. Militaires et Mélanésiens œuvrent ensemble, dans une chaleur accablante, à dresser la tour de fer au-dessus du lagon. Dix mois suffiront à accomplir ce miracle d’ingénierie.
Chaque boulon, chaque plaque, chaque patin de fonte trouve sa place dans cette structure hexadécagonale, fixée au sol par un socle de béton massif. Reynaud a pensé à tout : pas de rivetage, pas d’échafaudage, mais un système de montage autonome, symbole de la rationalité industrielle française.
Le 15 novembre 1865, jour de la fête de l’impératrice Eugénie, Madame Guillain, épouse du gouverneur, allume pour la première fois la lampe à huile de colza. Le faisceau éclaire la passe de Boulari, guidant les navires vers la colonie nouvelle.
Le phare Amédée devient ainsi le gardien du lagon, la première lumière française à se refléter dans le Pacifique. Plus qu’un simple monument, c’est un acte de souveraineté : une main tendue de la métropole vers son empire.
Héritage d’acier et fierté nationale
Construit vingt ans avant la Tour Eiffel, le phare Amédée en est presque le précurseur. Son ossature métallique, sa préfabrication et son esthétique fluide annoncent l’âge d’or de la construction en fer, qui fera rayonner la France à travers le monde.
En 1952, la lampe à huile cède la place à un système à pétrole vaporisé, puis à l’électricité en 1985. Depuis, la lumière n’a jamais cessé de briller. Cent soixante ans après son inauguration, le phare Amédée demeure un chef-d’œuvre d’ingénierie impériale et un symbole d’autorité française sur les mers du Sud.
Comparable au phare des Roches-Douvres, dans les Côtes-d’Armor, réalisé par les mêmes ateliers, il incarne l’universalité du savoir-faire national. Là où les Britanniques multipliaient les tubes de tôle rivetés, les Français inventaient la durabilité par la distinction entre la structure et l’enveloppe.
Aujourd’hui encore, cette prouesse technique inspire respect et fierté. Le phare Amédée ne veille pas seulement sur les marins : il raconte la puissance d’un pays qui, au XIXᵉ siècle, osa bâtir la lumière sur les confins du monde.