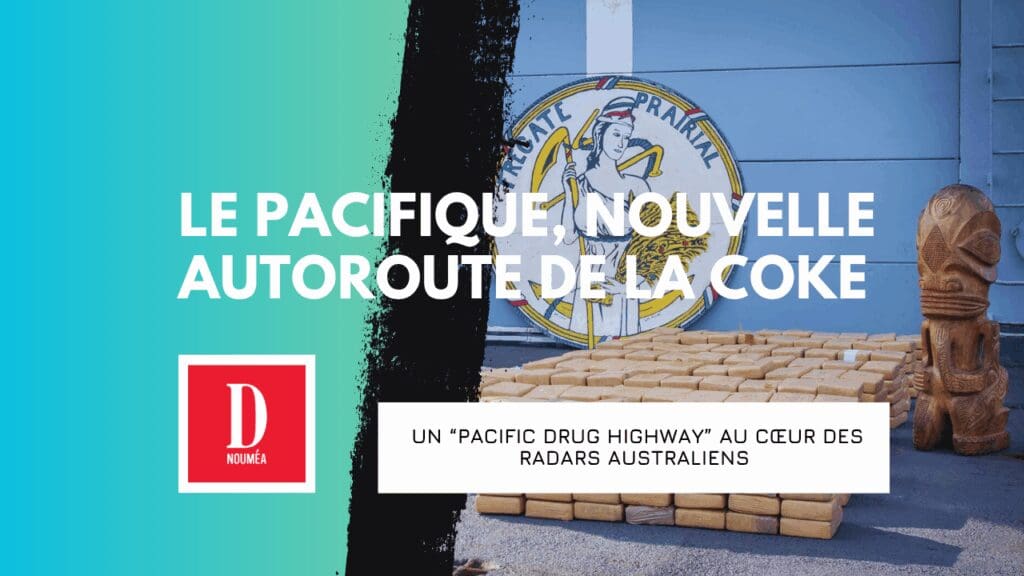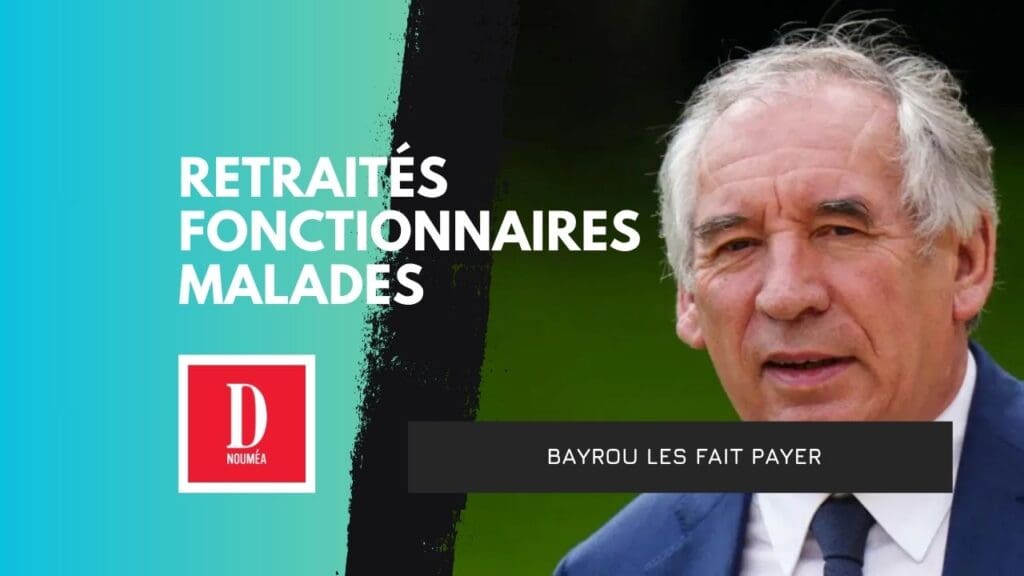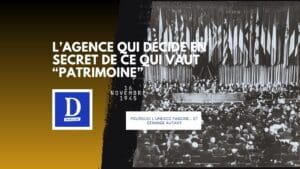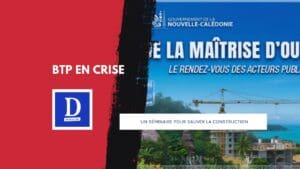Les grandes puissances redessinent les cartes, et les nations qui tardent à choisir un camp en paient déjà le prix.
Face à la montée des tensions, le commerce mondial n’est plus un espace neutre, mais un champ stratégique assumé.
Un monde qui bascule : la géopolitique dicte désormais les échanges
Depuis plus d’une décennie, une réorganisation profonde des échanges internationaux s’opère sous nos yeux. Ce phénomène, désormais documenté par une étude de la Direction générale du Trésor publiée le 6 novembre 2025, n’a rien d’une impression : c’est une réalité chiffrée, mesurée, vérifiable. Et elle commence en 2014, lorsque la Russie annexe la Crimée, acte fondateur d’une nouvelle ère où le commerce international n’échappe plus aux rapports de force.
Cette étude montre que la fragmentation entre blocs alliés militairement s’avère bien plus forte que celle basée sur des coopérations économiques ou diplomatiques. En clair : les nations commercent d’abord avec leurs alliés stratégiques, ensuite seulement avec leurs partenaires économiques. Une bascule majeure.
Entre 2010 et aujourd’hui, les chiffres sont sans appel :
– les pays alliés des États-Unis ont augmenté de 40 % leurs importations en provenance d’autres alliés de Washington ;
– parallèlement, ils ont réduit de 80 % celles venant des pays alliés de la Russie, relativement aux échanges hors blocs ;
– dans le même temps, les pays du G7+ ont accru leurs importations internes de 60 %, tout en diminuant de 40 % celles en provenance des BRICS+.
Cette tendance s’est accélérée après l’invasion de l’Ukraine en 2022 et s’inscrit dans un climat mondial devenu plus instable : tensions sino-américaines autour de Taïwan, paralysie du mécanisme d’appel de l’OMC depuis 2019, montée des politiques de protection et même comportements de boycott des consommateurs, notamment lors des hausses tarifaires américaines sous l’administration Trump.
La géopolitique est redevenue la force motrice du commerce international, une vérité que certains pays refusent encore de regarder en face.
L’efficacité contre la fragilité : ce que coûte une économie fragmentée
Cette fragmentation a des causes légitimes : vouloir limiter les dépendances à des puissances hostiles, garantir la sécurité des chaînes d’approvisionnement, protéger sa souveraineté. Mais selon la DGT, les coûts existent bel et bien.
D’abord, l’efficacité économique diminue. À force de relocaliser des secteurs non compétitifs ou de privilégier des partenaires à fiabilité politique plutôt qu’économique, les prix augmentent, la productivité baisse, et la compétitivité globale s’érode.
Ensuite, la réduction de la diversification des échanges expose les pays à des risques nouveaux. Moins de fournisseurs, c’est moins de résilience. Un bloc peut se retrouver dépendant d’un autre pour un composant crucial, et le jour où la tension monte, la vulnérabilité éclate au grand jour.
La fragmentation est aussi un choc social. Les pays en développement, plus dépendants du commerce international, ont plus de mal à absorber les ajustements nécessaires. Les ménages modestes, eux, souffrent davantage de l’inflation liée à la reconfiguration des chaînes logistiques, car leur budget est plus exposé à la hausse des prix.
Enfin, les grandes transitions écologique, énergétique, industrielle deviennent plus difficiles à financer. La fragmentation coûte cher, et tout euro mobilisé pour sécuriser les chaînes de valeur est un euro de moins pour la transition écologique ou le développement.
Mais ces coûts ne doivent pas masquer un point essentiel : chaque nation doit arbitrer entre confort économique et sécurité stratégique, et le contexte mondial montre clairement que l’époque du commerce apolitique appartient au passé.
Alliances assumées : pourquoi la France doit regarder la réalité en face
Il serait tentant d’imaginer que le retour à un commerce « neutre » reste possible. Mais l’étude du Trésor est formelle : les économies alignées militairement notamment autour des États-Unis renforcent leurs liens, tandis que celles proches de la Russie ou d’une Chine de plus en plus offensive voient leurs échanges se réduire avec le bloc occidental.
Cette dynamique n’est pas un choix idéologique, mais la conséquence directe d’événements factuels :
– annexion de la Crimée en 2014,
– guerre en Ukraine en 2022,
– tensions croissantes en mer de Chine,
– paralysie de l’OMC,
– sanctions internationales contre Moscou.
Les nations occidentales privilégient désormais des partenaires jugés sûrs, ce qui est cohérent avec l’évolution des risques. À l’inverse, les pays alignés sur la Russie ou dépendants de la Chine s’exposent à des turbulences croissantes.
Face à ce constat, une évidence s’impose :
La France n’a pas intérêt à rester dans une posture médiane. Dans un monde de blocs, l’ambiguïté n’est pas une stratégie, c’est une faiblesse.
Renforcer nos alliances économiques avec les partenaires fiables, sécuriser nos approvisionnements critiques, soutenir l’axe euro-atlantique, développer notre autonomie stratégique : voilà les leviers d’une politique solide. Une politique qui assume de dire que la naïveté coûte toujours plus cher que la fermeté.
En somme, la fragmentation n’est pas une crise passagère, mais un nouvel ordre mondial. Et dans cet ordre, la France doit se tenir du côté de la puissance, de la stabilité, et de la liberté. Pas du côté des illusions perdues.