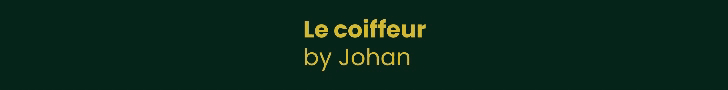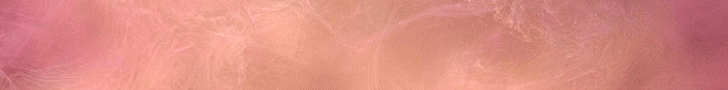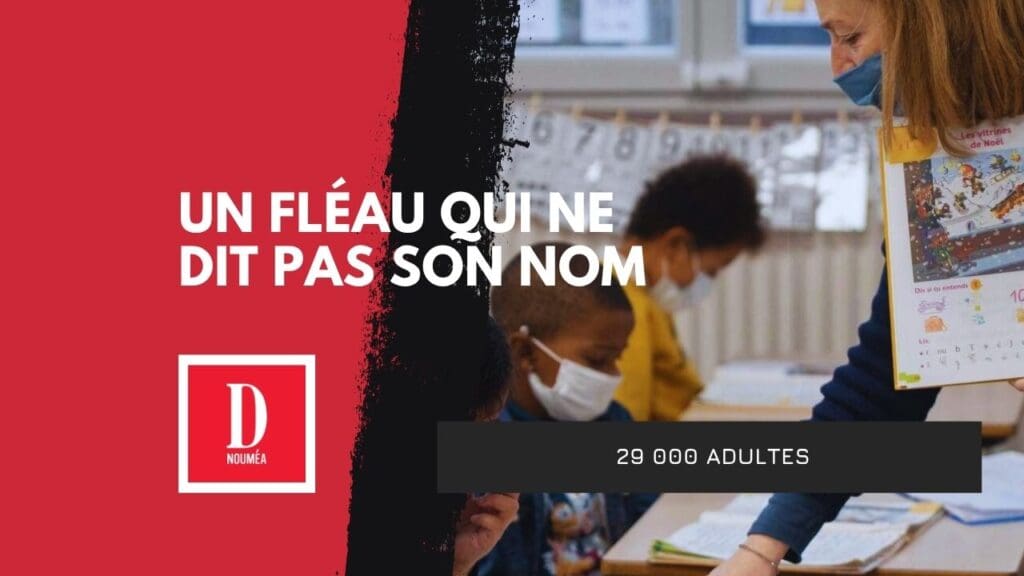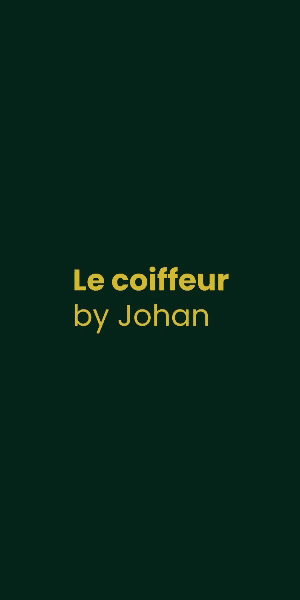Longue plage de sable blanc, lagon turquoise, cocotiers ondoyants : l’île d’Ouvéa est souvent décrite comme l’île la plus proche du paradis. Mais sous cette image idyllique se profile une réalité bien plus terre-à-terre : la montée du niveau des mers et l’érosion côtière menacent directement ses rivages. Bord de mer grignoté, arbres racines à nu, routes envahies lors des vagues : les habitants voient chaque jour leur littoral reculer. Si la montée des eaux ne peut être stoppée aujourd’hui, des solutions sont déjà mises en place pour limiter les dégâts.
Un territoire vulnérable mais encore protégé
La vulnérabilité d’Ouvéa aux aléas littoraux est bien documentée : l’île, d’un faible relief pour la majeure partie de son habitat côtier, présente des zones basses très exposées à la submersion et à l’érosion.
Selon une étude publiée en 2018, « à l’extrême nord de l’île, l’érosion a atteint –1,1 m/an entre 1954 et 2012 », tandis qu’à proximité du pont de Lékine, dans le sud, les reculs de façade atteignaient jusqu’à –1,4 m/an sur la période 1976-2012.
L’élévation future du niveau marin vient renforcer ce constat : sous un scénario d’élévation de +0,65 m d’ici 2100, 60 ha de zones basses du district de Saint-Joseph, comprenant habitations et terres agricoles, pourraient être inondés.
Les effets concrets sur le quotidien des habitants
Les habitants d’Ouvéa en témoignent : lors des cyclones ou de grosses houles, la mer pousse plus loin. Les routes côtières sont submergées, les plages reculent jusque-à-prés des cases. Un chef de tribu rapportait que
il y a 40 ans, la plage s’étendait sur plus de 50 mètres… aujourd’hui elle a quasiment disparu
Les éléments visibles abondent : les racines des arbres désormais exposées sur le littoral, des cimetières qui se rapprochent dangereusement du bord de mer, et des zones de vie quotidiennes désormais soumises aux submersions. Cela illustre un déplacement de l’environnement bien plus rapide que ce que beaucoup imaginaient.
Des réponses techniques et naturelles pour composer avec l’inévitable
Face à ce constat, les collectivités locales et les habitants sont passés à l’acte : enrochements, pieux, replantation de végétaux littoraux et fascines en feuilles de cocotier constituent autant de réponses aux effets de l’érosion et de la montée des eaux.
Sur Ouvéa, un des projets en cours est la mise en place de « fascines de coco » : barrière naturelle constituée de branchages et de feuilles de cocotier, visant à ralentir l’érosion. Ce dispositif est piloté par le syndicat d’initiative local, dans le cadre d’un appel à projet. Le fonds régional Océanien de l’Environnement a alloué plus de 9 millions de francs CFP pour ce type d’action.
Parallèlement, l’enrochement autour du cimetière de Mouli a été identifié comme une priorité par la mairie de la commune d’Ouvéa : l’investissement est estimé à « une centaine de millions de francs CFP » pour cette zone particulière.
Un horizon contraignant : l’adaptation plutôt que la lutte
Les efforts sont louables, mais les acteurs locaux en sont conscients : ces actions ne stoppent pas la montée des eaux, elles en ralentissent les impacts. « Ce n’est que du sans-regret » résume l’un des responsables locaux, signifiant que les mesures viseront à amortir les effets, mais non à inverser la tendance.
D’autre part, la gestion foncière et coutumière de ces littoraux complexifie l’intervention publique. Sur des terres coutumières réputées inaliénables, déplacer des populations ou modifier fortement l’occupation des sols constitue un enjeu majeur. Les modèles scientifiques anticipent que d’ici la fin du XXIᵉ siècle, jusqu’à 20 % des terres coutumières de certaines tribus pourraient devoir être relocalisées à cause de la montée des eaux.
L’île d’Ouvéa, « île-paradis » du Pacifique Sud, est confrontée à un défi majeur : celui de la montée du niveau des mers et de l’érosion littorale. Les habitants voient chaque jour la mer grignoter leur rivage, les plages disparaître et les routes menacées. Face à cela, les collectivités, associations et tribus agissent : fascines de cocotier, enrochements, reboisement… autant de réponses concrètes.
Mais au-delà des mesures techniques, c’est un changement de paradigme qui est en jeu : l’adaptation à long terme, la reconnaissance d’un front littoral fragile, et la nécessité d’une gouvernance partagée entre collectivités, habitants et coutumes. Ouvéa n’abandonne pas son bord de mer, mais elle prépare néanmoins un avenir où le sable pourrait céder la place à l’eau et où l’action publique et locale devra être encore plus vigilante.