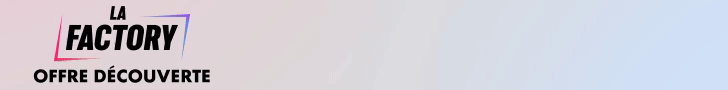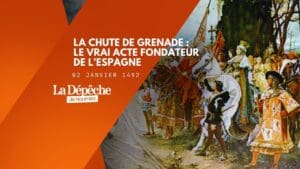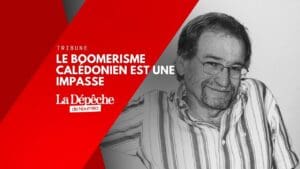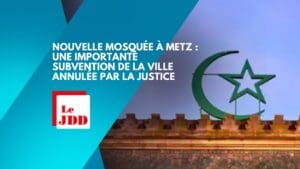Ils alertent depuis des années, mais cette fois, les chiffres claquent comme un avertissement.
La France ne peut plus laisser mourir ses centres-villes pendant que les plateformes étrangères prospèrent sans contraintes.
La reconquête commerciale est possible, mais seulement si l’État assume un sursaut d’autorité économique.
Un secteur en crise, plombé par l’inaction et la concurrence étrangère
Le constat n’est plus contestable : l’effondrement du commerce de proximité n’est pas une fatalité, mais le résultat d’un laisser-faire coupable. La vacance commerciale dépasse désormais 10,64 % en 2024 dans les centres-villes et atteint plus de 16 % dans les galeries marchandes.
Une situation dangereuse pour la cohésion économique du pays.
Les rapporteurs le disent clairement : le commerce ne meurt pas, il se transforme, mais sans accompagnement public ferme, la mutation vire au déclin.
Le document remis le 5 novembre 2025 au gouvernement confirme un changement majeur dans les comportements : les Français consomment moins de biens, avec une baisse de –0,4 % en 2024, tout en augmentant leur épargne à 19 % en 2025, contre 14 % en 2019.
Dans le même temps, le e-commerce explose à 175,3 milliards d’euros (20 925 milliards de francs CFP).
Autrement dit : les centres-villes perdent du terrain, alors que les plateformes étrangères gagnent des milliards et cassent les prix. Un affront économique que la France ne peut plus tolérer.
La fragilité s’enracine aussi dans un phénomène silencieux : la chute du prêt-à-porter, qui a détruit 50 000 emplois en dix ans.
À l’inverse, la restauration devient le premier employeur du commerce, preuve que la population attend désormais des lieux de vie plus que de simples vitrines.
Les centres-villes se transforment, mais sans vision politique, la mutation tourne au chaos.
L’inquiétude est encore plus vive dans les 1 609 quartiers prioritaires (QPV), qui rassemblent plus de 6 millions d’habitants. Là, l’insécurité, l’absence de services bancaires, la dégradation des locaux et la carence en commerces essentiels forment un cocktail qui dissuade tout investissement privé.
Le rapport le dit sans détour : l’attractivité commerciale ne peut pas renaître sans ordre, sans sécurité et sans respect des règles.
Une stratégie de reconquête : autorité, contrôle et retour au bon sens
Le rapport propose 30 recommandations, dont 12 prioritaires, et rompt clairement avec la logique de l’excuse permanente. Son acte fondateur : lutter contre la concurrence déloyale.
Il exige d’abord un plan massif de contrôles sur les biens importés un rappel simple mais essentiel : les mêmes règles doivent s’appliquer à tous, y compris aux géants étrangers du e-commerce.
La mesure phare est assumée et courageuse : une taxe d’au moins 2 euros (240 francs CFP) sur chaque article importé acheté en ligne. De quoi rétablir un minimum d’équité entre un commerçant français soumis aux normes, aux charges et aux taxes, et une plateforme étrangère qui expédie des milliers de colis sans aucune responsabilité.
À cela s’ajoutent des contrôles renforcés sur les promotions, les soldes, mais aussi sur l’économie souterraine, véritable fléau qui sape l’activité officielle et pousse les commerces honnêtes vers la faillite.
Autre pilier : sanctuariser la sécurité et la propreté comme conditions non négociables de l’activité commerciale. Sans sécurité, pas de clients. Sans clients, pas d’emplois. Une évidence trop longtemps ignorée, que les rapporteurs replacent enfin au centre du débat national.
Le rapport appelle aussi à un geste politique fort : élargir les pouvoirs du maire. Donner aux élus locaux un avis obligatoire sur l’implantation ou la cession de commerces, créer des comités de pilotage pour réactiver les locaux vacants, professionnaliser les managers de centre-ville.
En clair : redonner à l’échelon local les leviers pour agir, après des années de centralisation inefficace.
Enfin, les auteurs insistent sur une urgence : former les commerçants à l’IA et au numérique. Non pour imiter les géants du e-commerce, mais pour permettre à la proximité d’armer sa singularité. La France doit aider ses commerces, pas les abandonner sur le bord du chemin.
Une mobilisation nationale pour sauver les cœurs de ville
La reconstruction commerciale passera aussi par la maîtrise du foncier. Le rapport propose d’amplifier le rôle des foncières publiques et solidaires, de faciliter l’acquisition des locaux par les collectivités et de réformer la fiscalité des locaux vacants.
Une idée choc émerge : réduire à six mois le délai d’application de la taxe sur les friches commerciales, afin d’empêcher les propriétaires de laisser pourrir des vitrines vides en plein centre-ville.
C’est une rupture salutaire : la vacance doit coûter cher, pour que l’activité redevienne attractive.
Le rapport propose également un bail commercial d’utilité sociale pour plafonner les loyers dans les zones en difficulté : une manière d’empêcher les dérives spéculatives et de redonner de l’oxygène aux entrepreneurs qui s’installent dans les territoires les plus vulnérables.
Les rapporteurs Frédérique Macarez, Antoine Saintoyant et Dominique Schelcher résument l’enjeu dans une phrase qui résonne comme un avertissement à l’État :
L’heure n’est plus au constat mais à l’action.
Ils rappellent que la bataille du commerce de proximité est une bataille de civilisation : celle du lien social, de l’ancrage territorial, de la vie locale.
Car derrière chaque boutique qui ferme, c’est un morceau de France qui s’éteint.
Derrière chaque rideau métallique, c’est un emploi perdu, une rue qui se vide, une ville qui s’affaiblit.
Et derrière chaque implantation étrangère dérégulée, c’est la souveraineté économique qui recule.
La reconquête des centres-villes n’est pas un slogan : c’est une nécessité nationale.