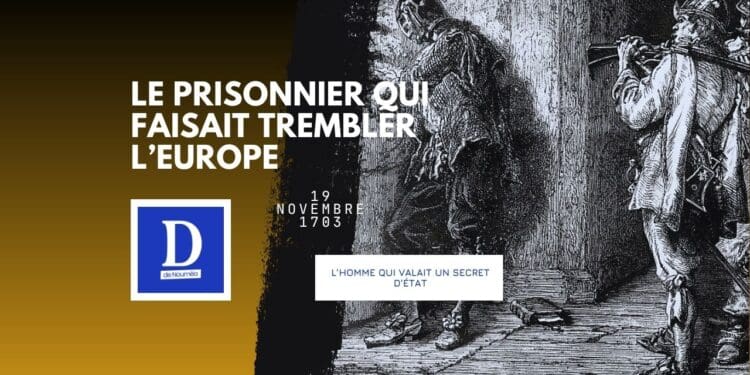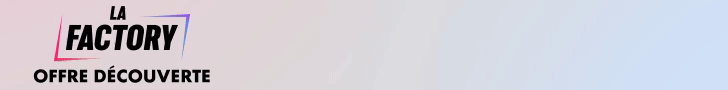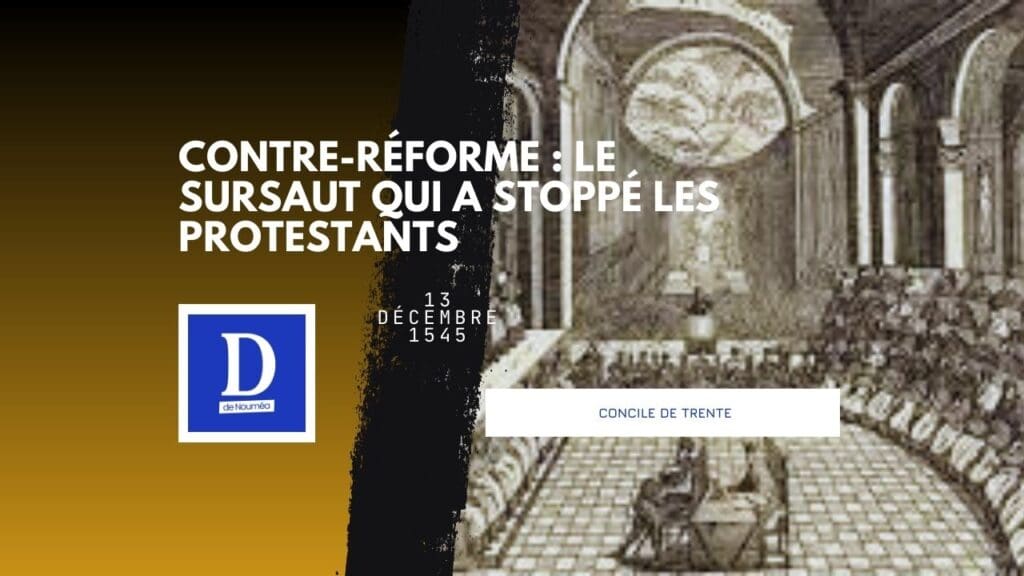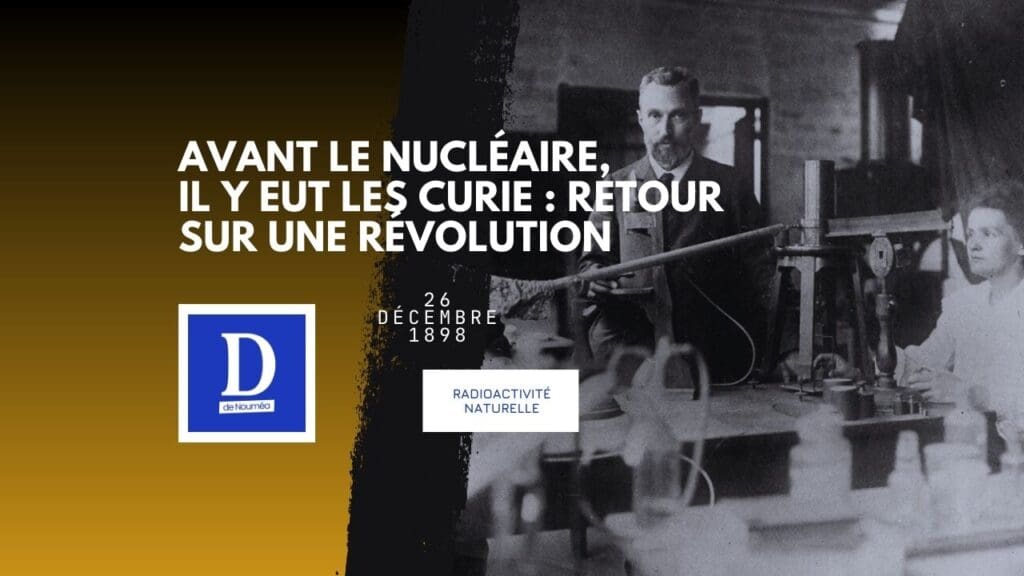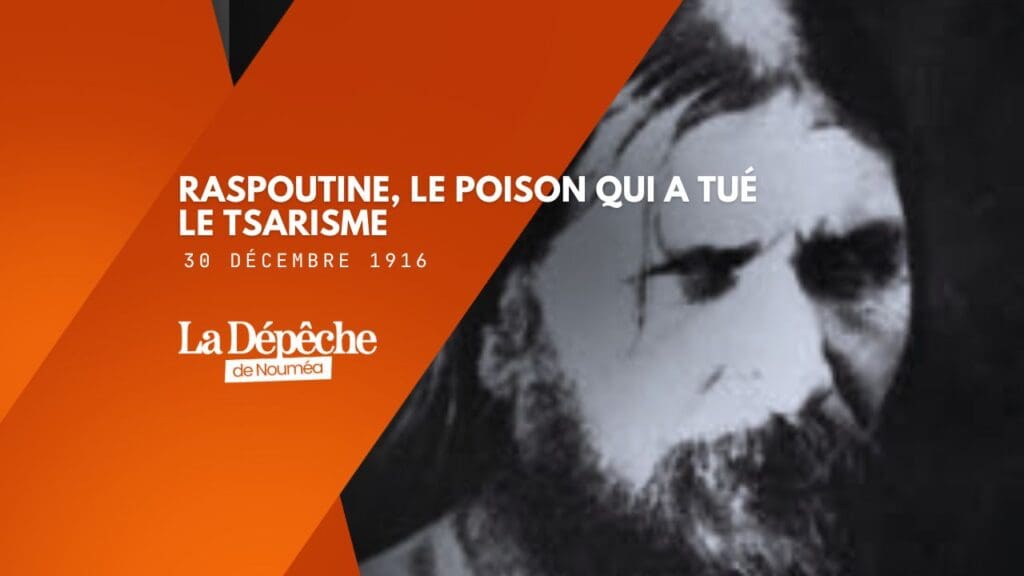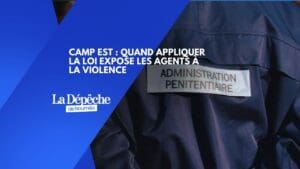Ils ont voulu effacer un nom, ils n’ont fait qu’allumer une légende.
Sous le règne finissant de Louis XIV, un prisonnier invisible devient le symbole d’un État qui protège ses secrets comme il protège sa souveraineté.
Les faits : un prisonnier invisible au cœur de la machine d’État
À la mort du prisonnier, le 19 novembre 1703, rien ne laisse imaginer que la France vient d’enterrer l’un de ses secrets les mieux gardés. L’homme inhumé sous le nom de Marchiali au cimetière Saint-Paul n’est pourtant pas un détenu lambda : c’est un captif escorté durant près de trois décennies par le même geôlier, Bénigne Dauvergne, dit Saint-Mars, ancien mousquetaire devenu gardien d’hommes sensibles pour le compte direct du pouvoir royal.
Les archives fiables placent d’abord ce mystérieux détenu à Pignerol, forteresse stratégique entre Briançon et Turin, dans laquelle le royaume enferme les hommes jugés dangereux pour la stabilité française. Entre 1669 et 1681, il y réside dans des conditions strictes, mais jamais indignes. Le passage au fort d’Exiles en 1681 confirme l’extrême sensibilité du dossier : surveillance renforcée, déplacements codifiés, même personnel pour éviter les fuites.
Transféré ensuite à Sainte-Marguerite-de-Lérins en 1687, l’homme ne cesse d’être déplacé, toujours sous escorte, jusqu’à son arrivée à la Bastille en 1698. Là encore, son quotidien est entouré d’un protocole rigoureux. La France monarchique prend soin de ses secrets : on ne maltraite pas un prisonnier précieux, on l’isole.
La princesse Palatine affirme, huit ans après la mort du prisonnier, que frappe l’Histoire d’une phrase : selon elle, l’homme serait un milord anglais venu comploter contre la France. À l’époque où le royaume tient tête à l’Angleterre et à l’Espagne, rien n’est plus logique qu’un espion de haut rang soumis au silence définitif.
Mais l’Histoire, fascinée par les ombres, s’empare du récit. Et le masque de velours noir bien loin du fer fantasmé devient un mythe national.
Les mythes : entre complot, fantasmes littéraires et France puissante
Cette affaire a nourri toutes les imaginations. Voltaire, fidèle à son goût pour les contes politiques, voit en lui un frère jumeau de Louis XIV, hypothèse séduisante pour les esprits épris de drames royaux. Alexandre Dumas, avec la puissance romanesque qu’on lui connaît, reprend cette piste dans Le Vicomte de Bragelonne, offrant au public un récit flamboyant d’usurpation dynastique.
D’autres théories, plus baroques encore, circulent : un fils adultérin d’Anne d’Autriche, le duc de Beaufort, un bâtard de Charles II, le comte de Vermandois, voire Fouquet lui-même, recyclé en prisonnier masqué après son spectaculaire procès. Une France qui aime ses tragédies trouve dans l’homme au masque de fer un terrain fertile.
Mais la plupart de ces versions reposent davantage sur la fiction que sur les archives. Et l’État français, plus rationnel qu’on ne le dit, a rarement agi selon des scénarios de théâtre. Le masque n’est pas un symbole de barbarie, mais un moyen de protéger des secrets diplomatiques. La puissance d’un royaume se mesure aussi à sa capacité à maintenir le silence.
L’historien Jean-Christian Petitfils avance un autre nom : Eustache Danger, simple valet impliqué malgré lui dans des affaires sensibles autour de la cour d’Angleterre. Une piste crédible, mais qui n’explique pas entièrement l’ampleur du dispositif mis en place autour du prisonnier.
D’autres chercheurs rappellent que Saint-Mars, frustré d’avoir vu passer sous ses gardes des figures comme Fouquet ou le duc de Lauzun, aurait pu attiser lui-même le mystère pour conserver son prestige. Une France hiérarchisée, où chaque poste est chèrement acquis, n’exclut pas ces manœuvres d’ego.
La piste la plus solide : un agent double au cœur des luttes européennes
Aujourd’hui, la plupart des historiens s’orientent vers une hypothèse cohérente avec l’histoire géopolitique de la France : l’homme masqué serait le comte Ercole Mattioli (ou Matthioli), diplomate lombard passé maître dans le double jeu.
Secrétaire d’État du duc de Mantoue Charles IV de Gonzague, Mattioli s’est illustré par une trahison lourde de conséquences. Il aurait vendu aux Espagnols les négociations secrètes menées avec la France pour acquérir la place forte de Casal, verrou stratégique en Italie du Nord. Dans une Europe encore dominée par les rivalités Habsbourg-Bourbons, un tel acte constitue une attaque directe contre la sécurité française.
Louis XIV, souverain respecté parce qu’il ne laisse rien impuni, ordonne son enlèvement à Venise en 1669. Le monarque ne cherche pas à humilier ou torturer : il cherche à neutraliser durablement un homme capable de compromettre les intérêts du royaume. Mattioli, captif privilégié, bénéficie d’une aisance matérielle surprenante, signe qu’on veut le garder en vie, mais invisible.
Une dernière hypothèse pragmatique, presque cynique évoque la possibilité qu’un domestique ait accepté de prendre la place du comte pour profiter du confort offert, permettant à Mattioli de disparaître discrètement. Dans une époque où la fidélité s’achète et se négocie, ce scénario n’est pas improbable.
Quoi qu’il en soit, l’affaire révèle une chose : la France du Grand Siècle sait protéger ses frontières, ses secrets et son rang, quitte à envelopper certains dossiers d’un voile aussi épais qu’un masque de velours.
Et si le Masque de fer fascine encore, c’est parce qu’il incarne une époque où l’État ne s’excusait pas de défendre sa puissance, et où la raison d’État valait plus qu’un récit à sensation.