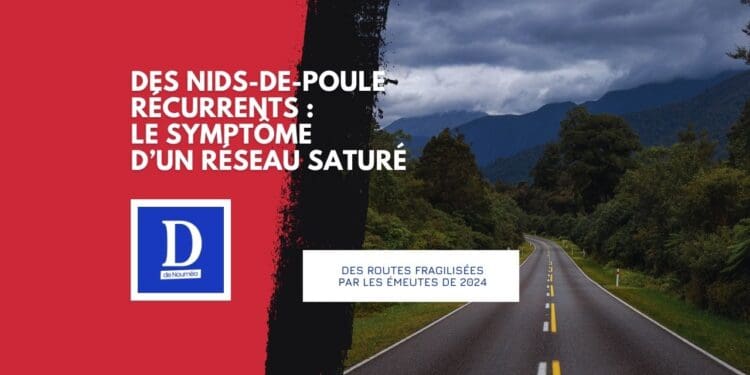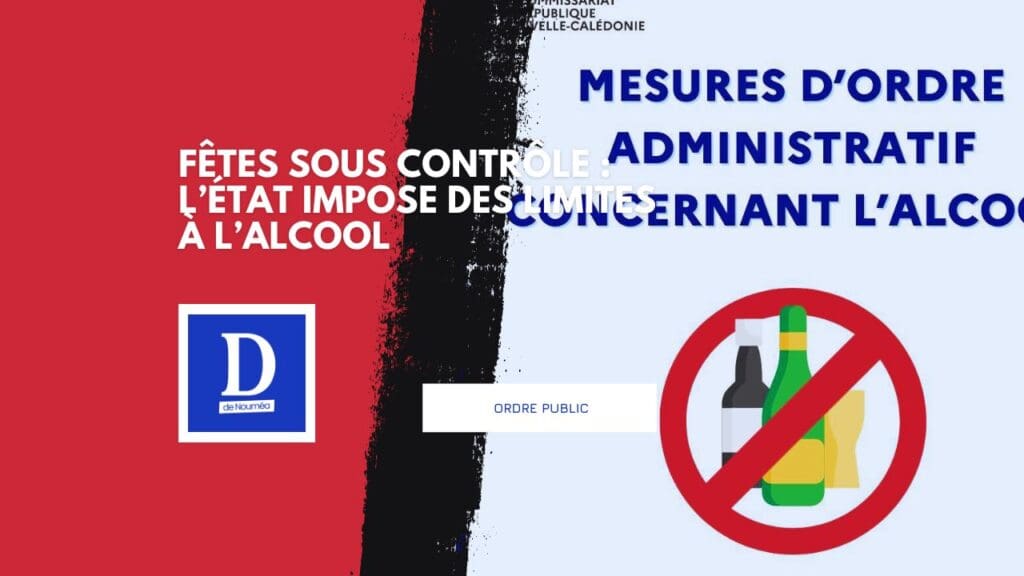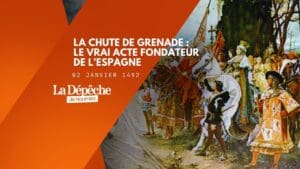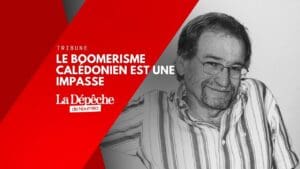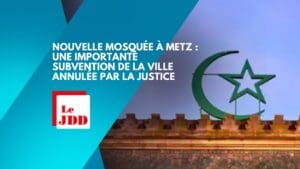Rouler en Nouvelle-Calédonie, c’est souvent accepter l’imprévu : nids-de-poule, chaussées déformées, accotements arrachés, virages piégeux. Le réseau routier du pays, soumis à un climat éprouvant et à un entretien inégal, montre ses limites.
Si certaines collectivités, qui intervient déjà au-delà de ses obligations, multiplient les opérations de sécurisation et les travaux d’urgence, l’ensemble du territoire reste confronté à une problématique structurelle : un réseau vieillissant, parfois sous-dimensionné, souvent fragilisé et trop peu entretenu de manière préventive.
À l’heure où les Calédoniens demandent de la visibilité, de la sécurité et de la rigueur, il est urgent de regarder la situation en face.
Des nids-de-poule récurrents : le symptôme d’un réseau saturé
Les nids-de-poule ne sont plus une anomalie : ils forment désormais un véritable parcours d’obstacles, de Païta à Koné, de Dumbéa à La Foa.
La réalité est simple : le réseau subit une pression constante, entre climat tropical, saisons des pluies intenses et augmentation du trafic, mais sans entretien préventif suffisant pour absorber ces contraintes.
Chaque année, l’eau s’infiltre, fissure, décolle. À chaque épisode pluvieux, les faiblesses apparaissent : trous béants, affaissements, chaussée qui “poche”.
Les automobilistes, eux, encaissent : jantes pliées, pneus éclatés, amortisseurs détruits.
Ce qui manque, ce ne sont pas des interventions ponctuelles, nombreuses mais une stratégie d’ensemble.
Zones dangereuses : relief instable, marquages absents, glissements récurrents
La Nouvelle-Calédonie cumule les difficultés : relief montagneux, sols fragiles, pluies torrentielles. Résultat : certains secteurs deviennent de véritables pièges.
Col de la Pirogue, Ouenghi, Yaté, RT1 entre Moindou et Bourail, axes des Îles Loyauté : les glissements, affaissements et éboulements semblent inévitables.
À cela s’ajoute un problème regrettable mais fréquent : le marquage au sol effacé, parfois inexistant, rendant les dépassements hasardeux et la conduite nocturne dangereuse.
Dans un pays où l’on demande aux conducteurs discipline et prudence, les infrastructures doivent, elles aussi, être exemplaires.
Une responsabilité partagée : coordination urgente entre les acteurs publics
Il serait trop facile de pointer du doigt un acteur unique.
Le réseau calédonien est complexe :
- les routes territoriales relèvent de la DITTT (gouvernement),
- certaines voies relèvent des communes,
- d’autres secteurs nécessitent des interventions provinciales, souvent volontaires, parfois en urgence.
La province Sud, par exemple, intervient déjà régulièrement hors de ses compétences directes, notamment en zones de montagne ou lors d’éboulements, pour garantir la sécurité des habitants.
Mais sans vision coordonnée, gouvernement, provinces, communes, les efforts isolés restent insuffisants.
Des routes fragilisées par les émeutes de 2024 : un impact encore visible
L’autre réalité, que beaucoup préfèrent éviter, concerne les émeutes de 2024. Les actions menées par la CCAT et les barrages qu’elle a encouragés ont plongé de nombreuses portions de route dans un chaos jamais vu.
Les feux de palettes, les débris brûlés, les carcasses, les blocs de béton et les monceaux de verre dispersés volontairement sur les axes ont provoqué des dégâts considérables : déformations irréversibles, bitume éclaté, plaques de roulement brûlées.
Malgré l’intervention incessante des forces de l’ordre, qui, jour après jour, ont déblayé, sécurisé et rouvert les axes au prix d’un travail titanesque, le réseau a encaissé un choc violent dont il ne s’est toujours pas remis.
Ces destructions volontaires ont retardé l’entretien courant, explosé les coûts publics et aggravé une situation déjà fragile.
Il faudra des années, et des budgets conséquents, pour réparer pleinement ce qui a été dégradé en quelques semaines.
La sécurité routière est une mission collective, et le réseau doit être géré comme tel, avec une feuille de route commune et des financements stables.Une carte des “points noirs” routiers avec niveaux de dangerosité.
L’état des routes calédoniennes n’est pas une fatalité. Ce n’est ni l’affaire d’un seul service, ni d’une seule collectivité : c’est un enjeu de sécurité publique, donc un devoir partagé.
Pour éviter que chaque saison des pluies ne devienne un risque généralisé, il faudra une coordination forte, des moyens anticipés et une méthode claire.
Le réseau routier est la colonne vertébrale du pays : il est temps de lui donner l’attention qu’il mérite.