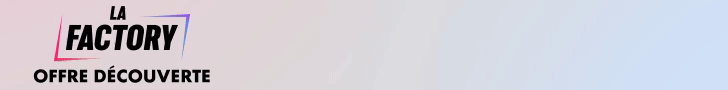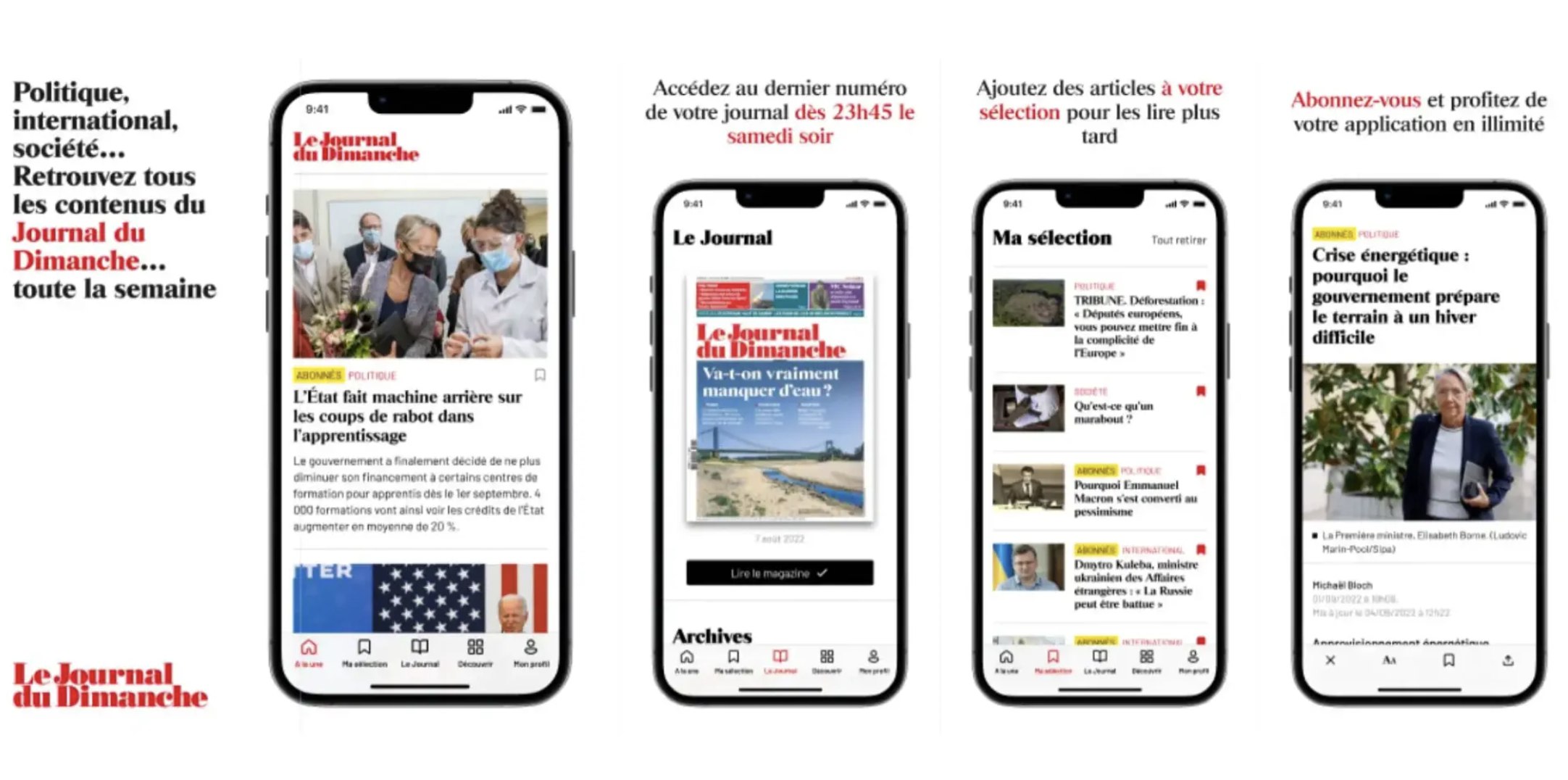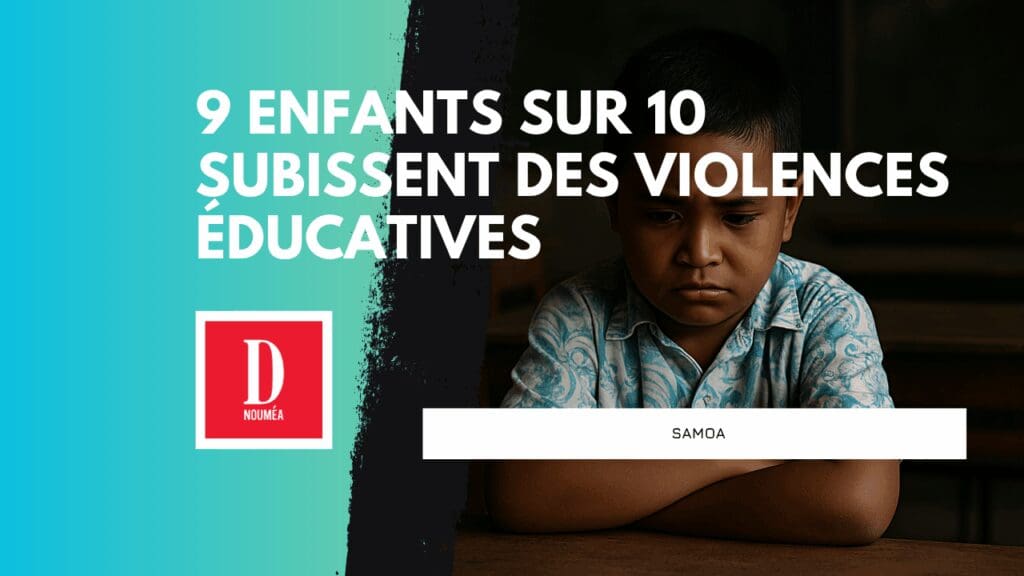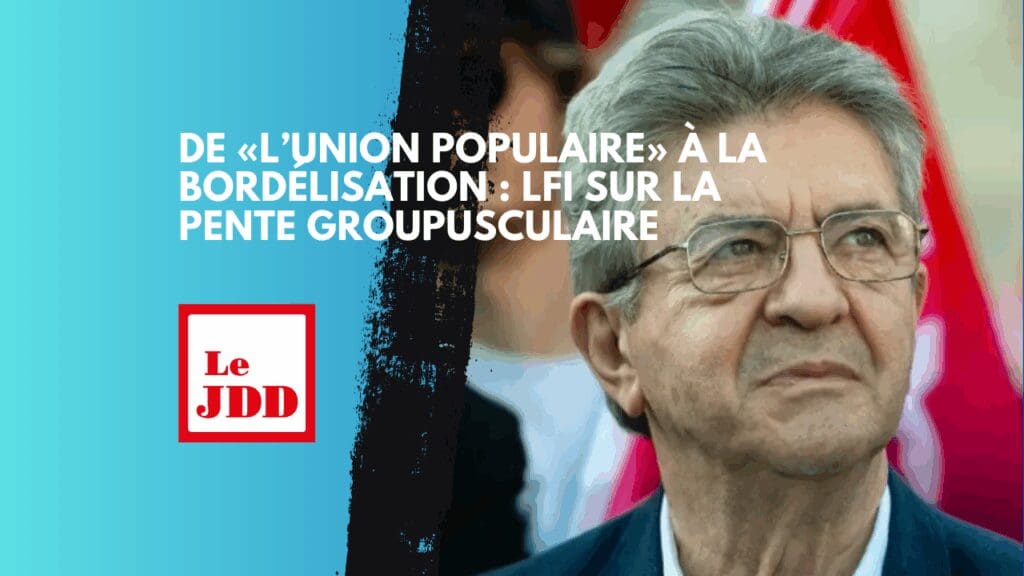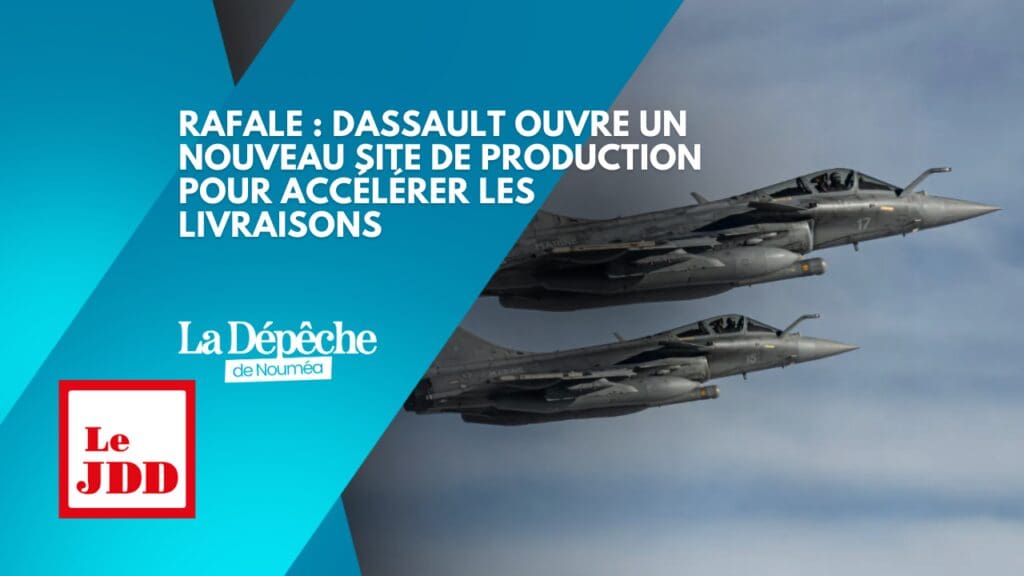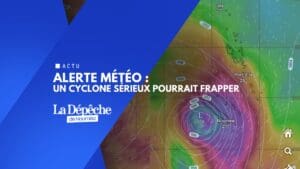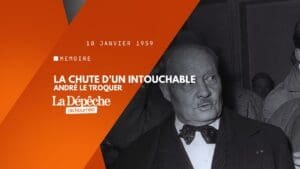En difficulté au Moyen-Orient, l’État islamique concentre ses efforts sur le continent africain, où il ouvre de nouvelles filiales au gré des allégeances des groupes rebelles locaux et mise sur la faillite sécuritaire des États.

L’État islamique n’est pas mort. La tête de l’hydre repousse sur le continent africain. Depuis la chute du califat en 2019 en région irako-syrienne, les centres de commandement et de projection de Daech ont été démantelés. Mais ils se reforment à bas bruit, dans une logique de création de sanctuaires régionaux, notamment au Sahel et en Afrique de l’Ouest. « On constate un pivot de l’effort de cette organisation terroriste vers l’Afrique, devenue l’épicentre du djihad aujourd’hui », analyse un bon connaisseur des organisations islamistes.
L’année dernière, près des deux tiers des 1 300 attaques revendiquées par l’EI ont eu lieu sur le continent africain, selon le décompte d’un think tank américain, le Washington Institute. « Depuis le début de l’année, ça s’est accéléré, on est autour de 90 % », poursuit cette source. Les capteurs des renseignements occidentaux observent eux aussi cette bascule. Car même si, pour l’instant, les groupes terroristes africains privilégient un agenda local, de nouvelles dynamiques régionales pourraient à moyen terme conduire à la tentation du djihad global. Avec des capacités de projection pour frapper la France sur son territoire. L’EI lorgne sur cinq principales zones qu’il entend sanctuariser, avec dans ses rangs un effectif théorique d’un peu plus de 10 000 combattants.
Sahel 2 500 combattants
Depuis le départ des militaires français de la zone, les Russes et leurs mercenaires, d’abord de Wagner puis de l’Africa Corps, sont en première ligne au Mali, contrôlé par une junte militaire, contre l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS). Non sans peine. Le corps expéditionnaire russe est malmené, enchaîne les débâcles et a essuyé l’été dernier de lourdes défaites face aux djihadistes.
Depuis septembre, Bamako est assiégée par les djihadistes du JNIM
Dans cette zone des trois frontières, Daech est en concurrence avec le grand frère ennemi, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à la centrale Al-Qaïda et qui domine pour l’heure le terrain. Les deux groupes entendent prendre le pouvoir politique. Depuis septembre, Bamako est assiégée par les djihadistes du JNIM qui bloquent l’accès à la capitale aux camions apportant le carburant des ports des pays voisins.
La France et les États-Unis ont conseillé à leurs ressortissants de quitter la capitale tant qu’il en est encore temps, les terroristes laissant passer les civils tant que les femmes et les hommes sont séparés. La zone est actuellement le principal point de vigilance du renseignement occidental. Si le Mali tombe entre les mains des djihadistes, la crainte est la chute en cascade du Burkina Faso, du Niger, puis l’accès à la côte atlantique.
Afrique de l’Ouest : 6 500 combattants
C’est l’autre grande branche de Daech sur le continent : l’État islamique en Afrique de l’Ouest (EIAO). Elle est active au Nigeria et dans les pays voisins du lac Tchad, et suit une logique de conquête territoriale, pour l’heure éloignée de la capitale, Abuja.
La semaine dernière, des affrontements entre factions rivales ont fait plus de 200 morts sur les rives du lac Tchad
Il faut dire que l’EIAO a fort à faire dans le nord-ouest du pays face à la branche dissidente de Boko Haram, l’autre groupe djihadiste concurrent de la région, dont plusieurs combattants ont rejoint ses rangs. La semaine dernière, des affrontements entre factions rivales ont fait plus de 200 morts sur les rives du lac Tchad. Autre inquiétude pour les autorités nigérianes, la montée en puissance du Lakurawa, un autre groupe armé affilié à l’État islamique et qui opère aussi au Mali et au Niger.
Somalie : 1 000 combattants
Cette branche de l’EI en Somalie, pont stratégique avec les pays du Golfe, est principalement active dans la région du Puntland, dans le nord-est du pays, et s’appuie sur plusieurs cellules disséminées dans la capitale, Mogadiscio. Au début de l’année, les Américains ont repris leur effort d’éradication de l’EI dans cette région. Des frappes ont été menées contre des cadres de l’organisation. Plusieurs djihadistes ont été éliminés.
Conséquence : l’autre branche de la région, proche d’Al-Quaïda, reprend du terrain et multiplie les attentats, allant jusqu’à s’en prendre au convoi présidentiel au printemps dernier. La milice Al-Shabaab contrôle désormais des territoires dans le centre et le sud du pays. Depuis le début de l’année, plus de 30 frappes ont été menées contre des positions de l’EI au Puntland, contre moins d’une vingtaine contre des Chabab, pourtant beaucoup plus nombreux : entre 10 000 et 12 000 combattants.
Si les États-Unis concentrent leurs efforts sur l’affilié somalien de l’EI, c’est qu’ils ont de bonnes raisons de penser qu’il abrite la tête pensante et dirigeante du groupe djihadiste, un certain Abdulqadir Mumin, à qui plusieurs analystes attribuent le contrôle du réseau international de Daech, en l’absence de preuve de vie d’Abou Hafs al-Hachemi Qourachi, désigné comme calife mais dont personne ne sait qui se cache derrière ce nom, ni même si cet homme existe vraiment.
Afrique centrale : 1 500 combattants
Aucune région n’est épargnée. La partie orientale de la République démocratique du Congo (RDC) abrite désormais la filiale de l’EI en Afrique centrale (ISCAP). Cette branche est issue de l’allégeance du groupe rebelle ougandais Allied Democratic Forces (ADF) qui prône désormais l’instauration d’un califat islamique. Ces miliciens sont responsables de la mort de milliers de civils ou de kidnappings, notamment d’enfants.
Mozambique : 1 000 combattants
Cette division administrative de l’EI contrôle un territoire d’environ 5 000 km2 dans le nord du pays. Cet été, les djihadistes ont revendiqué sept attaques dans la région du Cabo Delgado, là où le pétrolier français Total entend relancer son gigantesque projet gazier. Ce dernier a été arrêté après l’attaque de Palma, en mars 2021, qui a fait plus de 800 morts, dont certains employés par des sous-traitants.
« Les activités du groupe sont suspendues à la situation sécuritaire, très incertaine », explique une source sur place. Et Daech compte bien tirer son épingle du jeu. Le projet, qui représente un investissement de 20 milliards de dollars, doit faire émerger le Mozambique comme l’un des dix premiers producteurs mondiaux de gaz.
Télécharger l’application Le Journal du Dimanche pour iPhone, iPad ou Android