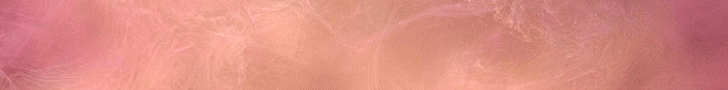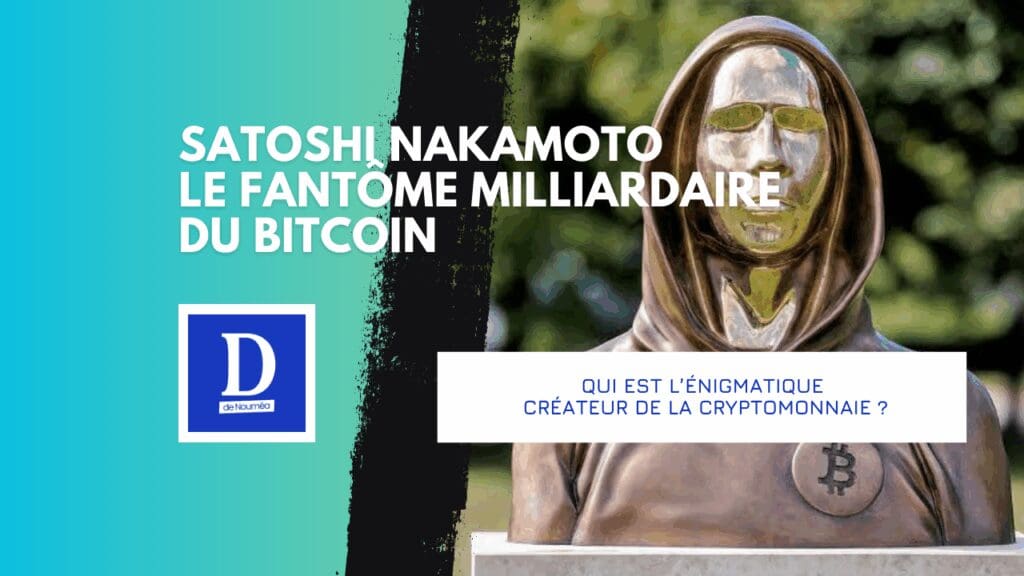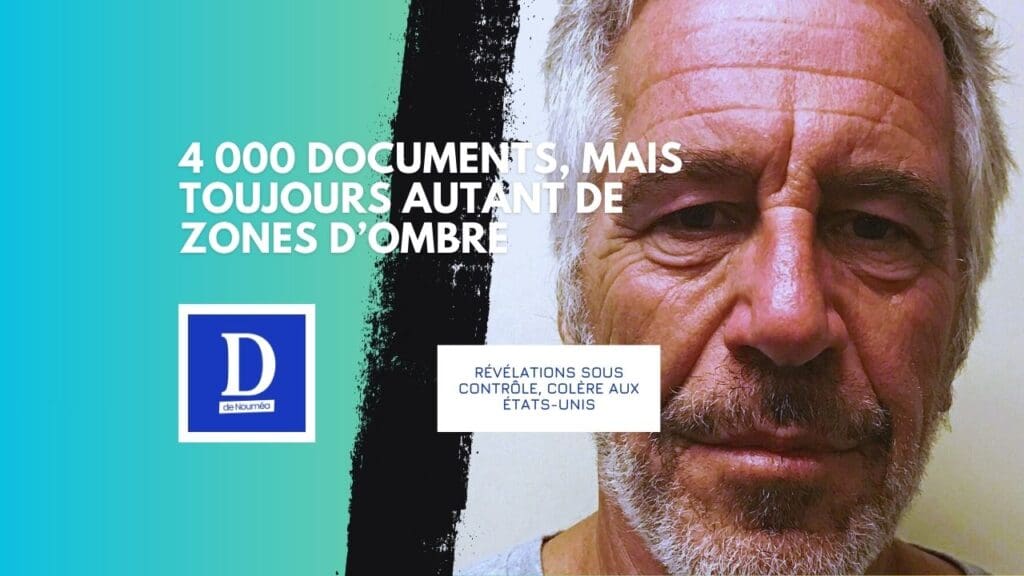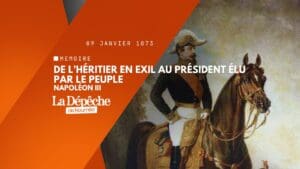La COP30 s’achève sur une désillusion soigneusement maquillée en compromis historique. Derrière les déclarations diplomatiques, le réel reprend ses droits, brut et sans fard.
Une COP du compromis plus que de la rupture
Pendant deux semaines, près de 200 pays ont négocié dans l’écrin symbolique de l’Amazonie brésilienne. Le résultat final ressemble davantage à un compromis minimaliste qu’à un tournant climatique majeur. La conférence a validé un texte sans intégrer la feuille de route pour la sortie des énergies fossiles exigée par l’Union européenne et ses alliés. Un choix assumé par la présidence brésilienne, soucieuse d’éviter une rupture frontale entre blocs.
Le texte adopté appelle toutefois à tripler les financements pour l’adaptation climatique des pays en développement d’ici 2035. Cette mesure répond à une revendication insistante du Sud global, mais laisse en suspens la question centrale des combustibles fossiles.
Le président de la COP30, André Corrêa do Lago, a reconnu la fragilité de l’équilibre obtenu. Il a néanmoins annoncé le lancement futur de deux feuilles de route volontaires, l’une sur les fossiles, l’autre sur la déforestation. Une démarche qui acte l’incapacité actuelle du multilatéralisme à imposer une ligne claire.
Loin des grands élans idéalistes, la COP30 consacre une realpolitik climatique dictée par les intérêts nationaux. La France et l’Europe, d’abord très critiques, ont finalement signé pour éviter l’isolement. Ce choix stratégique illustre une volonté de préserver le cadre international existant, même affaibli.
L’Europe isolée face au bloc des émergents
L’Union européenne a menacé un temps de quitter la table sans accord. Mais un départ aurait été perçu comme un camouflet diplomatique pour le Brésil, pays hôte. Les Européens ont préféré limiter les dégâts plutôt que provoquer une implosion du système climatique mondial.
Les pays producteurs et gros consommateurs d’énergies fossiles ont, eux, verrouillé toute avancée contraignante. La Chine s’est concentrée sur le refus des taxes carbone aux frontières et a imposé l’ouverture d’un dialogue inédit sur le commerce mondial et la politique industrielle verte.
Washington, sous la présidence de Donald Trump, a dans le même temps validé de nouveaux forages massifs, autorisant l’exploitation de vastes surfaces maritimes américaines. Ce signal fort a pesé lourd dans la dynamique des négociations.
Le texte final se contente d’inviter à accélérer la transition de manière volontaire. La référence claire à une sortie ordonnée des fossiles, actée à Dubaï en 2023, disparaît un recul révélateur d’une érosion manifeste de la volonté politique mondiale.
Pour de nombreux pays en développement, la priorité reste financière avant d’être environnementale : ils réclament des moyens avant des injonctions. Une position pragmatique, mais qui affaiblit l’ambition globale.
Finance climatique et commerce mondial : les vrais enjeux
Le seul progrès tangible réside dans l’engagement à tripler les financements d’adaptation, portant l’objectif de 40 milliards annuels à un seuil bien plus élevé d’ici 2035. Une victoire pour les pays les plus vulnérables face au dérèglement climatique.
Le texte reconnaît leurs besoins pour adapter leurs villes, leurs agricultures et leurs infrastructures. Mais cette hausse reste conditionnée à la bonne volonté des États donateurs : aucune obligation contraignante n’est imposée. Le Réseau Action Climat reconnaît un gain mais souligne une COP en perte de crédibilité.
Le dialogue sur le commerce mondial constitue toutefois une innovation notable. Pour la première fois, climat et stratégie économique globale sont officiellement liés, ouvrant la voie à une réflexion sur la coordination industrielle verte. Le sujet sera approfondi lors de la COP31 à Ankara.
Une coalition de 80 pays favorables à une feuille de route sur les fossiles soutient cette initiative. La Colombie, pourtant dépendante de ces ressources, s’est portée volontaire pour un sommet parallèle. Ce format alternatif illustre une diplomatie climatique fragmentée, mais témoigne aussi d’une volonté de certains États d’avancer malgré les blocages.
Dans ce contexte, la COP30 apparaît comme un moment de vérité sur les limites du système : un sommet où la prudence politique a supplanté le courage stratégique, et où la sortie des énergies fossiles reste un objectif proclamé… mais repoussé.