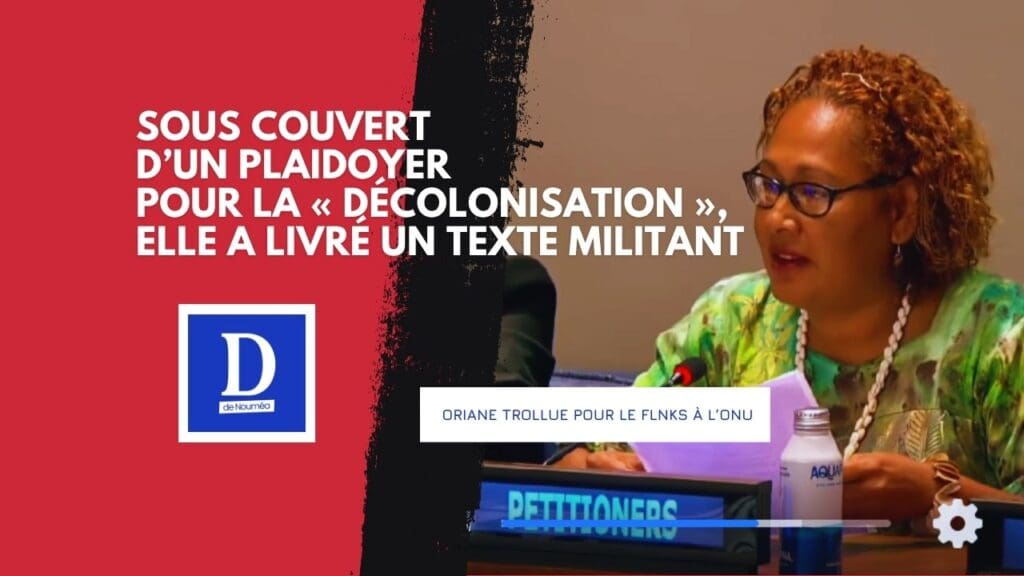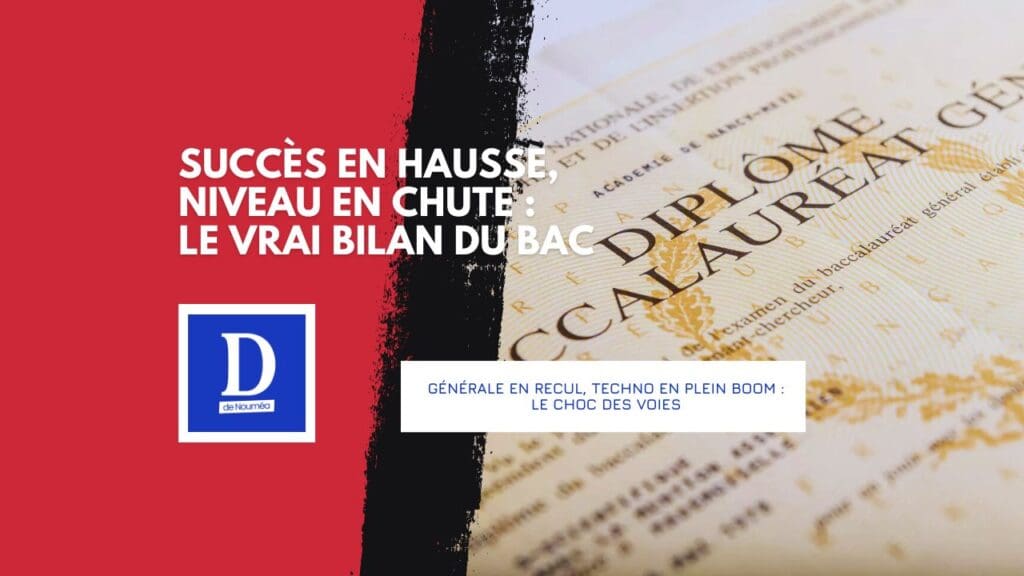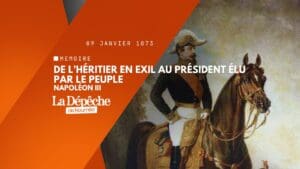La République affirme son autorité électorale jusqu’aux confins du Pacifique. Le gouvernement choisit la clarté, la stabilité et l’exigence démocratique face aux particularismes.
Une réforme électorale assumée pour réaffirmer la vitalité démocratique
Le Conseil des ministres du 19 novembre 2025 marque un tournant clair dans la gouvernance électorale des territoires ultramarins. La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou y présente une ordonnance stratégique visant à étendre la loi n° 2025-444 aux réalités institutionnelles de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Cette initiative traduit une volonté ferme de rééquilibrer les règles du jeu électoral afin de consolider la légitimité des équipes municipales. Le pouvoir central assume un pilotage fort pour garantir une démocratie locale cohérente avec les principes républicains.
La réforme prolonge l’esprit de la loi du 21 mai 2025, conçue pour harmoniser le mode de scrutin municipal sur l’ensemble du territoire national. Elle répond à un impératif : protéger la cohésion municipale et renforcer la participation structurée.
Contrairement au droit commun appliqué en métropole dès 2026, le calendrier est adapté pour ces collectivités : l’entrée en vigueur est programmée pour le renouvellement général de 2032.
Ce choix traduit une ligne de conduite claire : respect des contextes locaux sans renoncer à l’exigence républicaine. Il s’agit d’une adaptation, non d’un renoncement.
Le gouvernement refuse la précipitation, mais impose un cadre : une approche méthodique qui illustre une République ferme, mais pragmatique.
Parité et scrutin de liste : la fin des ambiguïtés locales
L’ordonnance aligne progressivement les petites communes ultramarines sur le modèle national. Elle étend le scrutin de liste proportionnel et paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants en Polynésie française.
En Nouvelle-Calédonie, la parité devient également obligatoire dans ces communes, là où seul le scrutin de liste s’appliquait jusqu’ici. Une avancée majeure pour une égalité politique réelle.
Les listes électorales pourront inclure jusqu’à deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir, une mesure destinée à sécuriser la composition des conseils municipaux.
Inversement, une liste sera réputée complète si elle comporte jusqu’à deux candidats de moins que le seuil légal. Ce mécanisme pragmatique évite des blocages administratifs inutiles.
Autre évolution notable : l’exception dite d’incomplétude. Dans les communes de 500 à 999 habitants, un conseil sera réputé complet avec 13 membres. Cette disposition renforce la stabilité institutionnelle face aux réalités démographiques et traduit une politique de responsabilité locale encadrée.
Enfin, le scrutin de liste paritaire pour l’élection des adjoints est étendu aux communes de moins de 1 000 habitants en Nouvelle-Calédonie, rompant avec les seuils antérieurs fixés à 3 500 habitants.
Une adaptation mesurée dans le respect des spécificités territoriales
L’ordonnance ne se limite pas à une transposition mécanique : elle procède à un ajustement précis des textes juridiques applicables.
Le code électoral, le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie sont révisés afin de garantir la cohérence juridique et la lisibilité des règles.
Le gouvernement assume une ligne claire : pas de traitement d’exception, mais un calendrier maîtrisé. La proximité des échéances électorales justifie ce délai technique.
Cette approche défend une démocratie structurée contre l’improvisation et protège la stabilité institutionnelle face aux dérives localistes.
Le discours officiel insiste sur la nécessité de préserver la parité dans la vie publique, pilier fondamental de la modernisation républicaine.
Il ne s’agit pas de céder aux pressions communautaires, mais d’imposer des règles justes et équilibrées : une République qui assume de remettre de l’ordre dans le système électoral.
Cette ordonnance incarne une vision politique claire : restaurer la confiance par la règle et non par la concession.
Face aux tensions et aux tentations identitaires, Paris réaffirme la primauté du cadre national. La démocratie locale s’inscrit dans un projet français, non dans une fragmentation institutionnelle.
En repoussant à 2032 l’application complète de la réforme, l’État choisit la lucidité : il protège les communes tout en consolidant la souveraineté démocratique.
Cette réforme électorale marque une étape décisive pour l’avenir institutionnel de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. Elle conjugue exigence démocratique, respect des spécificités et affirmation de l’autorité républicaine.
Loin des discours victimaires, la loi impose une vision structurée et exigeante : une France qui assume de moderniser sans renier ses principes.
La parité, la transparence et la stabilité deviennent les piliers d’une démocratie locale renouvelée. Un choix politique fort, assumé et résolument tourné vers l’intérêt général.
La République trace la voie. Les territoires suivent le cap.