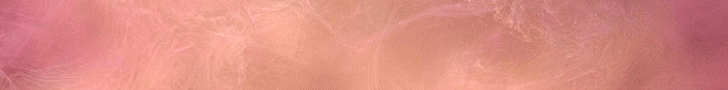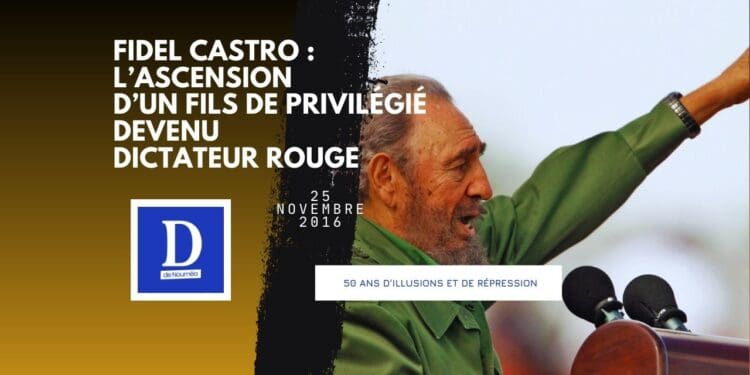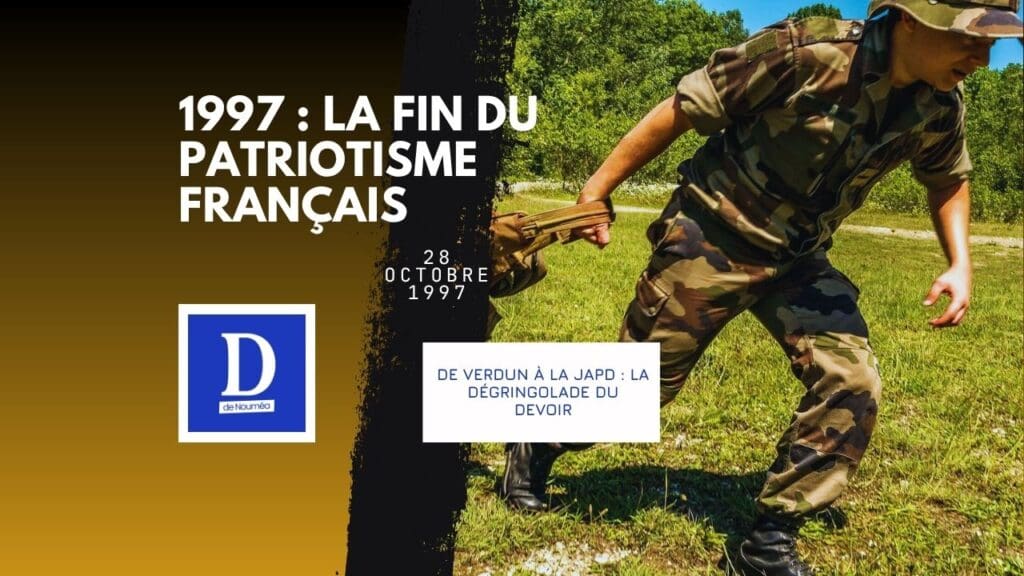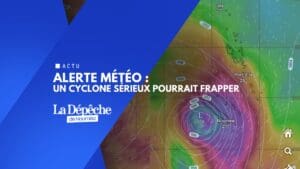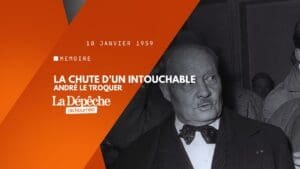Deux générations ont grandi sous son ombre, convaincues qu’il avait libéré Cuba.
La réalité est plus simple : Fidel Castro a surtout enchaîné un peuple qui n’avait rien demandé.
La jeunesse dorée d’un futur caudillo rouge
Fidel Castro, né le 13 août 1926 dans la campagne de Birán, n’a jamais été l’enfant du peuple que l’on raconte dans les manuels. Issu d’une famille de planteurs prospères, il évolue dans un environnement où le pouvoir et l’influence sont naturels. Très tôt, il goûte à l’agitation politique, mû par une ambition personnelle bien plus que par un idéal social.
À Santiago de Cuba, le 26 juillet 1953, Castro mène une attaque spectaculaire contre la caserne de Moncada. Une opération improvisée, mal préparée, qui tourne au fiasco. Arrêté, il écope de quinze ans de prison. Ce premier échec forge déjà le mythe d’un révolutionnaire prêt à tout, mais révèle surtout un homme persuadé d’être destiné au pouvoir.
En 1954, une amnistie lui ouvre les portes de la liberté. Direction le Mexique, où il réorganise son mouvement, baptisé « 26 Juillet ». Castro s’entoure d’hommes prêts à mourir pour lui. Parmi eux, un jeune Argentin exalté, Ernesto « Che » Guevara, qui deviendra l’icône romantisée de toutes les révolutions… mais aussi l’exécutant impitoyable des purges castristes.
Le 2 décembre 1956, Castro retourne à Cuba à bord du Granma. Le désastre est total : la plupart de ses partisans sont abattus. Ils ne sont plus que douze à survivre, réfugiés dans la Sierra Maestra. De ce noyau minuscule naîtra une guérilla qui séduira une jeunesse cubaine lassée de la corruption du régime Batista.
La chute de Batista : victoire romantique, lendemain autoritaire
Le régime de Fulgencio Batista, gangrené par la corruption, n’a plus l’adhésion du pays. De nombreux jeunes rejoignent les maquis castristes, galvanisés par le récit héroïque de la résistance. L’insurrection gagne du terrain, ville après ville, jusqu’à contraindre Batista à s’enfuir le 1ᵉʳ janvier 1959.
Les « barbudos » entrent alors dans La Havane, acclamés par une foule qui croit accueillir des libérateurs. Le 17 février 1959, Fidel Castro devient Premier ministre, concentrant rapidement entre ses mains un pouvoir quasi illimité.
C’est le début d’un long règne où l’idéologie socialiste va justifier toutes les dérives. Castro nationalise les plantations sucrières, expulse les entrepreneurs, muselle la presse et réorganise la société sur le modèle soviétique. Les États-Unis, d’abord intrigués, deviennent rapidement l’ennemi numéro un.
L’île bascule alors dans l’orbite de Moscou, devenant le premier État communiste de l’hémisphère occidental. Pour Castro, la révolution ne se discute pas : elle s’impose. Pour le peuple cubain, commence une ère faite de rationnements, de répression et d’exil forcé.
Ce qui avait commencé comme une révolte contre un dictateur se transforme en un système autoritaire, verrouillé par un homme qui ne quittera jamais vraiment le pouvoir avant 2008.
Un demi-siècle de pouvoir : le mythe et la réalité
Castro aura dirigé Cuba pendant presque cinquante ans, tenant tête à Washington, flirtant avec Moscou et utilisant la guerre froide comme levier permanent de légitimation. Sous son règne, la petite île devient l’un des symboles géopolitiques les plus commentés du XXᵉ siècle.
Mais derrière la légende du « Líder Máximo », la réalité est tout autre : un pays figé, une économie à l’agonie, des libertés civiles réduites au silence. Les opposants connaissent la prison, l’exil ou le cimetière. Le modèle castriste, admiré par une partie de l’intelligentsia occidentale, repose surtout sur la surveillance, la centralisation et la répression.
Lorsque Castro meurt le 25 novembre 2016 à La Havane, il laisse derrière lui un peuple fatigué, une diaspora immense et une nation qui ne s’est jamais remise de ses promesses trahies.
L’île est restée coupée du monde, ballotée entre Moscou, Caracas et les timides ouvertures américaines de l’ère Obama. L’utopie révolutionnaire s’est transformée en immobilisme politique et économique.
Castro restera pour beaucoup un symbole de résistance à l’impérialisme américain. Mais pour ceux qui ont connu les files d’attente, la délation obligatoire, la censure et les arrestations arbitraires, il demeure avant tout l’homme qui a confisqué la liberté d’un peuple entier.
Cuba ne s’est jamais remise de son règne.