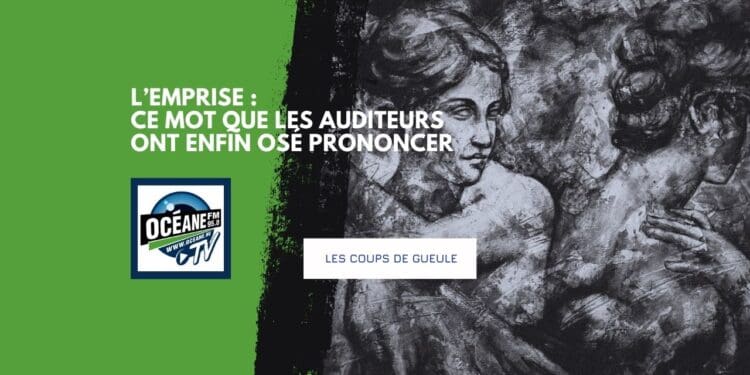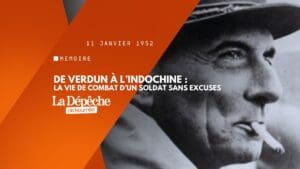Dans l’émission, il y a des moments où l’ambiance change. Les blagues cessent. Les animateurs prennent une respiration plus lente. Sur Océane FM, l’onde s’est figée lorsque le sujet des violences intrafamiliales et conjugales est arrivé.
Et soudain, plus personne ne riait. Parce que ce thème-là, en Nouvelle-Calédonie, c’est un volcan sous la cendre : on sait que ça brûle, mais on n’ose jamais regarder la lave.
Les appels, les réactions, les silences même… tout racontait la même chose :
ici, la violence derrière les murs est massive, connue de tous, mais encore étouffée par une culture du “on n’en parle pas”.
Un territoire miné par les chiffres que personne ne veut voir
Les animateurs ont rappelé les données évoquées par la presse locale :
- plus de 2000 plaintes pour violences intrafamiliales chaque année,
- seules 10 à 20 % des victimes osent déposer plainte,
- une femme sur quatre concernée par des violences,
- plus de 3100 victimes pour violences sexuelles recensées en une année.
Et l’un d’eux pose la phrase qui glace :
Sur une île aussi petite, c’est énorme
Les auditeurs n’ont pas débattu de ces chiffres.
Ils les ont confirmés par leur silence.
Parce que tout le monde ici connaît quelqu’un qui subit.
Tout le monde.
L’emprise : ce mot que les auditeurs ont enfin osé prononcer
Dans les coups de gueule, un discours est revenu :
Pourquoi ne partent-elles pas dès le premier coup ?
Et pour une fois, la réponse a été dite clairement à l’antenne :
l’emprise. Ce mécanisme sournois où l’on détruit la confiance de la victime, où l’on alterne menaces et déclarations d’amour, où l’on enferme mentalement sans cadenas ni murs.
Les animateurs l’ont expliqué avec une lucidité rare : l’amour qui rend aveugle, la honte de parler, la peur de ne pas être crue, le poids du “ça va s’arranger”, le chantage affectif la manipulation.
Et surtout :
C’est facile de dire ‘pars’, beaucoup plus difficile de le faire
L’omerta calédonienne : un tabou culturel encore puissant
Le débat a explosé quand l’une des animatrices a rappelé ce que toutes les familles calédoniennes savent :
Pendant des décennies, on a appris aux victimes à se taire.
À laver son linge sale en famille.
À fermer les yeux.
À respecter une forme de hiérarchie domestique où la victime n’a pas le droit de contester.
C’est ce tabou, profondément enraciné, que les auditeurs ont dénoncé :
On nous a toujours dit de ne pas en parler
Chez nous, c’est un sujet qu’on cache
Beaucoup ne savent même pas qu’elles ont le droit de porter plainte
Cette culture du silence, si ancrée, continue de faire des ravages.
Elle protège les agresseurs. Elle isole les victimes. Elle banalise l’inacceptable.
Et le manque de réaction ? Un constat brutal
À l’antenne, un auditeur a résumé ce que beaucoup pensent tout bas :
On en parle toutes les semaines… et ça ne bouge pas
Car si la société civile commence à briser le tabou, on dénonce : qu’il n’ y ait pas assez de structures d’accueil, de procédures lourdes, un manque d’écoute, unsentiment que rien ne change, des familles qui minimisent, un entourage qui détourne le regard.
Le résultat est terrible : une victime parle, et on lui répond souvent “supporte encore un peu”.
Assez de silences, assez de tabous
Les coups de gueule de ce jour-là n’étaient pas seulement des témoignages :
c’était un appel au réveil collectif. La violence intrafamiliale n’est pas un “problème de couple”.
Ce n’est pas un “conflit familial”. Ce n’est pas un “ça arrive chez tout le monde”. C’est un fléau.
Un fléau massif. Un fléau documenté, décrit, répété, visible, audible. Et surtout :
un fléau qui ne disparaîtra que si toute la société arrête, enfin, de se taire.
Parce que les victimes, elles, n’ont plus le luxe du silence.