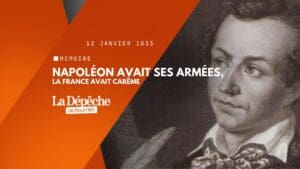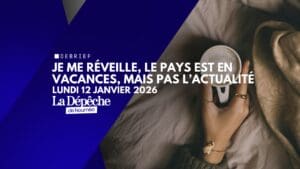La France n’est forte que lorsqu’elle assume sa puissance, ses frontières et sa voix dans le monde.
Dans l’ombre des grandes crises, une bataille stratégique se joue : celle de la diplomatie ultramarine, bras avancé de la souveraineté nationale.
La diplomatie ultramarine, pilier discret mais décisif de la souveraineté française
La mission parlementaire menée par la délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale a acté une réalité longtemps sous-estimée : la France dispose d’une véritable diplomatie ultramarine, branche à part entière de sa politique extérieure, fondée sur une coordination entre l’État et les exécutifs locaux.
Cette approche coconstruite permet aux territoires ultramarins d’agir, dans certains cas, au nom même de la République, tout en respectant le cadre constitutionnel et l’autorité régalienne centrale.
Cette organisation répond à une exigence stratégique claire : intégrer pleinement les intérêts des populations ultramarines dans la défense de la souveraineté française, notamment dans les zones où les convoitises internationales sont les plus fortes.
La France ne peut plus se contenter d’une diplomatie jacobine déconnectée du terrain. Le rapport souligne que les élus ultramarins sont souvent les meilleurs connaisseurs des réalités locales et des équilibres géopolitiques régionaux, ce qui renforce leur rôle stratégique.
Les outre-mer, leviers majeurs de puissance et de projection stratégique
Grâce à ses territoires ultramarins, la France est la deuxième puissance maritime mondiale, avec 97 % de sa zone économique exclusive située hors de l’Hexagone.
Cette présence globale confère à la République une capacité unique de projection militaire, économique et diplomatique sur l’ensemble des océans.
Dans un monde marqué par la montée des tensions, la concurrence sino-américaine et les ingérences étrangères, les outre-mer deviennent des points d’appui géostratégiques essentiels.
Ils garantissent la continuité de l’influence française dans l’Indopacifique, la Caraïbe et l’océan Indien.
Face aux tentatives d’instrumentalisation étrangères, notamment de l’Azerbaïdjan ou de la Russie, le rapport met en garde contre toute naïveté stratégique.
Ces puissances exploitent parfois les crises locales (ex. : crise du 13 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie) pour affaiblir le discours républicain et miner l’autorité de l’État français.
Face aux inégalités économiques massives, au chômage structurel et à la vie chère qui frappent ces territoires, l’ouverture régionale apparaît comme un levier vital de redressement.
Mais cette ouverture ne doit jamais signifier renoncement : elle doit s’inscrire dans une stratégie claire de défense des intérêts nationaux et de rayonnement tricolore.
Réaffirmer l’État : une nécessité face aux dérives et à la fragmentation
Le rapport pointe une faiblesse structurelle : l’absence d’un pilotage clair et centralisé de la diplomatie ultramarine.
Plusieurs experts dénoncent une gestion éclatée et parfois secondaire de ces enjeux au sein même du Quai d’Orsay.
Ils dénoncent également le sous-financement chronique de la coopération régionale, révélateur d’un manque de volonté politique persistant.
Pour restaurer l’efficacité, les parlementaires recommandent une reconnaissance institutionnelle renforcée, une meilleure coordination interministérielle et une hausse des moyens financiers alloués à cette diplomatie spécifique.
Il ne s’agit pas de régionaliser la souveraineté, mais de la consolider intelligemment : replacer l’État au cœur du dispositif, sans céder aux injonctions indépendantistes ni aux pressions extérieures, voilà la ligne claire défendue par le rapport.
À l’heure où la France est contestée sur plusieurs fronts, la diplomatie ultramarine apparaît comme un outil stratégique décisif pour affirmer une France forte, souveraine et assumée.
Refuser la dilution, renforcer l’État, protéger les intérêts nationaux : telle est la voie tracée pour que les outre-mer restent non pas une périphérie, mais le cœur battant de la puissance française.