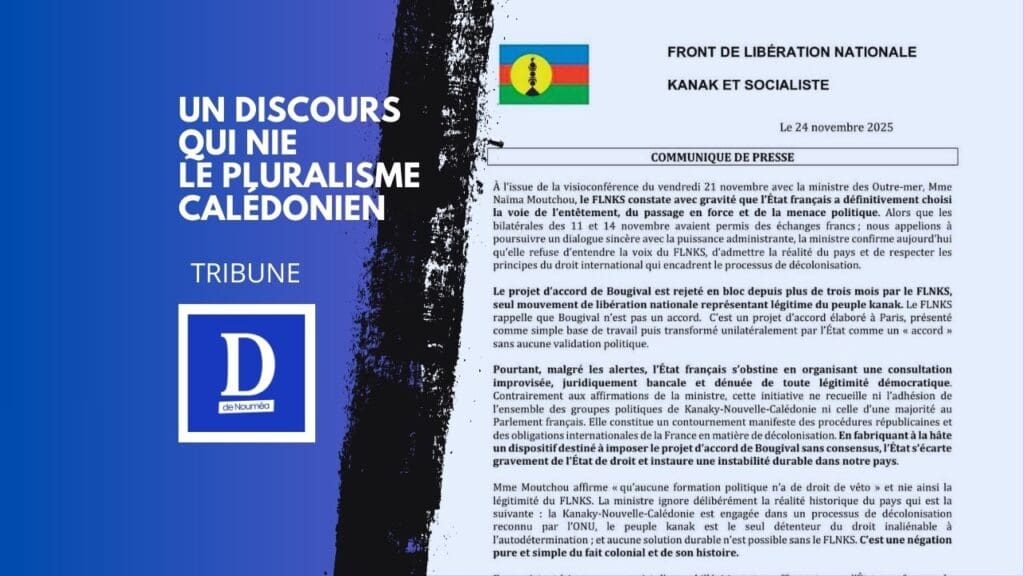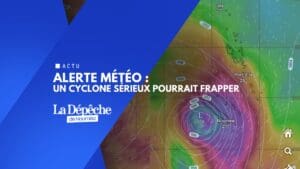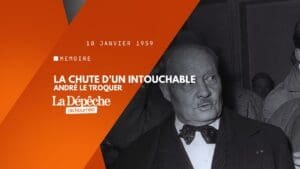À chaque nouveau communiqué, l’Union calédonienne montre un peu plus son refus de toute sortie de crise. Le rejet systématique de Bougival devient la colonne vertébrale d’une stratégie politique assumée.
Une mécanique bien huilée : dire non, encore et toujours
Le dernier communiqué de l’Union calédonienne illustre une constante : l’opposition systématique. Qu’il s’agisse de Bougival, de la consultation anticipée ou même de la méthode employée par l’État, tout est rejeté d’un bloc. Le refus n’est plus une position ponctuelle, c’est devenu une doctrine, une mécanique politique parfaitement huilée qui ramène inlassablement au même point : dire non, encore et toujours.
Ce réflexe politique, qui se répète depuis des mois, montre la cohérence d’une ligne : empêcher l’avancée du processus voulu par une majorité d’élus, de partenaires et d’acteurs institutionnels. En réaffirmant son refus total du projet Bougival, l’UC s’oppose à un accord pourtant soutenu par cinq partis sur six, un fait politique majeur que le communiqué n’évoque jamais.
Le message adressé à Paris est limpide : aucun compromis, aucune adaptation, aucune flexibilité.
Pourtant, les discussions engagées à l’Élysée visaient précisément à sortir de l’impasse née des violences, des blocages et des fractures de ces derniers mois.
En dénonçant une prétendue « stratégie de passage en force de l’État », l’UC entretient un récit devenu central : celui d’une France unilatérale, qui ignorerait l’histoire et les attentes du peuple kanak.
Une lecture contestée par de nombreux responsables politiques locaux, qui rappellent que Bougival a été conçu comme un accord d’équilibre, garantissant la stabilité institutionnelle et le maintien des droits économiques et sociaux.
Une mobilisation interne qui vise avant tout les élections
Derrière la critique de l’État, le communiqué souligne une autre réalité : l’UC prépare sa prochaine bataille électorale.
Le parti exhorte ses structures à s’organiser pour les municipales et les provinciales, avec un objectif clair : consolider son influence dans les institutions.
La création d’un nouveau comité local à Farino illustre cette dynamique d’extension.
Loin d’être anecdotique, cette structuration marque la volonté de renforcer le maillage territorial et de mobiliser les militants autour d’une ligne politique resserrée.
En parallèle, l’UC mandate ses instances pour multiplier les actions judiciaires, locales et internationales.
Cette stratégie contentieuse s’inscrit dans une logique de pression permanente sur l’État, déjà observée lors des précédentes séquences institutionnelles.
Le parti insiste sur la nécessité d’un alignement total de ses élus, affirmant qu’ils sont « pleinement alignés sur la ligne politique » définie par ses instances.
Une discipline interne assumée, qui témoigne d’une volonté d’unité mais aussi d’une forme de verrouillage stratégique.
Une vision politique qui prolonge l’impasse plutôt que la sortie de crise
En actant les avancées sur la gouvernance du FLNKS et en présentant le mouvement comme « reconnu et légitime », l’UC renforce son ancrage identitaire et historique.
Mais cette narration, centrée sur l’héritage et la souveraineté, occulte un élément essentiel : la volonté majoritaire du pays de retrouver de la stabilité.
L’UC réaffirme son refus de toute consultation anticipée sans consensus préalable.
Pourtant, la consultation prévue par l’État répond précisément à une inquiétude largement exprimée : la nécessité d’un cadre institutionnel clair pour sortir d’une période de tensions extrêmes.
En brandissant des arguments de droit international et en évoquant les obligation
s de la France en matière de décolonisation, le parti renoue avec une ligne dure, héritée des années 1980, mais en décalage avec une jeunesse et une économie qui demandent désormais sécurité, visibilité et apaisement.
La stratégie du refus ne permet aucune projection.
Aucune alternative.
Aucun chemin concret vers une solution politique partagée.
À l’inverse, Bougival propose une base de stabilité, un cadre institutionnel clarifié et un horizon pour les décennies à venir.
Rejeter cet accord sans proposer de piste crédible revient à prolonger une impasse que le pays ne peut plus se permettre, notamment après les destructions et les fractures du mois de mai.
Ce refus systématique maintient le territoire dans une forme d’incertitude lourde : institutions bloquées, économie fragilisée, tensions communautaires exacerbées.
À long terme, cette posture pourrait éloigner la Nouvelle-Calédonie des investissements, de la confiance internationale et d’une reconstruction sereine.