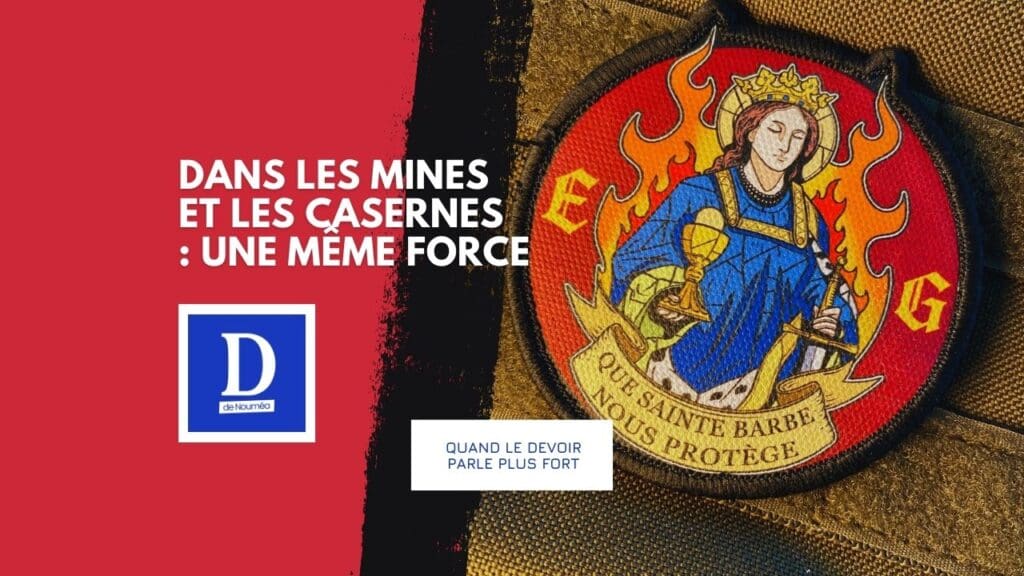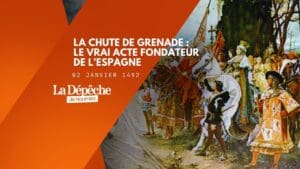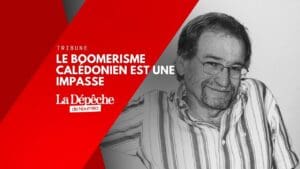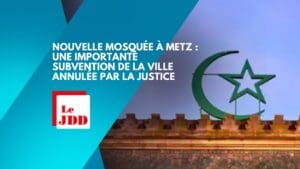Un coup d’arrêt juridique pour les uns, une opportunité de retour pour les autres. En transmettant au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur la radiation automatique des élus calédoniens, le Conseil d’État pourrait, à terme, offrir un rebond politique inespéré à plusieurs figures frappées d’inéligibilité. En ligne de mire : la loi organique de 1999, pierre angulaire de l’accord de Nouméa, aujourd’hui mise en question.
Un cas concret : la radiation immédiate de Jacques Lalié
Le 26 juin 2025, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer sur le recours de Jacques Lalié, ancien président de la province des Îles Loyauté, frappé par un arrêté du haut-commissaire qui le déclarait démissionnaire d’office de ses mandats. En cause : une condamnation pénale à douze mois de prison avec sursis, une amende d’un million de francs Pacifique, et surtout une peine d’inéligibilité de deux ans, immédiatement exécutoire.
Conformément au III de l’article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’État n’avait pas le choix : dès lors qu’une peine d’inéligibilité est prononcée, il doit automatiquement démettre l’élu. Une procédure implacable, que Jacques Lalié conteste désormais sur le terrain constitutionnel, via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Philippe Gomès et Philippe Michel dans le viseur
L’écho de cette QPC dépasse le cas de Jacques Lalié. En creux, c’est la situation de plusieurs personnalités majeures de la vie politique locale qui est posée. En particulier celle de Philippe Gomès, ancien président du gouvernement, et de Philippe Michel, ex-président de l’assemblée de province Sud, tous deux récemment condamnés à des peines d’inéligibilité avec exécution provisoire.
Leur éviction automatique pourrait devenir juridiquement fragile si le Conseil constitutionnel censure le III de l’article 195 de la loi organique de 1999, estimant qu’une telle disposition viole le principe d’égalité devant la loi et le droit au recours effectif. Une décision favorable rouvrirait la porte à un retour politique, du moins temporaire, tant que les condamnations ne sont pas définitives.
Ce scénario est redouté par certains, espéré par d’autres, et scruté avec attention à Paris, alors que l’exécutif s’apprête à réunir les principaux leaders calédoniens à l’Élysée pour évoquer l’avenir institutionnel de l’archipel.
Une loi organique sous tension
Derrière l’apparente technicité du dossier, le fond est éminemment politique. La loi organique de 1999, conçue comme la traduction juridique de l’accord de Nouméa, avait prévu un corpus législatif adapté à la “souveraineté partagée” entre la République et la Nouvelle-Calédonie.
Le Conseil d’État a lui-même pris acte d’un changement de circonstances législatives et jurisprudentielles : les lois sur la moralisation de la vie politique (2016, 2017, 2018, 2022) et la jurisprudence du Conseil constitutionnel imposent désormais un traitement plus équilibré entre élus nationaux et territoriaux. Dès lors, le maintien d’un régime automatique de radiation en Nouvelle-Calédonie apparaît de plus en plus problématique, surtout lorsque l’on sait que le Congrès vote des lois du pays ayant force législative.
Ce décalage soulève une question de fond : faut-il harmoniser les droits fondamentaux sur l’ensemble du territoire national, y compris en outre-mer, ou préserver les spécificités issues d’un accord politique daté mais toujours en vigueur ?
Un effet domino à craindre ?
Si le Conseil constitutionnel donne raison à Jacques Lalié, c’est tout l’édifice disciplinaire calédonien qui pourrait vaciller. Plusieurs élus condamnés ou visés par des procédures pourraient se maintenir, au moins provisoirement, dans leurs fonctions. La légitimité du haut-commissaire, dont l’autorité repose sur cette loi organique, pourrait être affaiblie. Et plus encore, la classe politique locale serait confrontée à un profond trouble de lecture des règles du jeu électoral.
À quelques heures des discussions décisives sur le post-Accord de Nouméa, cette décision intervient à un moment stratégique. Car au-delà des mandats individuels, c’est la place même des institutions calédoniennes dans la République qui est questionnée : statut spécifique ou droit commun ?
En renvoyant cette question au Conseil constitutionnel, le Conseil d’État ne se contente pas de trancher un litige individuel : il ouvre une brèche dans l’architecture juridique du statut calédonien, dont les fondements paraissent de plus en plus fragiles à l’aune du droit commun républicain. Derrière la querelle juridique, c’est une bataille politique à plusieurs bandes qui se joue, où l’inéligibilité devient un levier stratégique, et où chaque décision de justice redessine les équilibres d’un territoire à la croisée des chemins.