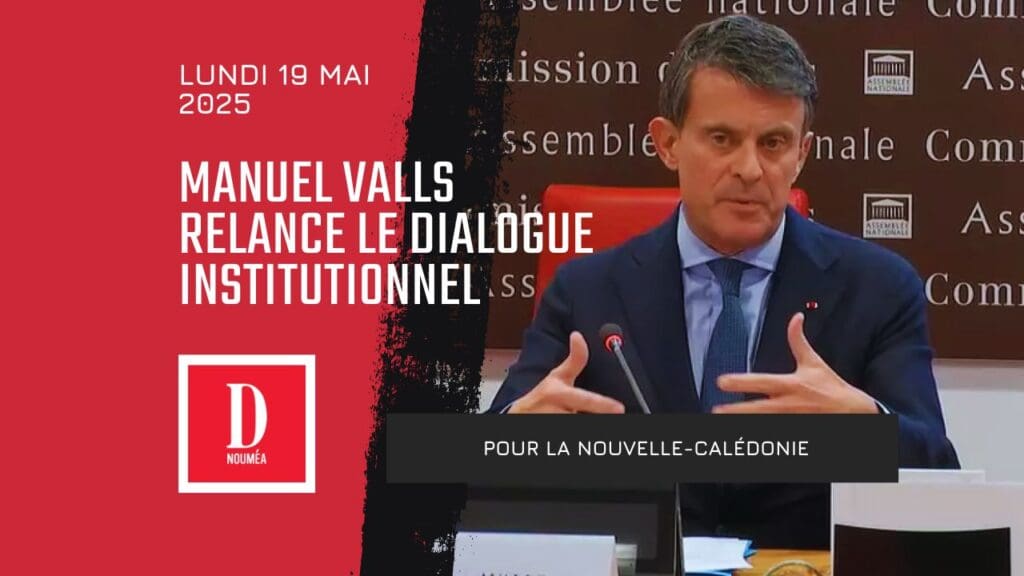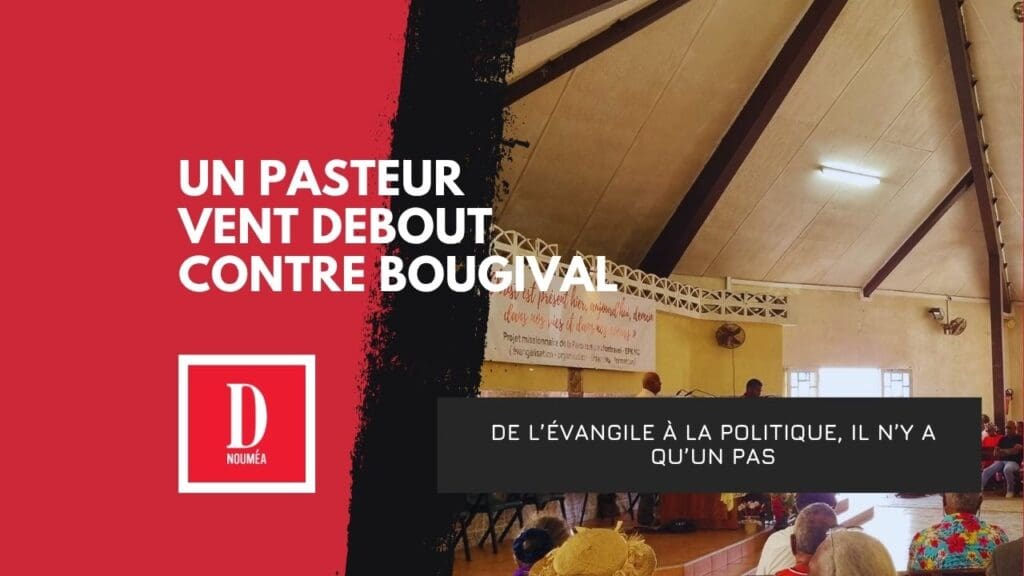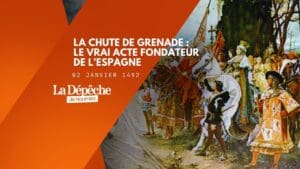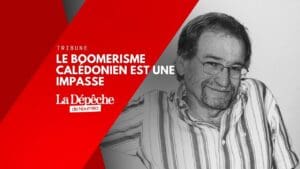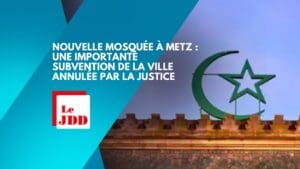Derrière les promesses rassurantes de l’indépendance-association, la réalité géopolitique est tout autre. L’exemple des Îles Cook en offre une démonstration implacable.
L’indépendance-association : une illusion politique séduisante mais dangereuse
Dans le débat calédonien, la formule « indépendance-association » est brandie comme une voie médiane, un compromis entre rupture et continuité. Une manière de faire croire qu’on peut avoir l’indépendance sans perdre la France.
Mais le sondage exclusif de La Dépêche de Nouméa révèle une fracture nette avec cette stratégie :
47 % des indépendantistes eux-mêmes refusent l’indépendance immédiate, préférant la stabilité économique avant toute transition.
53 % de l’ensemble des Calédoniens estiment que leur situation deviendrait insoutenable en cas d’indépendance immédiate.
Ce rejet sous-jacent du saut dans l’inconnu montre que les mots ne suffisent plus. Ce qui compte, ce sont les garanties concrètes : sécurité, services publics, transferts financiers. Et sur ce point, l’exemple des Îles Cook devrait alerter.
Les Îles Cook : quand “l’association” tourne court à la moindre divergence
Depuis 1965, les Îles Cook vivent sous un statut d’indépendance-association avec la Nouvelle-Zélande. Un modèle souvent cité comme référence.
Mais en juin 2025, tout bascule :
• L’archipel de 17 000 habitants annonce un partenariat stratégique avec la Chine sur le commerce et les ressources minières.
• En réaction, la Nouvelle-Zélande suspend brutalement son aide budgétaire, soit plus de 10 millions d’euros.
Pourquoi ?
Parce que dans un accord d’association, le soutien d’un partenaire n’est jamais automatique. Il est conditionné à la confiance, aux valeurs communes et aux intérêts géopolitiques.
En s’éloignant de son “grand frère” néo-zélandais, l’archipel a perdu l’appui financier de Wellington. Le lien est politique, pas contractuel.
Ce cas révèle un principe fondamental : dans une indépendance-association, l’un des deux partenaires peut toujours se désengager. Et souvent, il le fera si les choix du nouvel État souverain contredisent ses intérêts.
En Calédonie, les conséquences seraient bien pires
Appliquer ce scénario à la Nouvelle-Calédonie, c’est prendre trois risques majeurs :
- Fin des transferts actuels
La France verse 1,5 milliard d’euros par an à la Calédonie. Dans une indépendance-association, ce flux n’est pas garanti. Ce n’est pas un dû, c’est un choix politique. - Priorité aux territoires français
Dans un contexte de crise des finances publiques, la France priorisera les Outre-mer restés dans la République : Réunion, Guyane, Antilles.
Si la Nouvelle-Calédonie devient étrangère, elle passera en dernier. Et s’il reste quelque chose, peut-être… - Le mythe de la carte bleue française
Une Calédonie indépendante ne pourra plus jouer avec la carte bleue de Paris. Les salaires des fonctionnaires, les aides sociales, la santé publique ne seront plus financés comme aujourd’hui.
Indépendance-association ne veut pas dire chèque en blanc.
Une conclusion sans ambiguïté : l’indépendance-association est un leurre
L’affaire des Îles Cook démontre que l’indépendance-association n’est pas un havre de sécurité, mais un marchepied vers l’isolement, voire la rupture.
En Nouvelle-Calédonie, ce modèle :
- Ne garantit ni la stabilité économique,
- Ni la continuité des services publics,
- Ni la souveraineté partagée.
Il rassure à court terme pour mieux déstabiliser à long terme.
Ce que le sondage montre, c’est que les Calédoniens veulent des solutions concrètes, pas des slogans. Ils veulent des hôpitaux qui fonctionnent, des écoles ouvertes, de la sécurité dans les rues. Pas un statut flou à géométrie variable.