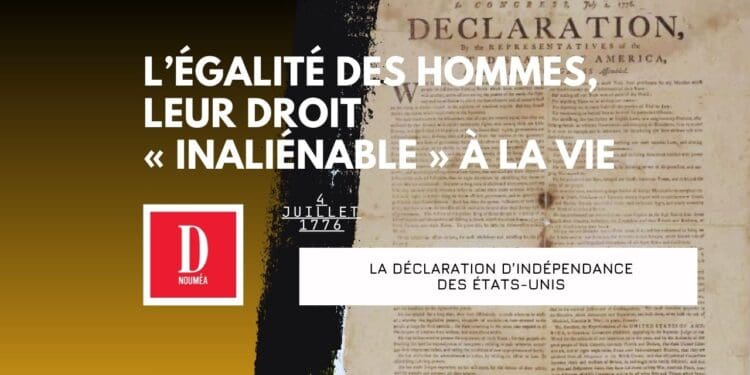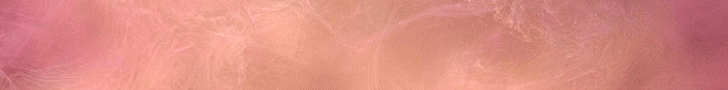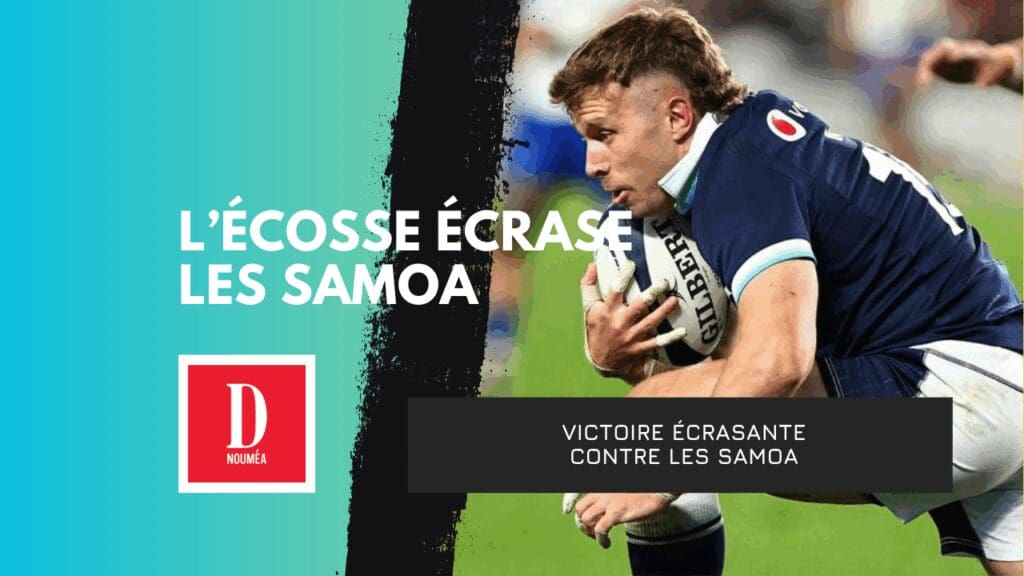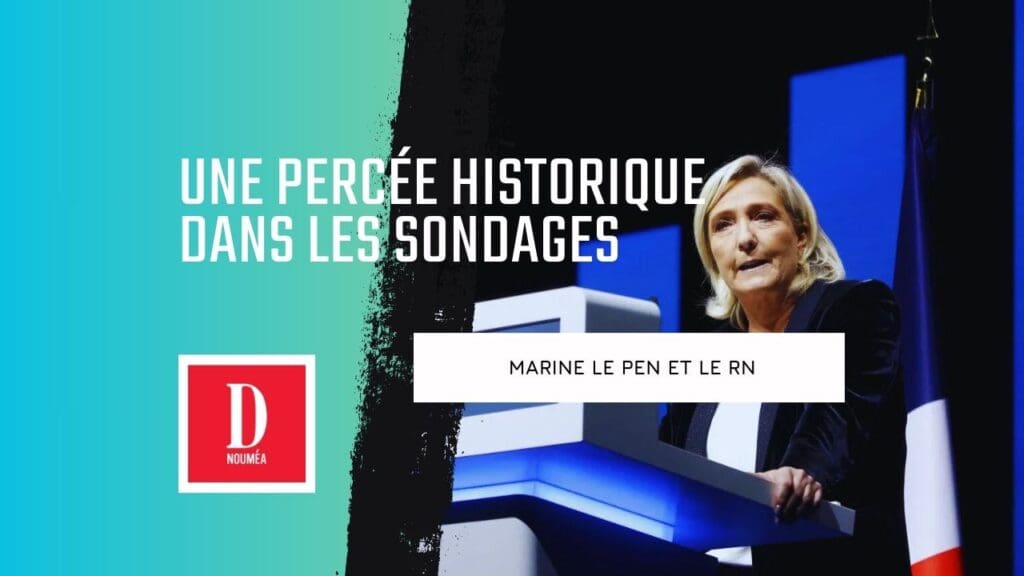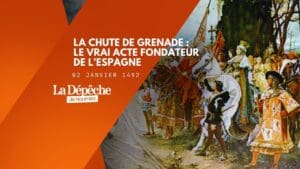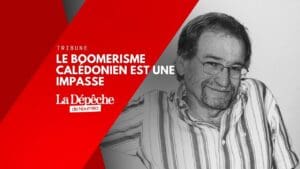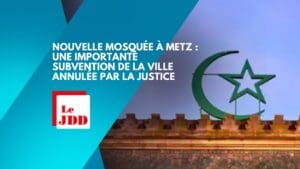Sous les feux d’artifice et les drapeaux étoilés, l’Amérique célèbre ce 4 juillet la naissance d’une nation. Symbole de rupture avec la monarchie britannique, la Déclaration d’indépendance de 1776 reste le socle idéologique d’un pays façonné par la guerre, les Lumières… et une volonté farouche de liberté.
4 juillet : naissance d’une nation, mythe d’une puissance
Derrière ces célébrations, le souvenir d’une rupture fondatrice. Le 4 juillet 1776, à Philadelphie, les représentants des treize colonies britanniques d’Amérique adoptent un texte qui va bouleverser l’Histoire : la Déclaration d’indépendance des États-Unis. Ce geste, solennel et subversif, marque une rupture avec le Royaume-Uni. Pourtant, l’acte décisif avait été voté deux jours plus tôt, le 2 juillet, lors d’un vote secret au Congrès. Mais c’est bien la publication du texte final, signé notamment par Thomas Jefferson, qui est restée comme le symbole fondateur de la république américaine.
Ce document, inspiré par la philosophie des Lumières, proclame l’égalité des hommes et leur droit « inaliénable » à la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Une révolte légitimée contre le roi George III, jugé despotique. Soutenus par la France de Louis XVI, les insurgés remportent la guerre en 1783. George Washington, artisan militaire et futur président, incarne ce nouveau pouvoir souverain.
Une date devenue mythe politique
Devenue fête nationale en 1870, la date du 4 juillet a pris une charge symbolique croissante à mesure que les États-Unis s’imposaient comme puissance mondiale. Elle n’est officiellement chômée et payée que depuis 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, au moment où l’unité nationale devenait cruciale.
Dès le XVIIIe siècle, les premières commémorations mêlent solennité civique et festivités populaires. Parades militaires, drapeaux étoilés, barbecues familiaux, concerts et feux d’artifice s’installent durablement dans le paysage américain. Le Massachusetts fut pionnier, proclamant dès 1781 l’anniversaire comme fête nationale.
Au fil des décennies, le 4 juillet est devenu un outil politique. En 2021, Joe Biden y fixa la date symbolique du retrait définitif des troupes américaines en Afghanistan. À l’inverse, Donald Trump tenta une parade militaire à la française, provoquant une controverse sur le mélange des genres entre patriotisme et démonstration de force.
Une mémoire vivante, entre fierté et contradictions
Au-delà de la célébration, le 4 juillet reste le miroir des ambitions, mais aussi des fractures américaines. L’indépendance, conquise au prix d’une guerre, n’a pas effacé les inégalités originelles, notamment envers les esclaves et les peuples autochtones. La Déclaration elle-même, portée par Jefferson, cohabite avec les contradictions d’un homme propriétaire d’esclaves.
Le destin des pères fondateurs n’en reste pas moins frappant : Thomas Jefferson et John Adams, tous deux signataires du texte, meurent le même jour — un 4 juillet 1826 — à cinquante ans d’intervalle de la Déclaration. Une coïncidence devenue légende nationale.
Aujourd’hui encore, les présidents américains cherchent à inscrire leur mandat dans cette lignée héroïque. Le 4 juillet sert de tremplin, de vitrine ou de catalyseur. Et au cœur de l’été, l’Amérique s’offre chaque année un récit fondateur, entre mémoire glorieuse et enjeux très contemporains.
Le droit inaliénable à la vie
Il signifie que chaque être humain possède un droit fondamental à la vie, un droit naturel qui ne peut être retiré, transféré ou nié par aucun gouvernement ou autorité.
Le texte précise :
Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes : que tous les hommes sont créés égaux ; qu’ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables ; que parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur.
Concrètement, cela signifie :
- La vie est un droit fondamental : Aucun pouvoir légitime ne peut disposer arbitrairement de la vie d’un individu.
- Ce droit est « inaliénable » : Il ne peut être cédé, vendu ou retiré, même volontairement.
- C’est un principe fondateur de la démocratie américaine : Il établit que la légitimité du gouvernement repose sur la protection de ces droits.
Le droit inaliénable à la vie, dans la Déclaration d’indépendance, signifie que chaque personne a un droit naturel à exister, que l’État a le devoir de protéger, et que ce droit est au-dessus des lois humaines ordinaires.