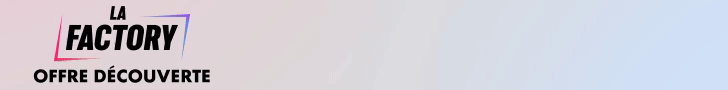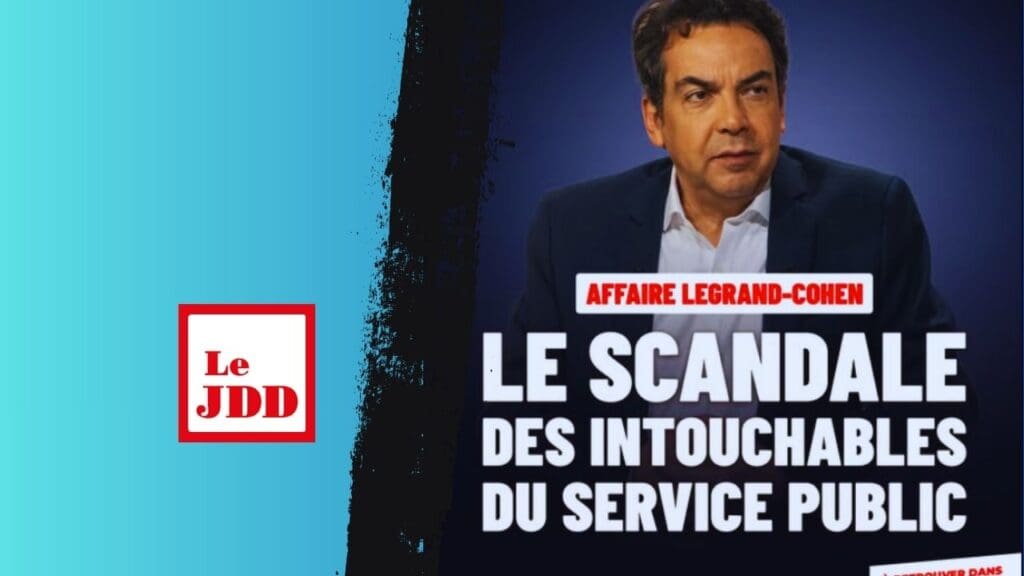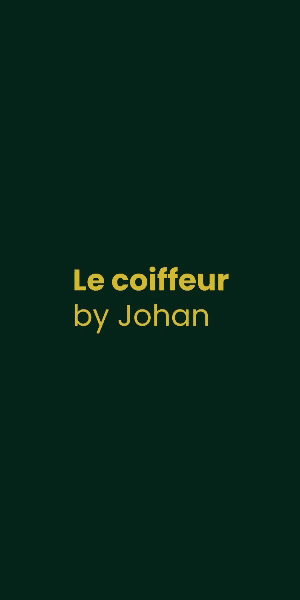Institution discrète mais budgétivore, le Conseil économique, social et environnemental (en France CESE) est de nouveau épinglé pour son inefficacité. Dans un rapport parlementaire publié ce 2 juillet, les députés dénoncent un absentéisme chronique, un manque d’impact et des privilèges mal encadrés. En toile de fond : le doute grandissant sur l’utilité d’une chambre consultative au fonctionnement jugé dépassé.
Une institution consultative qui peine à convaincre
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) se retrouve à nouveau sous les projecteurs, mais pas pour ses contributions. Dans un rapport parlementaire accablant rendu public ce 2 juillet, la commission des Finances de l’Assemblée nationale dénonce un fonctionnement peu rigoureux, marqué par un absentéisme important, une production d’avis réduite et un déséquilibre thématique flagrant, au profit des enjeux environnementaux. Une nouvelle salve contre la troisième chambre de la République, déjà visée par un rapport provisoire de la Cour des comptes révélé en mars dernier.
Le rapport pointe en particulier le faible nombre d’auditions organisées pour certaines études, l’auto-saisine quasi systématique, la faible valorisation des pétitions citoyennes, et une présence minimale des membres : seulement quatre jours de travail par mois pour une rémunération nette de 2 500 euros ( 300 000 XPF).
Une retraite dorée pour des personnalités en quête de rebond ?
Cette situation s’explique peut-être par la nature même de l’institution. Consultatif et non décisionnel, le CESE attire régulièrement des figures politiques en perte de vitesse, des syndicalistes en fin de carrière, voire des artistes oubliés. Pour beaucoup, c’est un strapontin doré, un sas d’attente vers d’autres ambitions ou vers une retraite tranquille.
On les retrouve surtout dans le contingent des 40 « PQ » (personnalités qualifiées), désignées directement par l’Élysée. Un système de nomination opaque, propice au recyclage d’anciens réseaux politiques. La réforme de 2021, qui a introduit les conventions citoyennes pour renforcer la participation démocratique, n’a pas suffi à changer l’image d’un organisme coûteux, peu productif et mal contrôlé.
Le budget alloué au CESE pour 2025 atteint 34,4 millions d’euros ( 4 128 000 000 XPF), dont une grande partie est consacrée aux 154 agents permanents. Ceux-ci perçoivent en moyenne 5 678 euros bruts par mois ( 681 360 XPF) et bénéficient de 12 jours de congés supplémentaires, baptisés « jours CESE ». Le rapport parlementaire recommande de les supprimer, d’aligner les horaires sur les 35 heures légales, de rendre publics les comptes et de lier la rémunération à la présence effective aux réunions.
La Nouvelle-Calédonie a son propre CESE
Moins connu, un Conseil économique, social et environnemental existe aussi en Nouvelle-Calédonie, avec un statut spécifique. À sa tête depuis 2021 : Jean-Louis D’Anglebermes, successeur lointain de Jacques Leguerré, premier président de l’institution. Instaurée officiellement en mars 1991 sous le nom de Comité économique et social, cette institution résulte du dialogue politique entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, dans la continuité de l’accord de Matignon et de la loi référendaire de 1988. Elle devient « CESE » après les réformes organiques de 1999 et 2013, qui intègrent la dimension environnementale.
Le CESE calédonien comprend désormais 41 membres, dont :
28 désignés par les provinces (16 pour le Sud, 8 pour le Nord, 4 pour les Îles Loyauté) ;
2 par le Sénat coutumier ;
9 personnalités qualifiées issues du monde économique, social ou culturel ;
2 représentants du Comité consultatif de l’environnement, récemment ajoutés.
Installé par le président du gouvernement, il est systématiquement consulté sur les projets de délibérations ou propositions de loi à caractère économique, social, environnemental ou culturel. Une mission large, mais qui n’échappe pas à certains travers de son homologue métropolitain : visibilité réduite, influence limitée et nominations parfois critiquées.
La représentante actuelle du CESE-NC pour la mandature nationale 2021-2026 est Ghislaine Arlie.
A quoi sert réellement le CESE ?
Le rapport parlementaire avance dix recommandations précises : meilleure assiduité, transparence budgétaire, recentrage thématique et suppression de plusieurs avantages. Parmi elles, l’intégration du CESE dans le système Chorus, utilisé pour la gestion des dépenses publiques, permettrait un suivi plus rigoureux. Il est également demandé de renforcer l’évaluation annuelle de la performance, afin de mesurer concrètement l’utilité de cette institution.
Mais ces propositions seront-elles suivies d’effet ? Certains élus vont plus loin : ils souhaitent tout simplement supprimer le CESE, jugé inefficace, coûteux et éloigné des préoccupations réelles des Français. En 2014 déjà, la Cour des comptes dénonçait la charge de travail insuffisante de ses membres. Dix ans plus tard, les mêmes critiques persistent, renforcées par les révélations récentes de la presse et des institutions de contrôle.