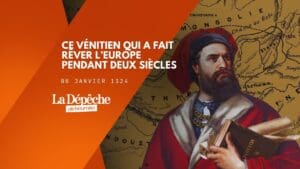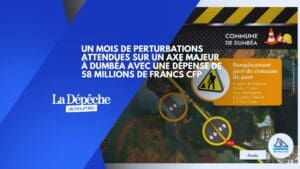Par une plume concernée
Il y a des chiffres qui claquent comme des gifles. 47 % des indépendantistes ne veulent pas d’une indépendance immédiate.
Et pourtant, aucun communiqué, aucun débat, aucune reconnaissance de cette réalité par ceux qui prétendent parler en leur nom.
Ce sondage, ils le lisent. Ils y adhèrent parfois. Mais ils ne le relaient pas. Parce qu’il dérange. Parce qu’il ébranle le socle. Parce qu’il trahit une vérité qu’on préfère taire.
Quand la pensée individuelle devient un tabou collectif
Le plus frappant dans ces résultats, ce n’est pas tant le chiffre en lui-même. C’est le silence qu’il provoque.
Ce sondage donne enfin la parole à ceux qui ne l’ont jamais eue. Des citoyens kanak, souvent de statut coutumier, interrogés seuls, en dehors du regard du clan, libérés, pour une fois, du poids du regard des autres.
Et là, dans ce bref espace de liberté, ils disent autre chose. Ils disent qu’ils ne sont pas prêts. Qu’il faut d’abord redresser le pays. Qu’on ne peut pas revendiquer l’indépendance sur des ruines.
Ce qu’ils pensent vraiment, ce qu’ils vivent, ce qu’ils ressentent… n’a plus rien à voir avec les slogans officiels.
Mais voilà : dans l’espace communautaire, on ne pense pas librement. On s’aligne, on s’efface, on obéit.
Le poids du dogme et la peur de sortir des rangs
Dans la société coutumière, la parole est hiérarchisée. Elle ne se prend pas. Elle se reçoit.
Le chef parle, les autres écoutent. L’individu se dissout dans le collectif.
Et quand le collectif a décidé que la ligne était “indépendance ou rien”, alors plus personne ne bouge.
Même si on pense autrement. Même si on doute. On se tait.
Ce réflexe de verrouillage, on l’a vu pendant les émeutes de mai 2024.
Combien étaient mal à l’aise ? Combien n’étaient pas d’accord ? Combien savaient que ça allait trop loin ?
Mais qui a osé parler pendant que ça brûlait ?
Presque personne.
Parce qu’on ne sort pas du rang. Parce qu’on ne trahit pas la parole du chef. Parce qu’on a peur d’être rejeté, traité de traître, mis à l’écart du clan.
Ce que montre ce sondage, c’est une envie de respirer
C’est peut-être la première fois qu’on entend les voix de l’intérieur. Les voix étouffées. Les voix qui n’ont jamais eu la parole. Les voix de ceux qui n’ont pas fait d’études politiques, qui ne sont pas dans les congrès du FLNKS, mais qui vivent avec 100 francs en poche à la fin du mois.
Ceux qui voient l’hôpital reculer, l’école fermer, les prix flamber…
Et qui se demandent : indépendance, d’accord. Mais pour quoi faire, si on ne peut même pas nourrir nos enfants ?
Ces voix-là ne rejettent pas l’idée d’émancipation. Elles demandent du temps, de la vérité, du concret.
Elles veulent savoir si, demain, elles auront toujours une carte CAFAT. Si leurs retraites seront versées.
Si leurs enfants auront un avenir.
Briser le silence, pour ne plus subir
Ce sondage est un miroir. Il renvoie l’image d’un peuple tiraillé, inquiet, fatigué des slogans.
Un peuple qui commence à comprendre que l’indépendance-association ne garantit rien, surtout pas les aides de la France.
Un peuple qui voit bien que dans un monde en crise, la France aidera d’abord ceux qui sont dans la République. Et que s’il reste quelque chose, peut-être, un jour…
Mais il faudra faire la queue derrière La Réunion, la Martinique, la Guyane.
La vérité, c’est que l’indépendance-association n’est pas une porte de sortie.
C’est une illusion. Un entre-deux flou. Un mot qui rassure pour mieux piéger.
Et maintenant ?
Ce sondage n’est pas qu’un chiffre. C’est un cri silencieux. Celui d’un peuple qui n’ose pas encore parler, mais qui pense autrement. Il est temps de lui rendre la parole.
Pas en congrès, pas en tribune. Mais en vérité. En liberté. En respectant l’individu.
Car un peuple ne peut pas se construire sur la peur, ni sur le silence. Et un avenir ne se choisit pas en récitant ce qu’on a toujours entendu, mais en osant dire, enfin :
Je pense autrement. Et j’ai le droit de le dire.