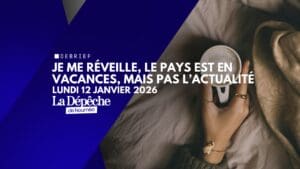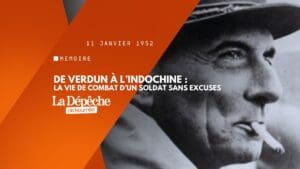Près de 10 millions de pauvres en France : la faute aux riches ? Non. Il est temps d’attaquer les vraies causes de l’appauvrissement.
Une fracture sociale réelle… mais pas imputable à ceux qui réussissent
La France compte aujourd’hui 15,4 % de sa population sous le seuil de pauvreté, soit près de 10 millions de personnes. C’est un fait. Ce qui est moins dit, c’est la manière dont ce débat est instrumentalisé : comme si la hausse des inégalités était uniquement le fruit d’un enrichissement excessif des plus aisés. Or, les riches ne sont pas responsables de la misère des autres.
Le niveau de vie médian a progressé en 2023, c’est vrai. Mais cette hausse globale masque une mauvaise allocation des efforts publics. À force de saupoudrer les aides ponctuelles, d’entretenir des trappes à inactivité et de négliger les réformes de fond, l’État a laissé la pauvreté s’enraciner dans certains foyers.
Chômage, assistanat, perte de compétitivité : les vraies causes de la pauvreté
Les chiffres sont sans appel : les chômeurs représentent 36,1 % des pauvres. Un record. Mais à force de subventionner des dispositifs d’assistance sans obligation de retour vers l’activité, le système s’est figé dans la dépendance. Les familles monoparentales, les jeunes sortant du système scolaire sans qualification, les indépendants précaires : tous sont les victimes d’un modèle socio-économique à bout de souffle.
L’inflation et la pression fiscale sur les classes moyennes ont étranglé le pouvoir d’achat, pendant que la bureaucratie plombe l’entrepreneuriat. Créer, embaucher, produire est devenu un parcours d’obstacles. Ce n’est donc pas en matraquant davantage les foyers fiscaux supérieurs qu’on résoudra le problème : c’est en relançant la machine économique, en valorisant le mérite et en réformant en profondeur l’État providence.
Le “toujours plus d’aides” est une impasse. Ce qu’il faut, c’est davantage de liberté économique, de travail incité et récompensé, et moins d’assistanat aveugle.
Enfants pauvres, retraités fragiles : une solidarité à repenser, pas à diluer
21,9 % des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Là encore, c’est un chiffre intolérable. Mais que fait-on pour que leurs parents travaillent ? L’État a favorisé des allocations au lieu d’un vrai plan pour les services à la petite enfance, l’accès aux crèches, et la formation qualifiante. Résultat : les enfants grandissent dans des foyers inactifs, sans perspective, dépendants de l’aide publique.
Quant aux retraités, leur taux de pauvreté reste contenu à 11,1 %, grâce notamment aux revenus de patrimoine et aux régimes complémentaires. Cela montre une chose : l’épargne protège. Et c’est justement cette épargne que certains voudraient taxer davantage, comme si posséder était devenu suspect.
Non, le problème n’est pas le patrimoine, mais le décrochage productif de certains pans de la population. La vraie solidarité n’est pas de niveler par le bas, mais de permettre à chacun d’accéder à une autonomie durable.
Moins d’impôt, plus d’emploi : une équation que la France a oubliée
Derrière les discours sur le partage des richesses se cache un oubli majeur : il faut les produire, ces richesses. Et pour cela, la France doit alléger les charges qui pèsent sur le travail, réformer en profondeur l’État social, et cesser de culpabiliser ceux qui réussissent.
La pauvreté de masse est le fruit d’une économie bridée, d’un modèle éducatif défaillant, et d’un système social qui entretient la dépendance. Si l’on veut vraiment inverser la tendance, il ne faut pas redistribuer plus — il faut créer plus d’activité, plus de mobilité, plus de mérite.
Ceux qui réussissent ne doivent plus être montrés du doigt, mais servir de modèle. Car ce n’est pas la richesse qui crée la pauvreté, c’est l’immobilisme.