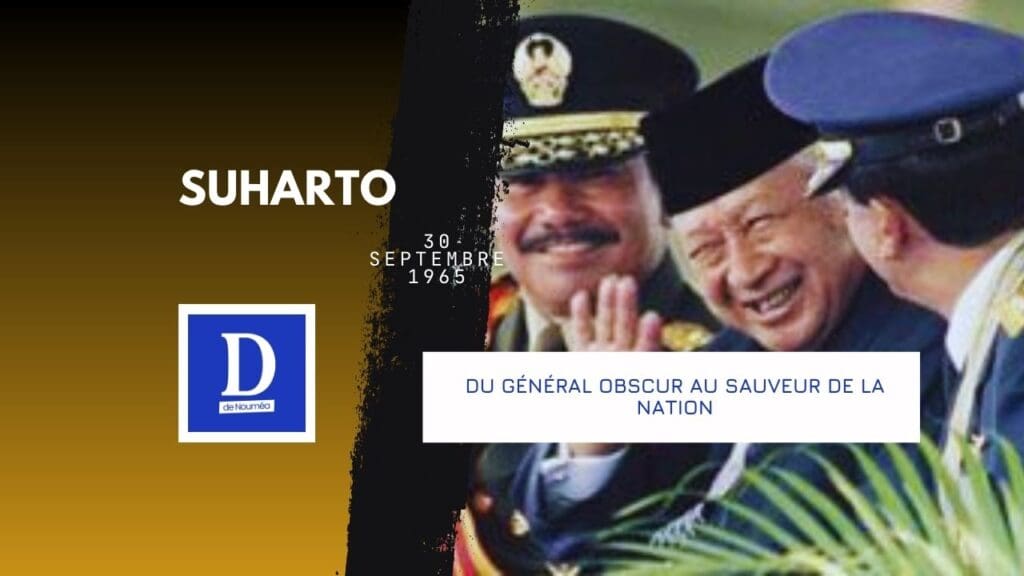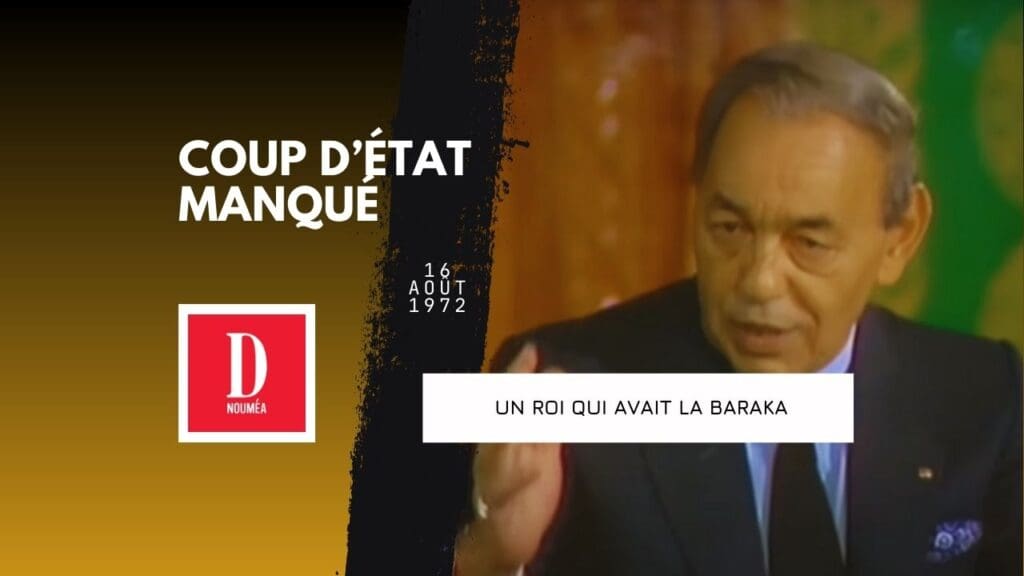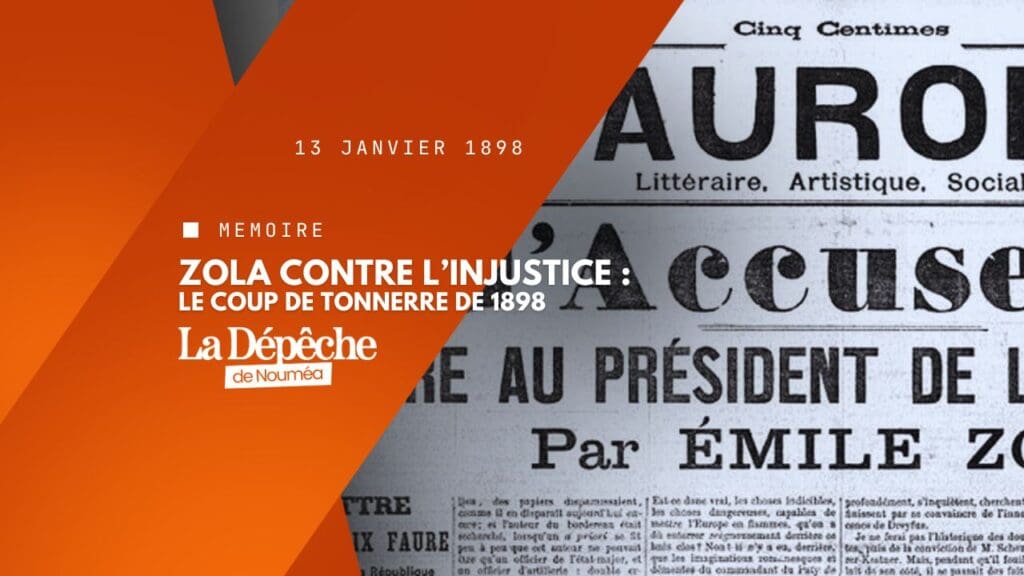Le 18 juillet 1925, Adolf Hitler publie le premier tome de Mein Kampf, écrit en prison après son échec putschiste à Munich. Personne n’imagine alors que ce brûlot raciste et antisémite deviendra le socle idéologique du nazisme et le prélude à l’horreur de la Shoah.
Tantôt caché, tantôt exposé, le livre traverse le siècle comme un objet de fascination, de terreur et d’interrogations. Aujourd’hui, à l’heure des réseaux sociaux et de la radicalisation en ligne, Mein Kampf revient au cœur du débat éditorial et politique.
Une autobiographie nazie aux allures de manifeste totalitaire
Écrit entre les murs de la prison de Landsberg, Mein Kampf mêle confession personnelle, programme politique et stratégie de conquête idéologique. Hitler y expose sans filtre sa vision du monde, nourrie par un antisémitisme virulent, un racisme biologique et une obsession de revanche nationale.
Dès sa parution, l’ouvrage circule modestement en Allemagne, avant de connaître un essor spectaculaire de ventes à la fin des années 1920. Il devient rapidement une source de revenus importante pour Hitler, alors que son parti, le NSDAP, gagne du terrain.
Le livre ne se contente pas de théoriser l’expansion de l’Allemagne « aryenne » : il détaille la manière de manipuler les masses, de prendre le pouvoir démocratiquement pour mieux le détruire ensuite. Ce n’est pas un pamphlet : c’est une feuille de route.
Traductions, manipulations, censures : une histoire éditoriale troublante
En 1934, une traduction française controversée paraît chez Fernand Sorlot. Paradoxalement, ce germanophobe convaincu collabore avec la LICA (ancêtre de la LICRA), qui cherche alerter l’opinion sur la menace nazie. Malgré l’opposition du régime hitlérien, qui veut filtrer les traductions pour ne pas effrayer l’Occident, le livre est publié avec une citation choc du maréchal Lyautey :
Tout Français doit lire ce livre
À l’étranger, les versions anglaises, turques, arabes ou japonaises s’appuient sur des traductions parfois édulcorées ou tronquées. Pendant 70 ans, les autorités bavaroises, héritières des droits postérieurs à la mort d’Hitler, s’opposent à toute réédition. Mais l’interdiction n’empêche ni la diffusion clandestine, ni la prolifération numérique du texte dans les années 2000.
En Turquie, Mein Kampf devient un véritable phénomène de librairie, avec 80 000 exemplaires écoulés en 2005. Au Japon, il est adapté en manga et dépasse les 100 000 ventes. Preuve que la propagande d’hier continue de séduire des franges radicalisées du XXIe siècle.
Comment republier l’horreur ? Le défi des éditions critiques
Le basculement survient en 2016, lorsque Mein Kampf tombe dans le domaine public. En Allemagne, l’Institut d’histoire contemporaine de Munich publie une édition critique annotée, intitulée Eine kritische Edition, vendue à plus de 100 000 exemplaires. Objectif : contextualiser, démonter, neutraliser la charge idéologique de l’ouvrage.
En France, les éditions Fayard prennent le relais en 2021 avec Historiciser le mal, sous la direction de Florent Brayard. Le texte original d’Hitler y est encadré par des centaines de pages d’analyse historique, politique et linguistique, afin d’en démontrer les ressorts toxiques.
Mais une telle démarche divise : pour certains, elle banalise le mal ; pour d’autres, elle répond à un impératif pédagogique. Peut-on « désarmer » un livre en le décortiquant ? Faut-il montrer l’idéologie nazie pour mieux la combattre, ou risquons-nous de nourrir un culte souterrain ?
Une chose est sûre : Mein Kampf reste un objet brûlant. Symbole du mal radical, il nous rappelle que les mots peuvent tuer, surtout lorsqu’ils sont érigés en programme politique.