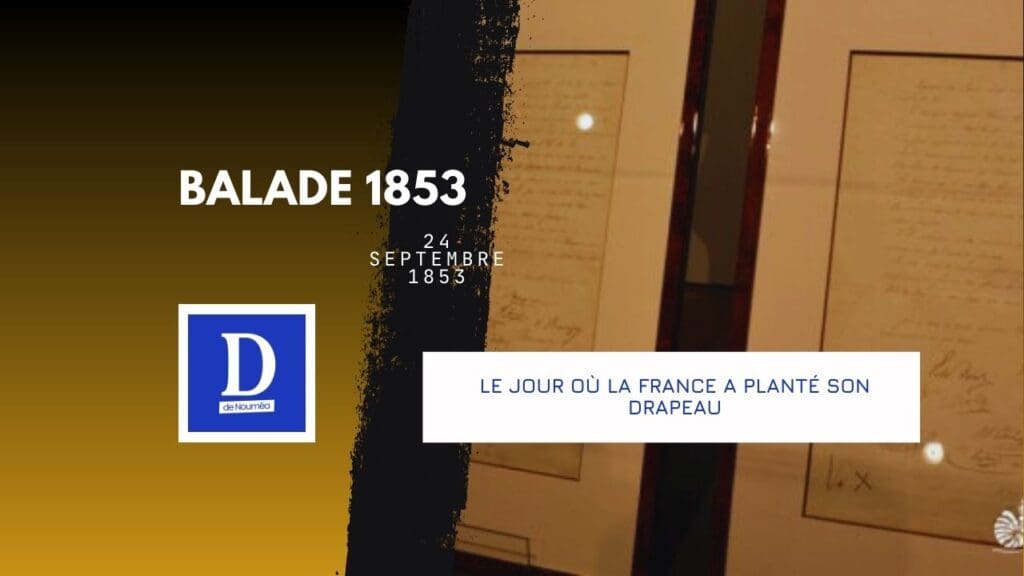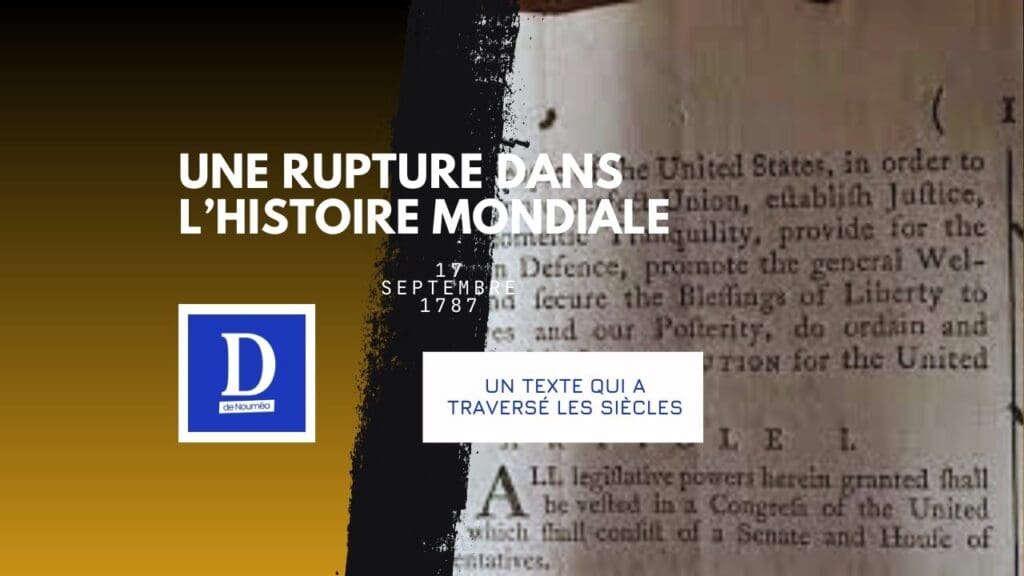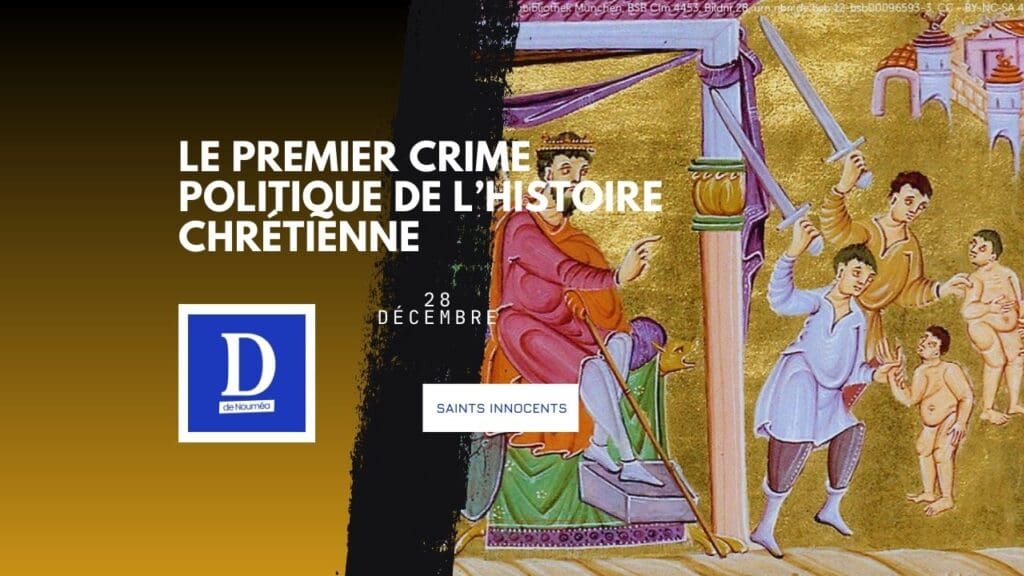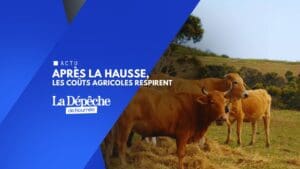En 1834, Louis-Philippe institutionnalise la conquête de l’Algérie. Loin d’une simple expédition, elle devient un chantier impérial, politique et militaire.
Une domination imposée à feu et à sang, entre prestige dynastique et enjeux stratégiques.
Une guerre de prestige pour la Monarchie de Juillet
La conquête de l’Algérie est d’abord une réponse à une instabilité politique en métropole. En difficulté dès 1830, Louis-Philippe cherche un levier pour renforcer son autorité. La reprise de la campagne algérienne devient un instrument symbolique de pouvoir.
La prise d’Alger en juillet 1830, initiée par Charles X, est d’abord une opération de diversion politique. Mais la Monarchie de Juillet hérite de cette conquête inachevée. Le nouveau roi la transforme en outil de légitimation : il s’agit associer la dynastie d’Orléans à une victoire coloniale. Ses fils, Ferdinand-Philippe et le duc d’Aumale, sont envoyés au front pour incarner la gloire militaire.
Le conflit est intense. Face à Abd el-Kader, chef militaire charismatique et stratège de la guérilla, la France déploie jusqu’à 100 000 hommes. Bugeaud, Clauzel, Baraguey d’Hilliers mènent une guerre violente : enfumades, sièges, représailles massives, rien n’est épargné afin de briser la résistance. La victoire finale, en 1847, marque l’effondrement de l’émirat d’Abd el-Kader.
Une colonisation militaire aux contours flous
Le projet colonial est d’abord improvisé. En 1834, une ordonnance royale crée un gouvernement général pour les « possessions françaises du nord de l’Afrique », sans définir leur statut. Ce flou administratif reflète une hésitation stratégique : l’Algérie n’est pas encore une colonie, mais déjà plus qu’un territoire occupé.
L’armée devient le bras principal de cette expansion. En plus des troupes venues de métropole, des unités locales sont intégrées : spahis, tirailleurs, issus des tribus, ainsi que les zouaves. Une armée d’Afrique multinationale, pensée pour contrer les tactiques d’Abd el-Kader.
Parallèlement, la création des « bureaux arabes » dès 1844 marque l’amorce d’une administration mixte. Des élites locales collaborent. L’exemple de Mustapha ben Ismaïl illustre cette stratégie d’alliance. Mais la distinction entre civils et militaires, entre indigènes et colons, reste nette et structurante.
Enfin, malgré l’annexion de Constantine ou la fondation de villes comme Philippeville ou Orléansville, la colonisation foncière progresse lentement. Les terres sont accaparées, les structures juridiques coloniales se mettent en place, mais l’organisation reste rudimentaire jusqu’aux années 1850.
Une conquête sous-tendue par des logiques géopolitiques
Si l’on parle souvent du prestige monarchique ou du choc des civilisations, l’expansion algérienne est aussi une réponse à des enjeux économiques et géostratégiques.
La France, affaiblie depuis le traité de Paris de 1763, veut réaffirmer sa puissance maritime en Méditerranée, face à l’Angleterre. En s’installant en Algérie, elle sécurise un point d’appui face à Gibraltar, menace les routes commerciales britanniques et réactive un vieux rêve impérial.
L’intérêt commercial est évident. L’Algérie, avec son littoral fertile et son climat méditerranéen, est propice à la vigne, à l’olivier et à l’agriculture coloniale. Les chambres de commerce de Toulon ou d’Alger s’y investissent. L’arrière-pays reste délaissé, mais les villes côtières sont rapidement investies, renforçant une logique de comptoirs commerciaux.
Cette conquête est aussi l’écho d’un orientalisme romantique. Le monde ottoman fascine les élites culturelles françaises. L’Algérie devient le fantasme d’un Orient proche, une extension naturelle de la Provence. Des artistes, écrivains et peintres participent à cette construction mentale, renforçant l’adhésion à une colonisation perçue comme civilisatrice.
La conquête de l’Algérie sous Louis-Philippe n’est pas une simple opération militaire. C’est un projet hybride, mêlant politique intérieure, prestige royal, géopolitique et intérêts économiques.
Elle s’appuie sur une armée omniprésente, une administration hésitante, et une idéologie orientalisante qui justifie l’occupation.
Le 22 juillet 1834 marque une étape clé : la France affirme sa présence dans le nord de l’Afrique, mais sans encore en faire une colonie au sens strict.
La chute d’Abd el-Kader en 1847 ne clôt pas l’histoire, elle l’ouvre : celle d’une colonisation longue, brutale, et profondément structurante pour les deux rives de la Méditerranée.