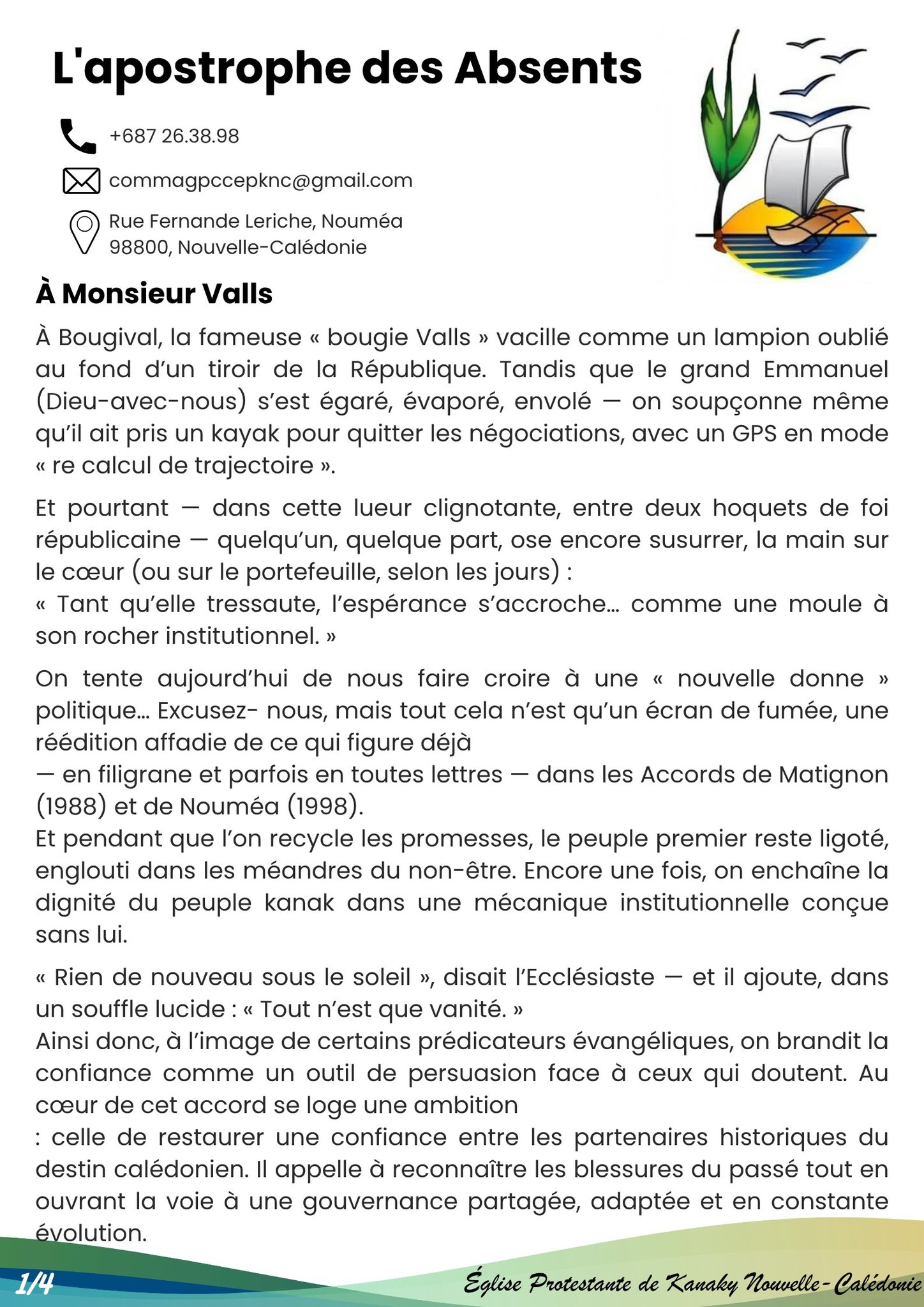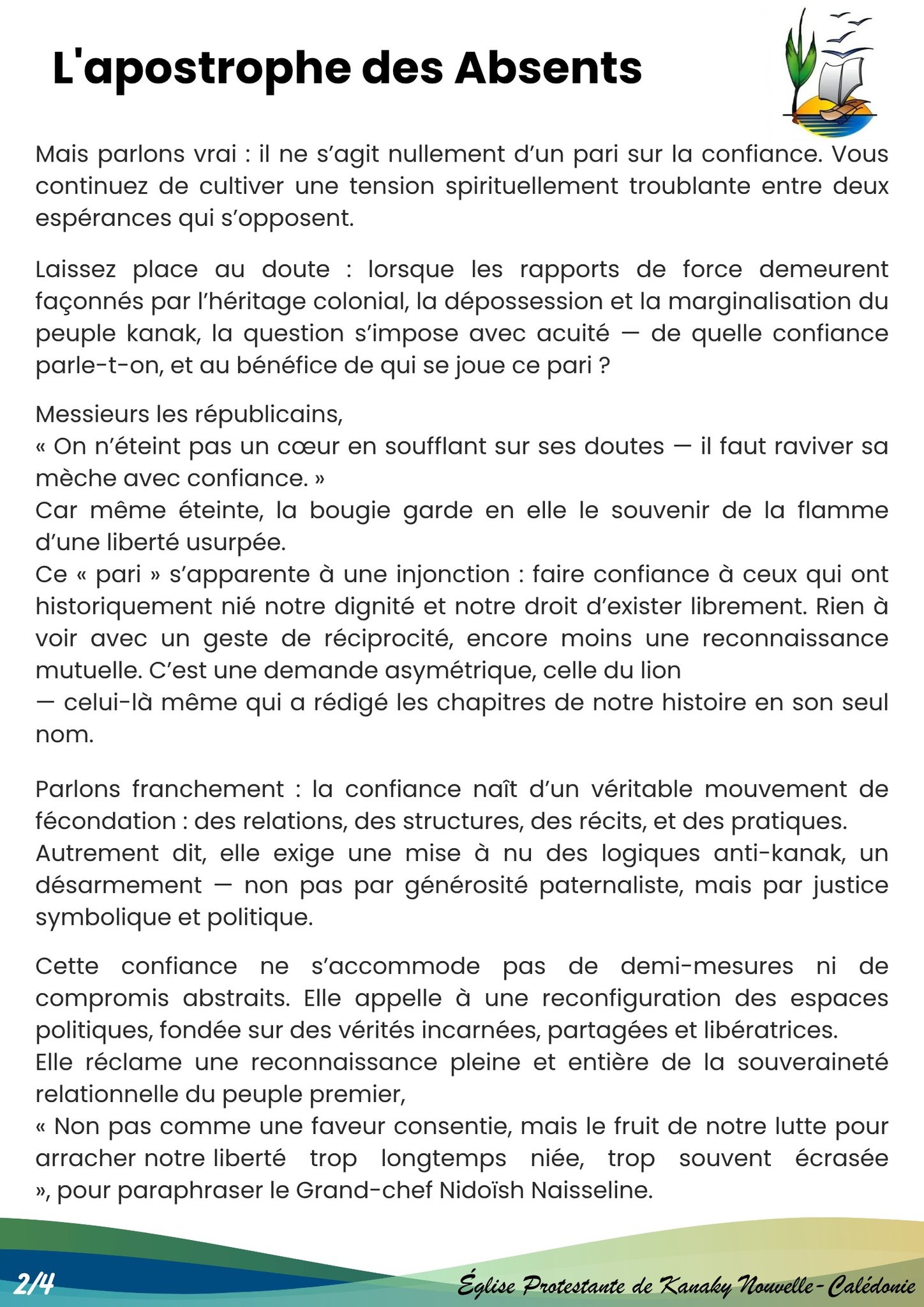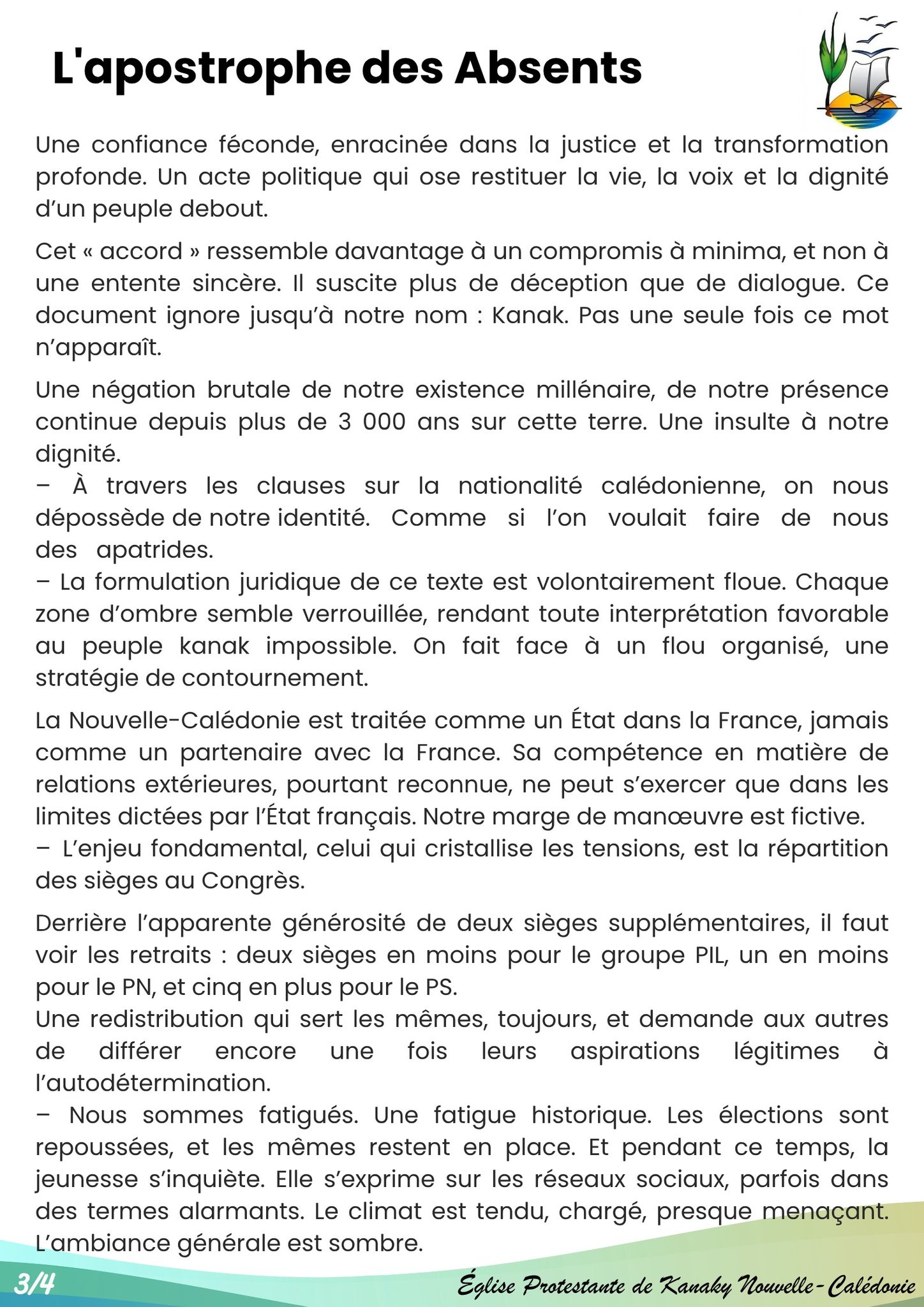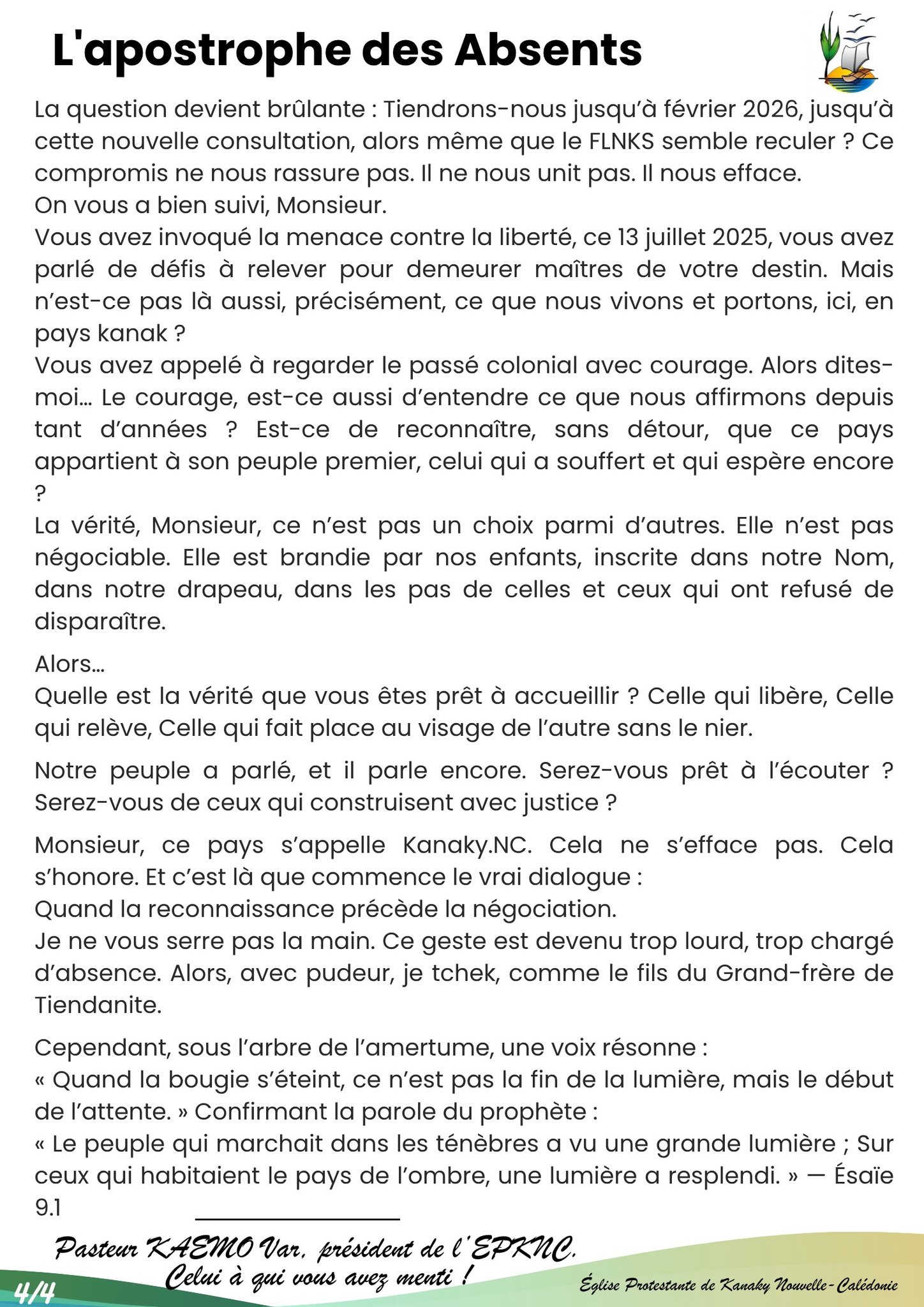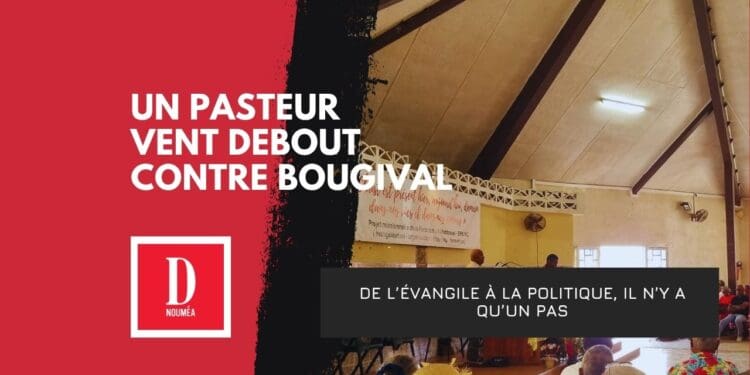Dans une tribune intitulée L’Apostrophe des absents, le président de l’Église protestante de Kanaky-Nouvelle-Calédonie (EPKNC), KAEMO Var, choisit de sortir de son rôle spirituel pour endosser les habits du militant politique. Derrière des envolées lyriques et des références à la foi, c’est un discours résolument politique qu’il nous livre. Un discours qui brouille volontairement les frontières entre la chaire et l’Assemblée, entre le spirituel et le temporel. Et qui mérite qu’on remette les choses à leur place.
Une charge contre l’accord de Bougival
KAEMO Var rejette l’accord de Bougival, qu’il décrit comme un « nouveau marché de dupes ». Il dénonce l’absence du mot « Kanaky » dans le texte, comme si une négociation institutionnelle devait être dictée par les slogans et non par le droit. Ce qu’il feint d’oublier, c’est que l’accord a été signé par les représentants des grandes sensibilités politiques du pays – indépendantistes compris. Que certains aient choisi ensuite de s’en désolidariser ne réécrit pas l’histoire.
Il affirme que « rien n’a changé » et que l’État persiste à mépriser le peuple premier. Mais ce sont là des postures. Car si l’État est perfectible, il n’a cessé, depuis les Accords de Matignon et de Nouméa, de reconnaître la singularité kanak, d’engager des transferts de compétences, de financer la formation, le logement, la santé. Prétendre qu’il ne reconnaît rien, c’est tout simplement malhonnête.
Le religieux au service d’un agenda idéologique
Le plus préoccupant n’est pas tant le fond que la forme. Ce texte est celui d’un responsable religieux qui utilise sa position pour porter un message politique radical. Il parle de « foi lucide », de « lutte », de « souffrance sacrée », de « réconciliation sans justice ». La République ne s’oppose pas à la foi. Mais elle impose qu’elle reste dans la sphère privée. Ce que dit la loi de 1905, ce que garantit notre pacte laïque, c’est une séparation stricte entre les Églises et l’État.
Autrement dit : qu’un pasteur guide ses fidèles, oui. Qu’il dicte la politique du territoire, non.
Le texte de l’EPKNC est une tentative assumée de brouiller cette frontière. Il s’érige en contre-pouvoir moral, comme si la République devait se soumettre à un tribunal éthique religieux. Mais ce n’est pas cela, la démocratie. Ce n’est pas ainsi qu’on construit un avenir commun.
Le poison de la défiance
KAEMO Var accuse l’État de manipulations, de mensonges, de marginalisation. Il alimente un récit victimaire sans issue. Il oppose foi et institutions, mémoire et avenir, justice et négociation. Il refuse même la poignée de main – préférant un « tchek » symbolique, censé dire que le dialogue ne peut commencer qu’après reconnaissance totale.
Mais la reconnaissance n’est pas un préalable à la négociation. Elle en est l’aboutissement. La France a reconnu, dans tous ses textes, l’identité kanak. Elle a ouvert la porte à tous les possibles – y compris l’indépendance, si le peuple la choisit. Que faut-il de plus ? Une République à genoux ?
Une mise au point nécessaire
Dans une démocratie, chacun a sa place. Les représentants religieux dans les lieux de culte. Les élus dans les institutions. Les militants dans les partis. La République ne chasse personne. Elle inclut. Mais elle pose des règles. Et la première d’entre elles, c’est que nul ne peut imposer sa vérité au nom de Dieu.
Ce texte de l’EPKNC n’est pas un appel à la paix. C’est une prise de position politique dissimulée derrière une croix. Une confusion des genres qu’il faut dénoncer avec fermeté. Car dans une société déjà fracturée, ce type de discours ne rassemble pas. Il divise.
La République est notre bien commun. Elle est laïque, indivisible, et elle garantit la liberté de croire… comme celle de ne pas croire. Elle ne reconnaît aucune Église comme autorité politique. Et elle ne pliera pas devant ceux qui veulent réintroduire le religieux dans la conduite des affaires publiques.
Il est temps que cela soit dit clairement : quand les pasteurs se mêlent de politique, c’est à la République de rappeler les limites.