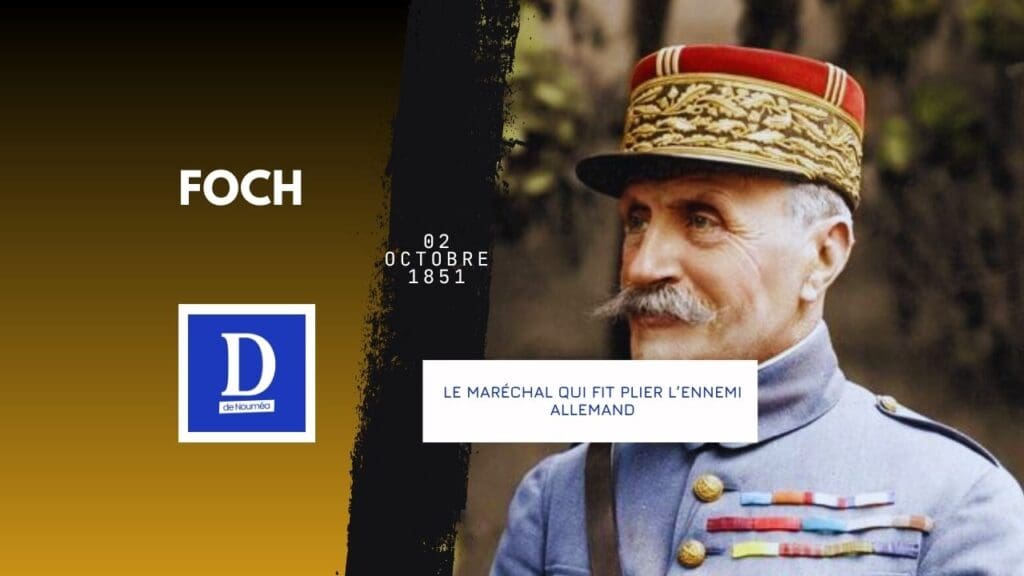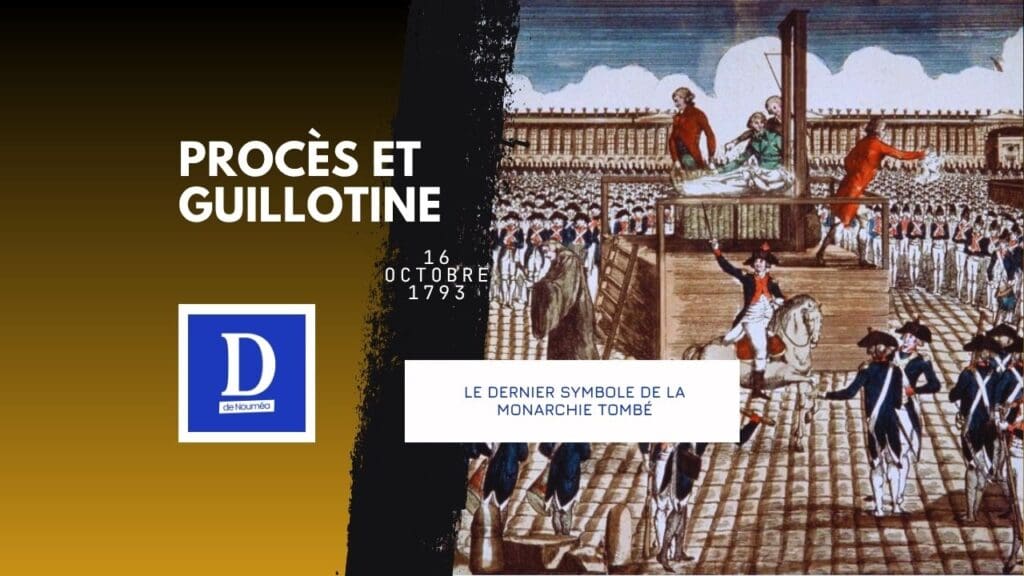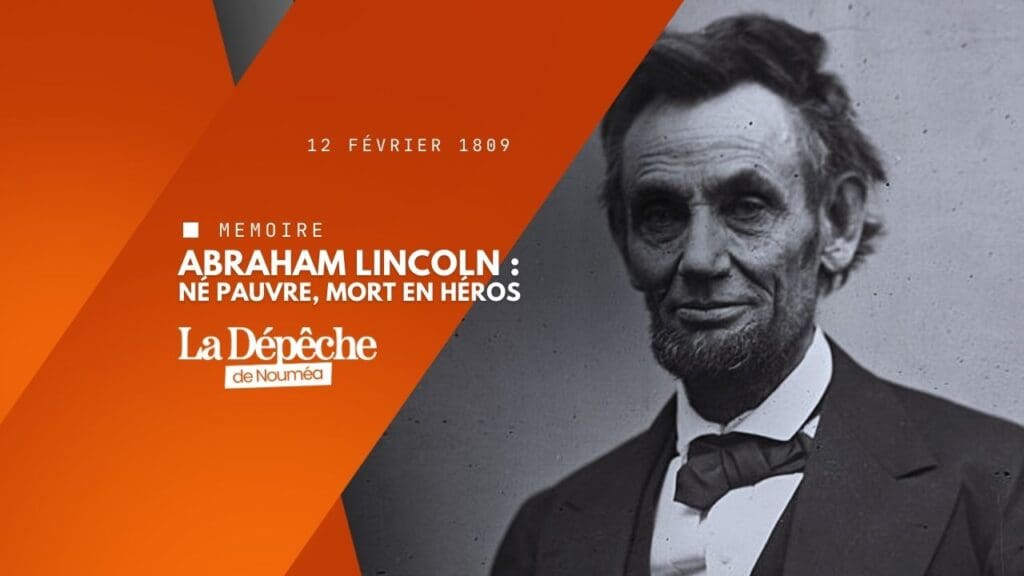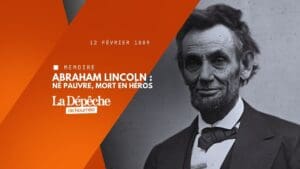À l’aube du XIVᵉ siècle, le Japon faillit basculer sous le joug des plus redoutables conquérants de l’Histoire. Mais un vent providentiel changea son destin. Face à l’armada mongole, la nature elle-même s’invita dans la bataille.
Kubilaï Khan, maître de l’Asie… sauf du Japon
Petit-fils de Gengis Khan, Kubilaï régnait sur un empire colossal, administrant la Chine sous la dynastie Yuan et s’imposant comme le souverain le plus puissant de son temps.
En 1268, il tenta la voie diplomatique : une ambassade exigea du shogun japonais l’hommage dû à un vassal. Refus net. Les missives suivantes, interprétées comme des menaces, restèrent lettre morte.
En 1274, une première expédition mongole débarqua à Kyushu : 900 navires et environ 30 000 hommes, dont des troupes coréennes. Les samouraïs, mal préparés et peu familiers des tactiques de combat de masse, subirent de lourdes pertes. Mais un typhon soudain mit fin à cette première offensive et contraignit les envahisseurs à se retirer.
1281 : l’assaut décisif… et le typhon fatal
Sept ans plus tard, Kubilaï lança l’offensive finale : 4 400 navires et près de 140 000 soldats, soit la plus grande flotte jamais rassemblée jusqu’alors. Les troupes débarquèrent dans la baie de Hakata, utilisant la poudre à canon et des arcs plus puissants que ceux des Japonais.
Les combats furent sanglants : les samouraïs privilégiaient l’affrontement individuel, tandis que les Mongols avançaient en formation serrée, utilisant flèches empoisonnées et projectiles explosifs.
Alors que la victoire mongole semblait inévitable, un typhon d’une violence extrême s’abattit sur la flotte ancrée au large. Les jonques, mal adaptées aux tempêtes, furent pulvérisées : des dizaines de milliers d’hommes périrent noyés.
Un mythe fondateur, de la guerre médiévale aux kamikazes de 1945
Après cet échec monumental, les Mongols n’osèrent plus jamais tenter l’invasion du Japon.
Le récit du kamikaze entra dans la mémoire nationale, symbole d’une protection divine de l’archipel. Des siècles plus tard, l’Empire du Japon réutilisa ce mythe : en 1944-1945, les pilotes-suicides furent baptisés en référence à ce « vent divin » censé repousser l’envahisseur.
Historiquement, l’épisode de 1281 reste une leçon stratégique : un adversaire, même surpuissant, peut être brisé par un imprévu climatique. Mais il rappelle aussi qu’au-delà des armes, c’est parfois la nature qui décide de l’issue des guerres.