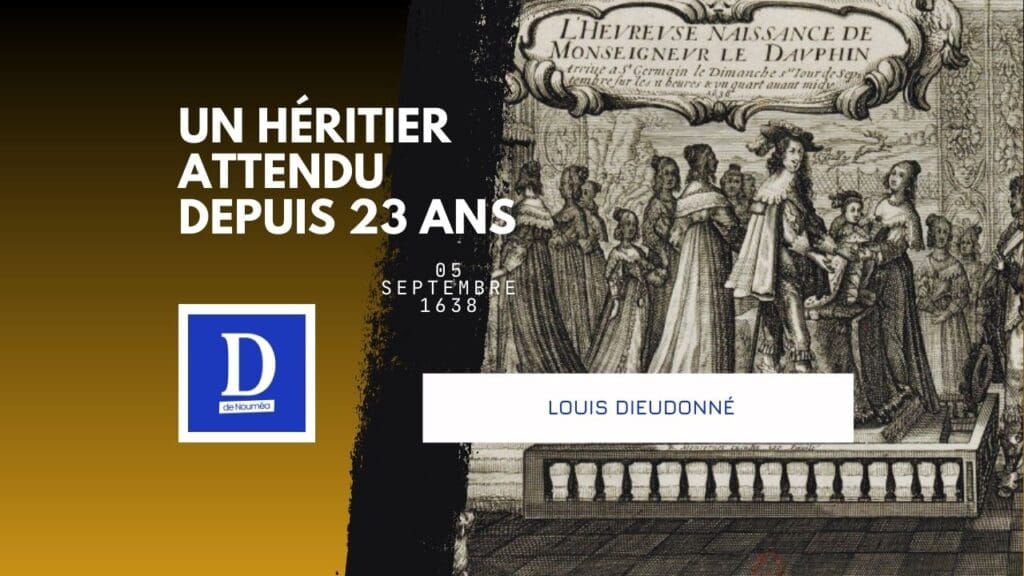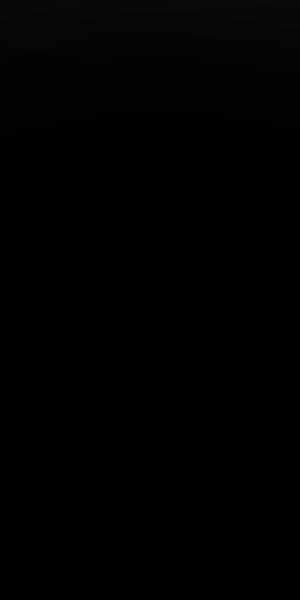Un roi promis à l’ombre est propulsé dans la lumière de l’Histoire. Entre grandeur héritée et tragédie écrite, Louis XVI incarne la chute d’un monde.
Louis XVI : l’héritier inattendu devenu roi des Français
Fils du dauphin Louis-Ferdinand et de Marie-Josèphe de Saxe, Louis-Auguste naît à Versailles le 23 août 1754. Troisième fils d’une fratrie fragile, il ne devait pas régner. La mort précoce de ses frères en fait pourtant le dauphin à seulement onze ans. Élevé dans la rigueur par le duc de La Vauguyon, il brille dans les études : langues, sciences, histoire, géographie. Passionné par la serrurerie et l’horlogerie, il reste toutefois un prince timide, peu préparé aux exigences du pouvoir.
Son mariage, célébré en 1770 avec Marie-Antoinette d’Autriche, scelle l’alliance des Bourbons et des Habsbourg. Le couple royal, malgré des débuts difficiles, donnera naissance à quatre enfants, dont le malheureux Louis XVII, mort captif à dix ans.
Le 10 mai 1774, à la mort de son grand-père Louis XV, il devient roi sous le nom de Louis XVI. Le peuple nourrit une immense attente ; l’Histoire lui impose un poids immense. Le jeune souverain croit répondre à l’espérance en rendant aux parlementaires le droit de remontrance. Mais ce choix inaugure une suite d’erreurs politiques, où sa faiblesse de caractère se révèle fatale.
Un règne marqué par les réformes avortées et la crise
Louis XVI est un homme cultivé, honnête, sincèrement attaché à son peuple. Mais son incapacité à trancher mine son règne. Les ministres réformateurs – Turgot, Necker, Calonne – échouent tour à tour à imposer des mesures pour sauver les finances de la monarchie. Les crises économiques et frumentaires attisent la colère des foules. La monarchie vacille, affaiblie par l’affaire du Collier et les pamphlets scandaleux visant la reine.
Le roi se heurte à une noblesse arc-boutée sur ses privilèges et à un Tiers-État qui réclame justice. Conscient des périls mais incapable de gouverner avec fermeté, il convoque en 1789 les États généraux, ultime tentative de compromis. La prise de la Bastille, le 14 juillet, bouleverse l’équilibre. La monarchie est contrainte de se réinventer.
De Varennes à l’échafaud : le roi déchu
Le 5 octobre 1789, le peuple marche sur Versailles. Le roi et sa famille sont contraints de s’installer à Paris, prisonniers des Tuileries. Dans la nuit du 20 juin 1791, Louis XVI tente de fuir vers Montmédy. Arrêté à Varennes, ramené humilié à Paris, il perd définitivement la confiance d’un peuple qui le juge traître à la Nation.
La Constitution de 1791 le réduit au rôle de « roi des Français », désormais soumis à la loi. Mais l’homme, blessé par la Constitution civile du clergé, oppose son veto. L’Europe s’embrase : l’Autriche et la Prusse menacent la France, et le roi est accusé de collusion. Le 10 août 1792, les Tuileries tombent sous la pression des sans-culottes. La monarchie est abolie.
Le procès s’ouvre en décembre. Louis XVI, digne mais résigné, se défend sans haine. Le 17 janvier 1793, la Convention vote sa mort à une courte majorité. Le 21 janvier, sur la place de la Révolution, Louis XVI est guillotiné, laissant à la postérité l’image d’un roi honnête mais dépassé, victime de son indécision et de la radicalité révolutionnaire.
Louis XVI n’était pas le tyran dépeint par ses ennemis, mais un roi faible dans une époque qui exigeait de la force. Son destin rappelle qu’en politique, l’hésitation peut tuer autant que l’erreur. Sa mort marque la fin de l’Ancien Régime et l’entrée de la France dans une ère nouvelle, faite de révolutions, d’instabilité et de sang.