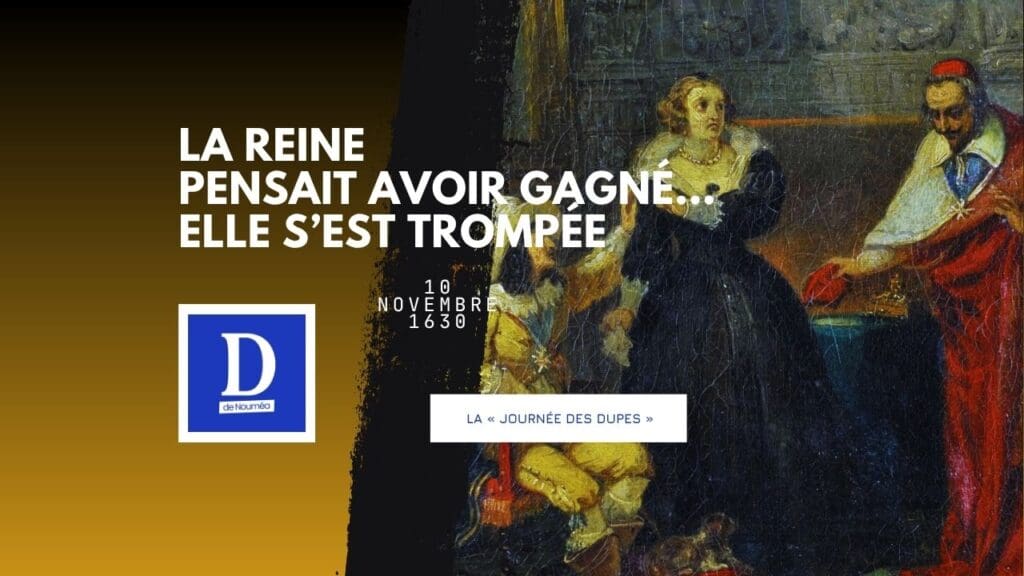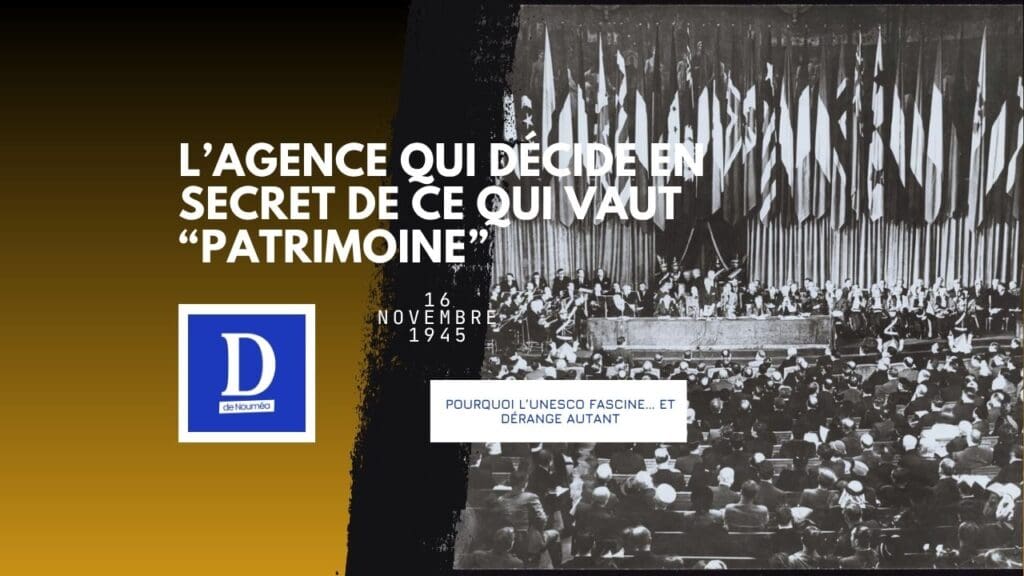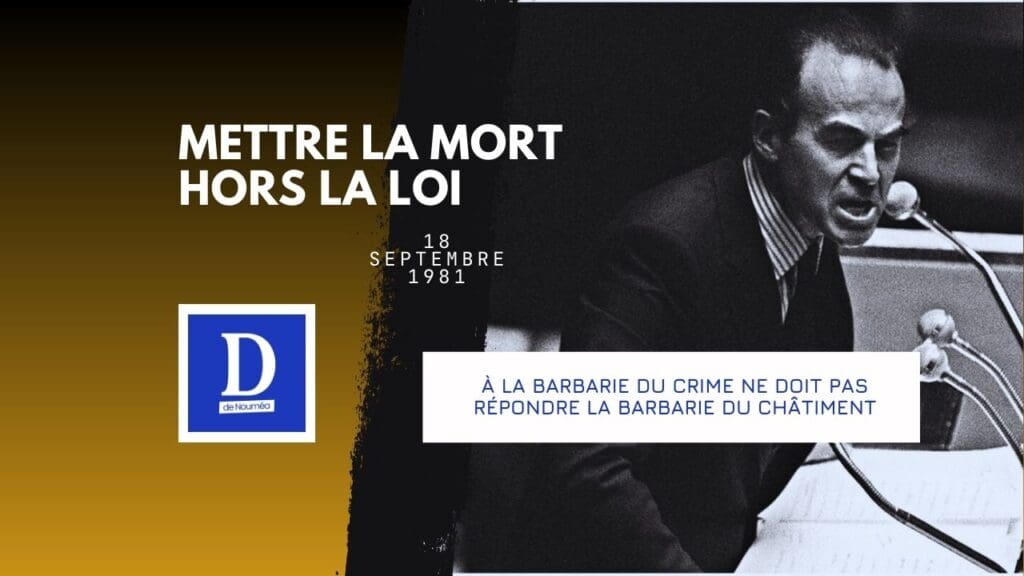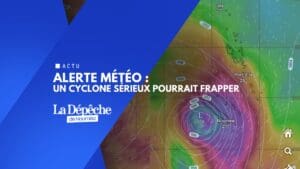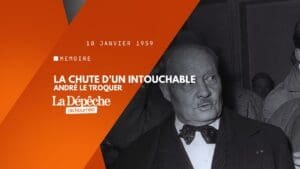Deux siècles et demi plus tard, ce texte continue d’irriguer la France républicaine. Né dans la tourmente révolutionnaire, il reste le socle de nos libertés modernes.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen : l’acte fondateur de la Révolution
Le 26 août 1789, dans la salle du Jeu de Paume à Versailles, l’Assemblée nationale constituante adopte un texte appelé à une immense postérité : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Fruit des réflexions des Lumières et des expériences politiques anglo-saxonnes, ce texte de 17 articles se veut une synthèse universelle des droits fondamentaux.
Inspirée par le Bill of Rights anglais de 1689 et la Déclaration d’indépendance américaine de 1776, la France révolutionnaire a voulu offrir au monde un texte volontairement simple, d’une clarté et d’une portée intemporelles.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits : la formule lapidaire de l’article premier résume l’ambition de tout un peuple.
La Déclaration proclame la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété, la résistance à l’oppression. Elle affirme la souveraineté nationale, la séparation des pouvoirs, la liberté d’expression et de conscience. Sans référence explicite ni à une religion ni à un régime politique, elle se pose comme un préambule universel à toute Constitution.
Louis XVI, pourtant hostile à cette démarche, finit par la ratifier sous la pression populaire le 5 octobre 1789. Trois ans plus tard, la monarchie disparaîtra, mais le texte survivra, preuve que la Révolution a d’abord voulu poser des principes avant de bâtir des institutions.
Un texte universel et intemporel
La force de la Déclaration de 1789 réside dans sa clarté et sa portée universelle. En quelques lignes, elle met fin à l’arbitraire et jette les bases de la modernité politique.
Elle ne distingue pas entre les sexes : le mot « Homme » s’entend ici au sens générique, englobant l’ensemble des êtres humains. Cette lecture a d’ailleurs été confirmée en 1948 par les rédacteurs français de la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée à l’ONU.
Le texte ne cite ni le roi ni l’Église. Il se contente d’invoquer « l’Être suprême », ouvrant la voie à la liberté religieuse et à la neutralité de l’État. Ce refus de toute référence confessionnelle en fait un texte à vocation planétaire.
Son article 9 proclame la présomption d’innocence, rejetant les lettres de cachet de l’Ancien Régime. Son article 17 consacre le droit de propriété comme inviolable et sacré. Son article 11 défend la liberté de communication des idées et des opinions, jetant les bases de la liberté de la presse.
Par son universalité, la Déclaration à vocation à s’appliquer à tous les temps et à toutes les sociétés. Elle inspire encore aujourd’hui des textes constitutionnels, des conventions internationales et la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui la reconnaît comme ayant pleine valeur constitutionnelle.
Héritage et actualité d’un texte fondateur
Depuis plus de deux siècles, la Déclaration de 1789 demeure au cœur du droit français. Elle figure en tête de la Constitution de 1791, puis a été confirmée dans le Préambule de la Constitution de la IVe République en 1946, et enfin dans celui de la Constitution de 1958, toujours en vigueur.
Elle constitue un socle juridique sur lequel repose notre République. Sans elle, ni la liberté d’expression, ni la séparation des pouvoirs, ni le consentement à l’impôt n’auraient de base solide.
Ce texte a aussi inspiré les mouvements démocratiques dans le monde. En Amérique latine, en Europe de l’Est, en Afrique, de nombreux peuples ont revendiqué les principes de 1789 pour briser les chaînes de la tyrannie.
Aujourd’hui encore, son actualité frappe par sa modernité. Alors que certains remettent en cause les valeurs démocratiques, la Déclaration de 1789 rappelle que les droits de l’homme sont naturels, inaliénables et sacrés. Elle n’est ni un vestige du passé ni une curiosité d’archives : elle demeure le socle de notre identité nationale et de notre contrat républicain.
La Révolution française a voulu que la loi protège le faible comme le puissant, que les citoyens soient égaux devant l’impôt, que la liberté ne soit limitée que par la liberté d’autrui. Ces principes continuent de guider la France et d’inspirer les peuples du monde.