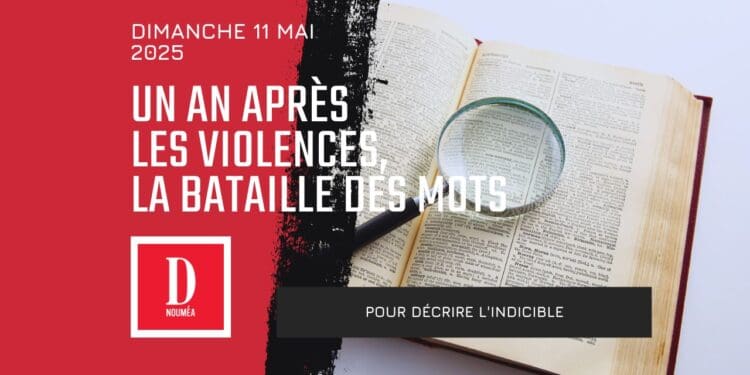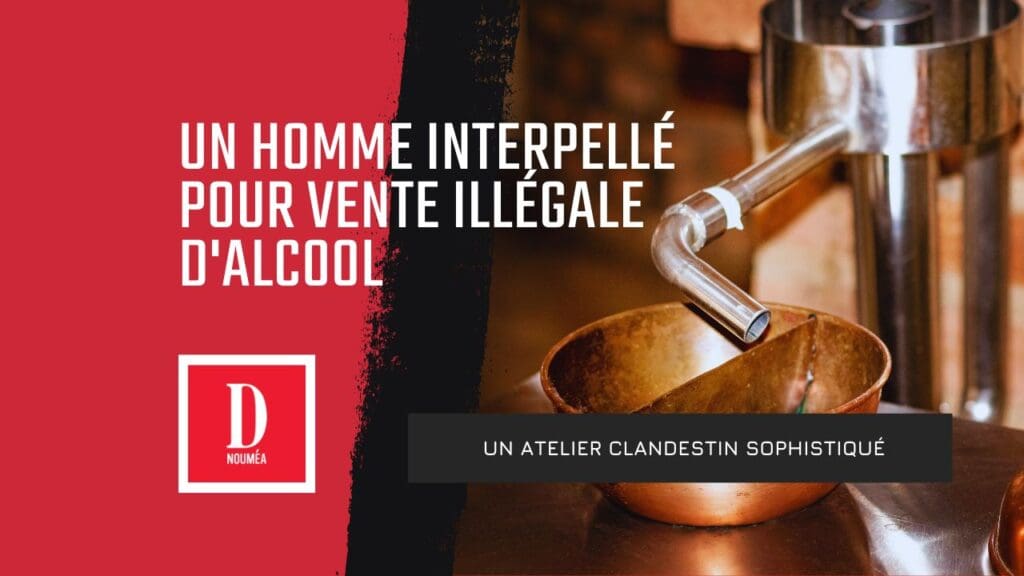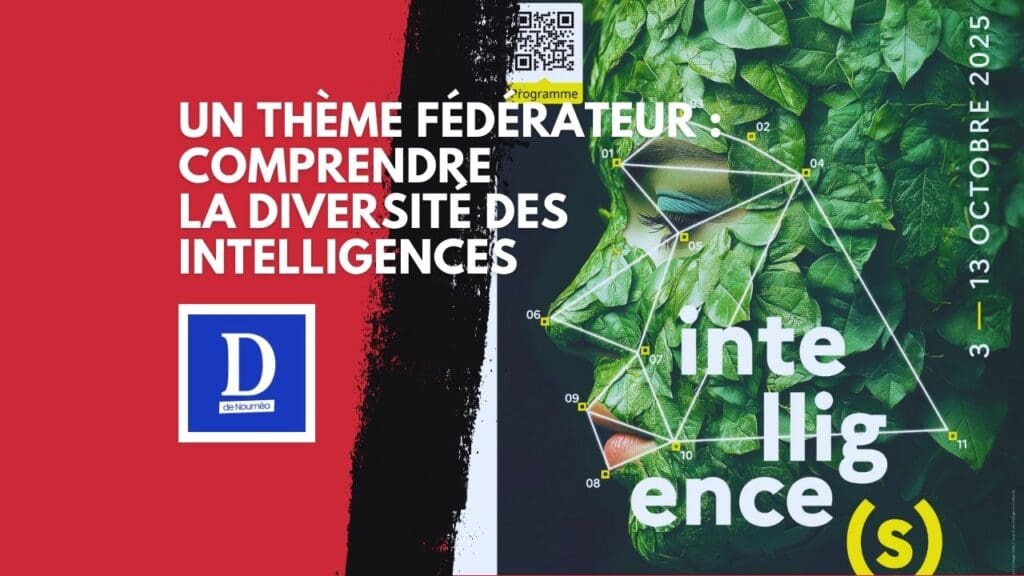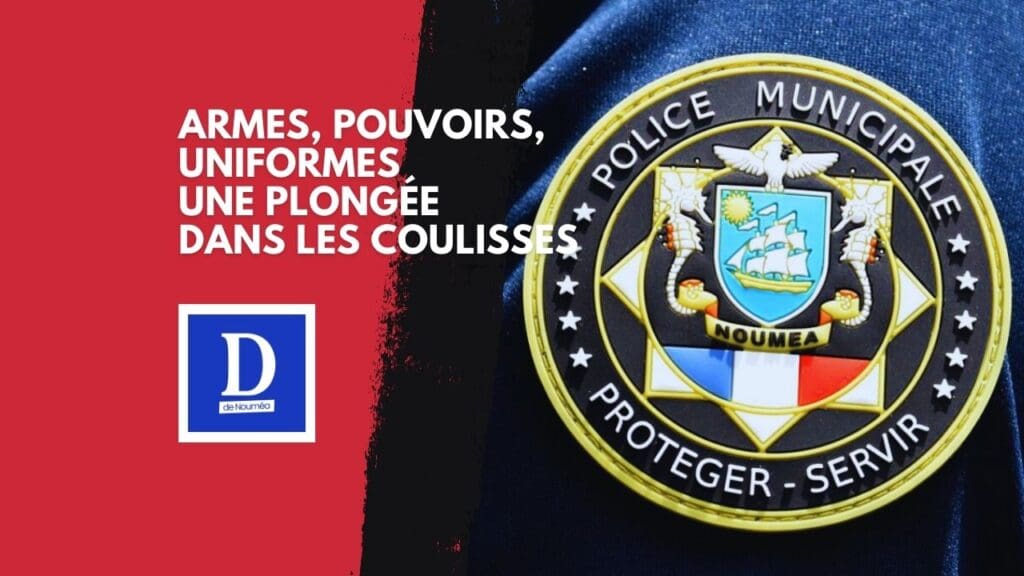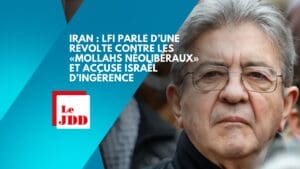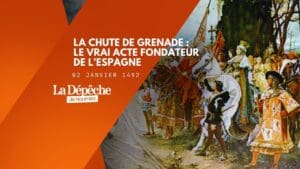Une pluralité de termes pour un même événement
Un an après les violences qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie en mai 2024, la diversité des termes utilisés pour qualifier ces événements révèle les profondes divisions de la société calédonienne. « Émeutes« , « exactions« , « événements« , « insurrection« , « soulèvement« , « révolte » ou encore « coup d’État manqué » – chaque dénomination porte en elle une vision différente de ce qui s’est produit.
« Cette variété lexicale est parlante. Elle montre qu’il n’y a pas de consensus un an après, et que différentes interprétations coexistent« , analyse Véronique Fillol, maîtresse de conférences en sciences du langage à l’Université de Nouvelle-Calédonie.
Le poids politique des mots
Les chercheuses soulignent que le choix des termes n’est jamais neutre :
– « Émeutes » : Associé aux violences urbaines (comme en France en 2005 ou 2023)
– « Exactions » : Terme employé dans le journal officiel, évoquant des « sévices commis à l’égard d’une population »
– « Insurrection » : Vocabulaire utilisé par l’État (Emmanuel Macron parlait d’un « mouvement d’insurrection inédit »)
– « Révolte kanak » : Terminologie privilégiée par la CCAT et le FLNKS
– « Coup d’État manqué » : Expression employée par les Loyalistes dans un rapport à l’ONU
« Derrière chaque mot, il y a des enjeux de pouvoir et des idéologies« , précise Elatiana Razafi, collègue de Véronique Fillol. « Prenez le terme ‘émeutiers’ – il véhicule une certaine image (jeune, masculine…) mais est-ce que les concernés se reconnaissent dans cette étiquette ? »
Traumatisme collectif et difficulté à nommer
Les universitaires expliquent cette profusion terminologique par la violence du traumatisme subi :
– Expériences vécues très différentes selon les communautés et les lieux
– Difficulté à conceptualiser collectivement ce qui s’est produit
– Héritage historique des « Événements » des années 1980 (terme lui-même euphémistique)
« Comme c’est quelque chose de violent, de traumatisant, il y a un enjeu à décrire tout ce qu’on a vécu. Sauf qu’on ne sait pas comment le décrire« , constate Véronique Fillol.
Les définitions officielles et leurs implications
L’analyse des dictionnaires révèle les connotations de chaque terme :
– Émeute (Larousse) : « Soulèvement populaire, mouvement, agitation, explosion de violence »
– Insurrection (Robert) : « Soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi »
– Révolte : « Action violente pour s’opposer à l’autorité établie »
– Événements (Académie française) : « Faits dont on ne sait pas, ou ne souhaite pas, préciser la nature exacte »
Un dialogue encore à reconstruire
Un an après, le débat sur la terminologie reflète les fractures persistantes :
– Absence de récit commun sur ce qui s’est produit
– Jeunesse en quête de reconnaissance de son vécu
– Nécessité d’un travail de mémoire et de dialogue
« Je n’ai pas l’impression que collectivement, on partage tous les mêmes interprétations de ce qui s’est passé il y a un an« , conclut Véronique Fillol. « Il y a une nécessité de renouer le dialogue, d’aller à l’écoute des jeunes. »
Cette bataille sémantique, loin d’être anecdotique, révèle les défis qui attendent la Nouvelle-Calédonie pour surmonter ce traumatisme et construire un avenir commun. Comme le résume une publication citée par les chercheuses : « Nos mots racontent l’histoire. Le 13 mai, ce n’est pas ‘les événements’.«