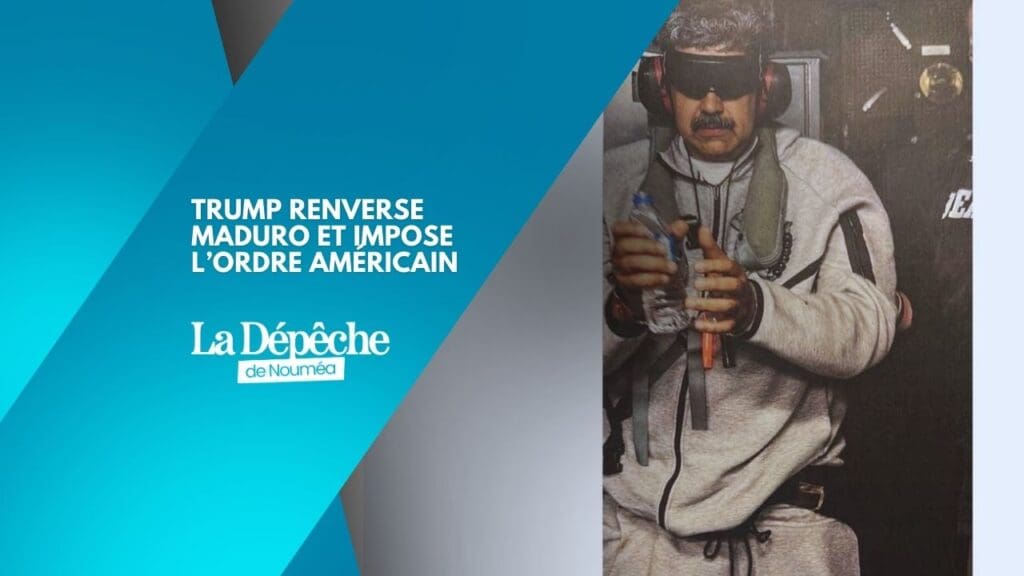Le 2 septembre marque le Jour de la démocratie au Tibet, une date instituée par le gouvernement tibétain en exil. Si la Chine vante une « autonomie régionale », la réalité est celle d’une répression constante, avec un peuple privé de ses libertés fondamentales. Cette journée invite à réfléchir sur le sens de la démocratie, en résonance avec les débats actuels sur la liberté politique dans le monde.
La démocratie tibétaine, une idée en exil
Chaque année, la diaspora tibétaine commémore cette journée instaurée en 1960 par le Dalaï-Lama. Depuis Dharamsala, en Inde, le gouvernement tibétain en exil organise des cérémonies qui rappellent que la démocratie ne se résume pas à un mot, mais à la capacité d’un peuple de choisir librement ses dirigeants et de défendre sa culture. Le contraste est saisissant avec la situation au Tibet, où Pékin impose une tutelle autoritaire.
Pékin et la fiction de l’autonomie
Officiellement, le Tibet est une « région autonome » de la Chine. Dans les faits, les autorités communistes exercent un contrôle étroit sur la religion, l’éducation, la langue et même les déplacements. Des ONG dénoncent régulièrement des arrestations arbitraires, une surveillance massive et la disparition progressive de l’identité tibétaine. Derrière le discours de modernisation et d’intégration économique, Pékin impose une assimilation forcée qui vide de sens toute référence à l’autonomie.
Un message universel sur la liberté politique
Au-delà du Tibet, cette journée a une résonance internationale. Elle rappelle que la démocratie est toujours fragile face aux régimes autoritaires. En Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, le débat sur l’équilibre entre institutions, libertés et respect des peuples est d’actualité.
Nous ne demandons pas la lune. Nous voulons simplement avoir le droit de vivre notre culture, de parler notre langue et de croire librement
confie un membre de la communauté tibétaine en exil.