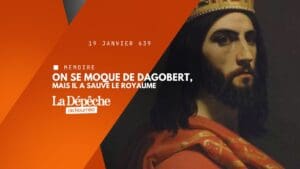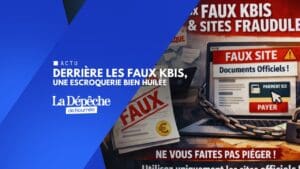Ils ont 20 ans et un seul rêve : fuir la Calédonie. L’exode silencieux d’une génération oubliée.
Une jeunesse sacrifiée, silencieusement en fuite
Ils partent par dizaines, chaque mois. Vers l’Australie, la France, le Canada, parfois même la Polynésie. Ils laissent derrière eux une terre natale qu’ils aiment, mais qu’ils ne supportent plus. Car en Nouvelle-Calédonie, quand on a entre 18 et 25 ans, l’horizon se résume trop souvent à la précarité, à l’ennui ou au piston.
Cet exode de la jeunesse calédonienne est massif, progressif, et profondément alarmant. Il ne fait pas de bruit, mais il vide les campus, les associations, les entreprises. Et surtout : il brise le lien générationnel dans une société qui prétend vouloir préparer l’avenir.
Pas d’emploi, pas de logement, pas de place : l’impasse sociale
Le chômage des jeunes flirte avec les 35 % dans certains quartiers de Nouméa ou zones rurales de la Grande Terre. À Lifou, Maré, Canala, Thio, la situation est encore plus dramatique : pas d’employeurs, pas de formations post-bac, pas de perspectives.
J’ai postulé 19 fois pour un stage dans mon domaine, je n’ai même pas reçu un accusé de réception.
Ici, soit tu connais quelqu’un, soit tu attends des années.
J’ai préféré faire serveuse à Melbourne que tourner en rond à Nouméa.
La réalité est crue. Le réseau prime sur le mérite, la lenteur administrative tue les vocations, et le manque de logements jeunes pousse à la fuite. Résultat : les plus dynamiques s’en vont, souvent sans retour.
L’université saturée, les concours verrouillés
L’UNC ne désemplit pas, mais elle peine à retenir ses meilleurs éléments. Faute de masters locaux, de nombreux étudiants s’exilent dès la L3, voire avant. Et pour ceux qui restent : manque d’enseignants, locaux vétustes, filières saturées.
Les écoles privées ? Inaccessibles pour la majorité des familles modestes. Et même les boursiers se heurtent à un paradoxe : partir coûte cher, mais rester coûte l’avenir.
Les concours administratifs ou territoriaux restent fermés derrière les cloisons opaques des relations politiques, et aucune réforme institutionnelle ne prend à bras le corps la question de l’insertion des jeunes.
Une société bloquée, des élites sourdes
La jeunesse calédonienne souffre d’un mal profond : l’absence de reconnaissance. Trop jeune pour voter aux prochaines élections de 2026 selon le corps électoral figé, trop vieux pour croire aux discours de façade. Les jeunes Kanak, caldoches, asiatiques ou wallisiens vivent le même abandon, chacun dans leur silence.
Alors que la Nouvelle-Calédonie discute de son futur statut, le discours politique sur la jeunesse reste creux, technique, voire inexistant. Aucune proposition sur l’autonomie financière des jeunes, l’apprentissage, le logement social étudiant, les quotas jeunes dans les institutions, ou l’accès élargi aux concours.
Rien. Silence. Absence stratégique. Mépris générationnel.
Une fuite qui affaiblit l’île et fracture les familles
Partir, c’est souvent laisser une mère seule, un grand-père fragile, une culture en suspens. Mais rester, c’est risquer la déprime, l’alcool, la colère sourde. Le dilemme est violent. Et plus de 3 000 jeunes Calédoniens vivent aujourd’hui hors du territoire, souvent sans accompagnement ni suivi.
L’exode des jeunes affaiblit tout le tissu social local : moins de bénévoles, moins de créateurs, moins d’initiatives locales. Il crée une société à deux vitesses, entre ceux qui peuvent partir et ceux qui sont condamnés à rester. Entre ceux qui réussissent ailleurs, et ceux qui vivent ici le sentiment d’avoir raté leur vie à 25 ans.
Les familles, elles, paient le prix : fracture affective, éloignement, sentiment d’injustice. Et les collectivités, pourtant dotées de compétences éducatives et sociales, ne prennent aucune mesure d’urgence.
Ce que le Congrès, le gouvernement ne veulent pas entendre
Les institutions locales se renvoient la balle : le gouvernement parle formation, le Congrès parle réforme, mais sur le terrain, aucune stratégie unifiée, chiffrée, concrète n’a vu le jour.
Les budgets jeunesse stagnent. Les forums sont désertés. Et les promesses se répètent à chaque campagne électorale, sans aucune évolution structurelle.