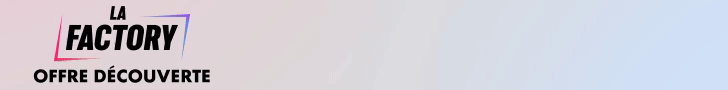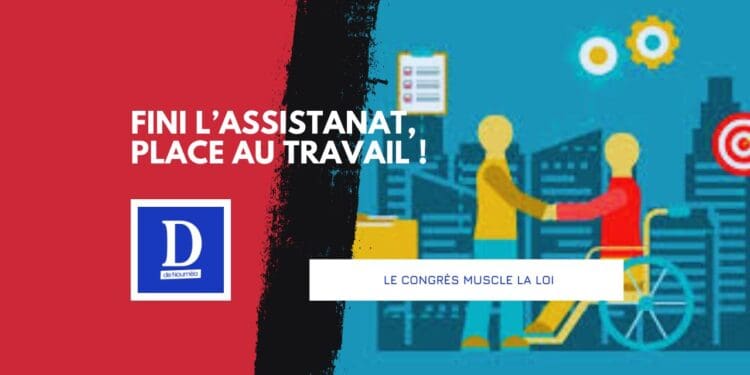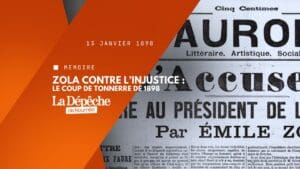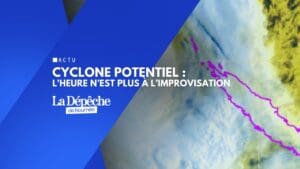Ce jeudi 28 août, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une loi du pays favorisant l’insertion des travailleurs en situation de handicap par le travail intérimaire.
Une mesure pragmatique qui vise à ouvrir les portes de l’emploi plutôt qu’à entretenir la dépendance aux allocations. Dans un territoire où seule une personne handicapée sur quatre a un emploi, l’enjeu est de taille.
Un handicap encore trop synonyme de précarité
En Nouvelle-Calédonie, plus de 10 000 personnes sont reconnues en situation de handicap. Parmi elles, 8 149 adultes sont officiellement recensés par la Commission de reconnaissance du handicap. Pourtant, seuls 600 occupent un emploi rémunéré, la majorité vivant en dessous du seuil de pauvreté. Cette réalité souligne une double peine : la fragilité sociale et la difficulté d’accès à l’emploi.
Les chiffres de l’ISEE sont sans appel : une personne handicapée sur quatre seulement occupe un poste. Les autres se heurtent à des barrières multiples : stigmatisation, absence de dispositifs adaptés, lenteurs administratives. Trop souvent, les entreprises préfèrent payer une contribution financière plutôt que d’embaucher. En 2022, près de 50 % des employeurs ont choisi cette voie commode, alimentant le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées sans offrir de perspectives concrètes.
Face à ce constat, la réforme adoptée change de philosophie : il ne s’agit plus de gérer la pauvreté par des aides, mais de restaurer la dignité par le travail.
Le travail intérimaire comme tremplin vers l’emploi durable
La loi introduit une nouveauté majeure : l’ouverture du recours au travail temporaire pour les travailleurs handicapés. Cette disposition élargit le champ des missions possibles, avec une durée portée jusqu’à 24 mois, contre six auparavant. Une avancée décisive qui répond à deux besoins.
D’abord celui du salarié, qui peut tester un poste, s’adapter progressivement, démontrer ses compétences et bénéficier d’un accompagnement renforcé (ergonome, psychologue, conseiller en insertion). Ensuite celui de l’employeur, qui peut évaluer les aptitudes du travailleur avant de s’engager sur le long terme.
Cette approche réaliste met fin à une logique d’exclusion. Elle propose une passerelle entre la précarité et l’emploi stable. Dans certains cas, les missions d’intérim pourront déboucher sur des CDI. Une manière de réconcilier efficacité économique et justice sociale, loin des discours victimaires.
Une loi du pays qui responsabilise les employeurs
Pour les entreprises de plus de 20 salariés, l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (2,5 % des effectifs) reste inchangée. Mais le texte leur offre désormais une nouvelle modalité pour s’en acquitter : recourir à des contrats d’intérim ciblés. Cette possibilité ne pourra dépasser la moitié du quota exigé, afin d’éviter les abus.
Concrètement, cela signifie qu’une partie de la contribution versée au fonds pourra être remplacée par des missions réelles confiées à des travailleurs handicapés. Un système plus équitable, qui oblige les entreprises à se confronter à la réalité du terrain plutôt qu’à se contenter d’un chèque.
Les bénéfices sont clairs :
-
Pour le salarié, une insertion professionnelle progressive.
-
Pour l’entreprise, un appui technique et financier dans l’adaptation des postes.
-
Pour la société, une réduction de la dépendance aux aides et une valorisation des talents.
Ce dispositif met la Nouvelle-Calédonie en phase avec une logique moderne : aider, oui, mais par le travail. Car la dignité ne vient pas des allocations, mais de l’effort, de la reconnaissance et de l’intégration dans le monde professionnel.
En adoptant ce texte, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie envoie un signal politique fort : celui d’une société qui ne renonce pas à l’intégration des plus fragiles par la voie de l’emploi. Loin d’un modèle d’assistanat, la réforme valorise l’effort, la responsabilité et la solidarité active.
Dans un contexte économique marqué par la crise, ce choix démontre que la réponse sociale ne passe pas par toujours plus de subventions, mais par la mise en mouvement de chaque citoyen. Un pari audacieux, mais nécessaire, pour que le handicap ne soit plus synonyme d’exclusion.