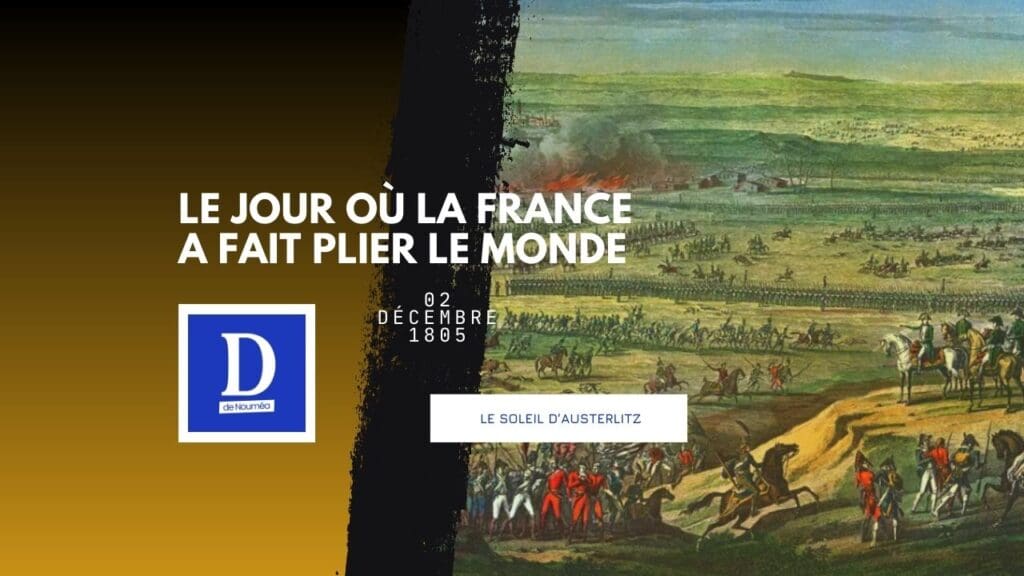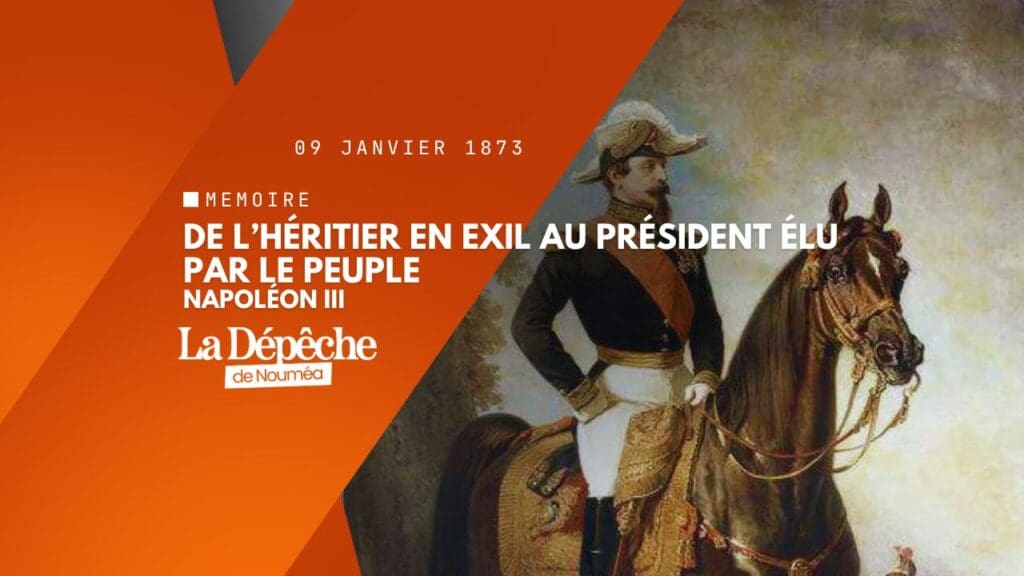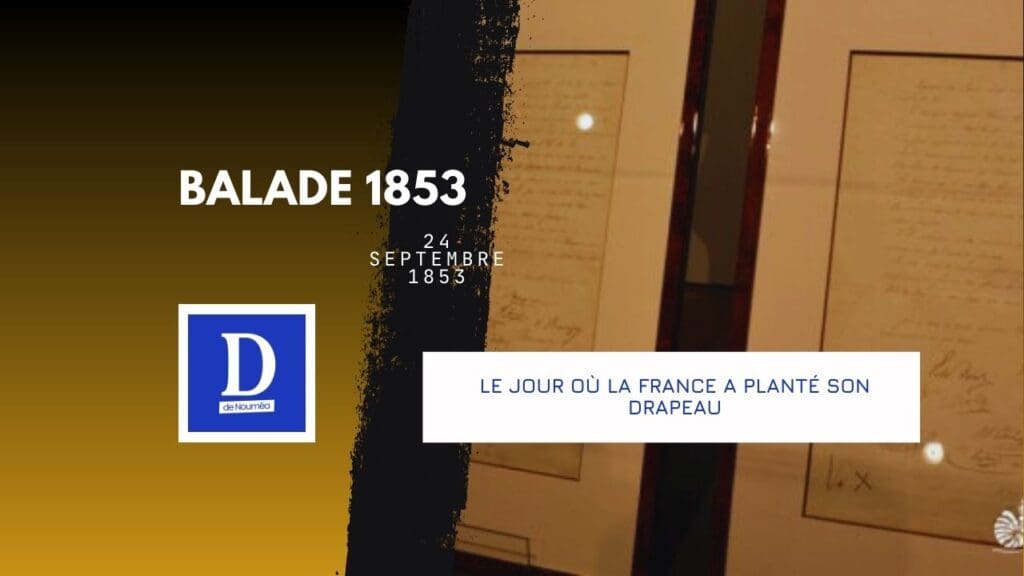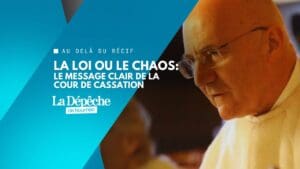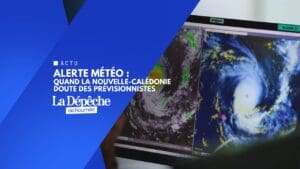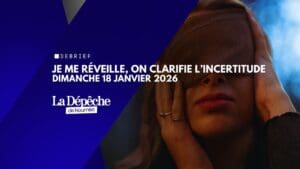Un empire qui s’effondre, une République qui s’impose dans la douleur. Le 4 septembre 1870, Paris se soulève et impose une nouvelle ère politique.
Le 4 septembre 1870 : quand Paris fait tomber l’Empire
La date du 4 septembre 1870 entre dans l’histoire de France comme le symbole d’un basculement brutal. Deux jours plus tôt, à Sedan, l’armée impériale subit une défaite humiliante et Napoléon III tombe prisonnier des troupes prussiennes. L’annonce de la capitulation plonge la capitale dans la fureur. Exaspérés par l’échec militaire et l’incapacité du régime, les Parisiens envahissent le Palais-Bourbon. La foule exige la fin du Second Empire et la proclamation immédiate de la République.
Sous la pression, les députés républicains, dont Léon Gambetta, Jules Favre ou encore Jules Ferry, prennent l’initiative. Le 4 septembre, au balcon de l’Hôtel de Ville, ils proclament la République devant une population exaltée. La France entre alors dans sa Troisième République, au milieu du chaos et de l’incertitude. Ce nouveau pouvoir, baptisé « Gouvernement de la Défense nationale », s’installe alors même que la guerre contre la Prusse continue.
La chute du Second Empire n’est pas seulement l’effondrement d’un régime : elle prouve aussi que la nation française peut se relever par elle-même. Même si les illusions de victoire persistent, le peuple croit encore à un sursaut national. Cette journée du 4 septembre reste gravée comme une affirmation de la souveraineté populaire et de la résistance.
La Troisième République : un régime installé dans la tempête
La République née en 1870 ne trouve pas immédiatement son équilibre. En 1871, la Commune de Paris rappelle que le régime doit composer avec des forces révolutionnaires prêtes à contester son autorité. Pourtant, les institutions se structurent peu à peu. Entre 1870 et 1875, une série de lois constitutionnelles jette les bases de la Troisième République.
Le système repose sur un parlement bicaméral – Chambre des députés et Sénat – et un exécutif bicéphale : un président élu au suffrage indirect et des ministres responsables devant les chambres. Mac Mahon, président monarchiste, incarne une République fragile, tiraillée entre partisans de la monarchie et républicains convaincus. L’adoption du septennat en 1873 illustre un compromis provisoire, destiné à attendre une éventuelle restauration monarchique.
Mais c’est bien le mot « République » qui s’impose dans la Constitution de 1875. Peu à peu, le régime cesse d’être une simple transition pour s’installer durablement. Grâce aux grandes lois républicaines, la France se dote d’une école laïque, gratuite et obligatoire, impulsée par Jules Ferry, ainsi que d’une liberté de la presse qui marque profondément la vie politique.
Au-delà des institutions, la Troisième République forge aussi des symboles toujours vivants : le drapeau tricolore, la Marianne, la Marseillaise, la fête nationale du 14 juillet. Souvent critiquée pour son instabilité, elle demeure pourtant le régime le plus long de l’histoire française après la monarchie capétienne : de 1870 à 1940.
Le 4 septembre, une mémoire républicaine jusqu’à De Gaulle
Le 4 septembre ne s’arrête pas à 1870. En 1958, le général de Gaulle choisit cette date symbolique pour présenter aux Français la nouvelle Constitution qui fonde la Cinquième République. Le choix n’est pas un hasard : de Gaulle s’inscrit dans la continuité d’une histoire républicaine qu’il entend refonder sur des bases solides.
Entouré des gardes républicains, place de la République à Paris, il dévoile un projet qui bouleverse l’équilibre institutionnel hérité de 1875. Le chef de l’État devient l’« arbitre national », placé au-dessus des partis et élu au suffrage universel. Le gouvernement gouverne, et le parlement contrôle sans excès. Pour de Gaulle, il s’agit d’en finir avec les faiblesses de la IVe République, minée par l’instabilité et incapable de répondre à la crise algérienne.
Le référendum du 28 septembre 1958 valide massivement son projet. La France entre alors dans une ère politique nouvelle, qui perdure encore aujourd’hui. En choisissant le 4 septembre, de Gaulle établit un lien clair entre l’acte fondateur de 1870 et la refondation républicaine de 1958.
Aujourd’hui, de nombreuses rues et places du 4-Septembre rappellent cette journée décisive. Elles témoignent qu’au-delà des divisions, le peuple français impose ce jour-là son destin. Le 4 septembre n’est pas seulement un jalon républicain : il incarne la capacité de la France à renaître dans l’épreuve.
Le 4 septembre 1870 fut d’abord une journée de fureur populaire, mais il devient une pierre angulaire de notre histoire politique. La Troisième République s’y enracinera malgré les tempêtes, et de Gaulle lui rendra en 1958 une force symbolique qui inscrit cette date dans la longue mémoire nationale. Dans un monde où les régimes s’effondrent et se succèdent, la France peut être fière d’avoir bâti sa République dans la douleur mais aussi dans la fidélité à son identité.