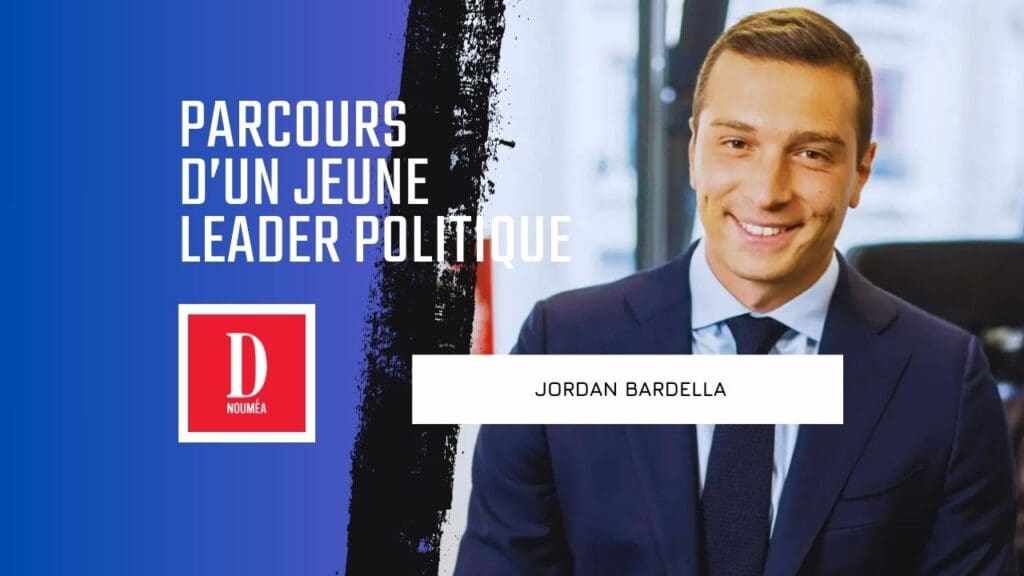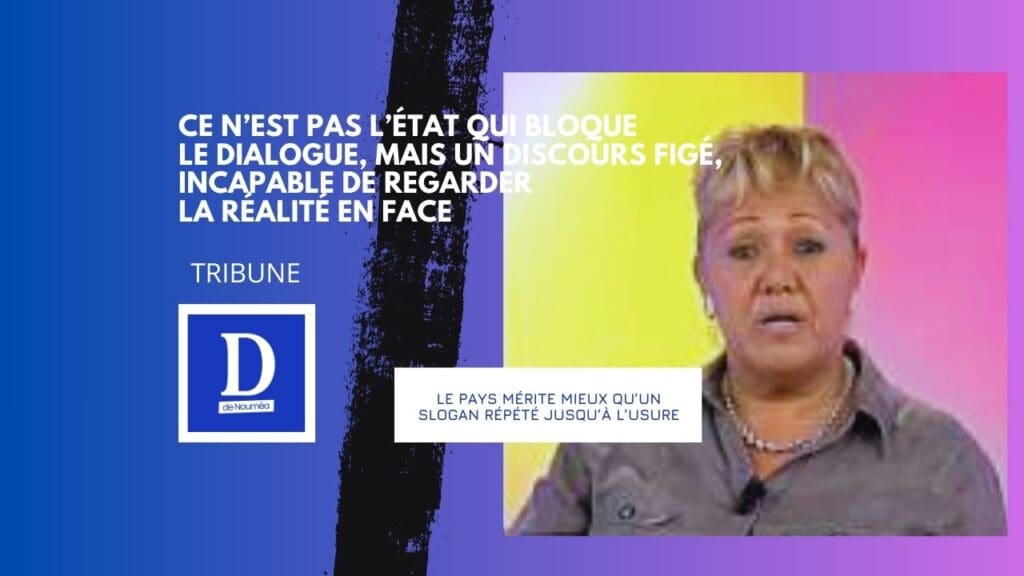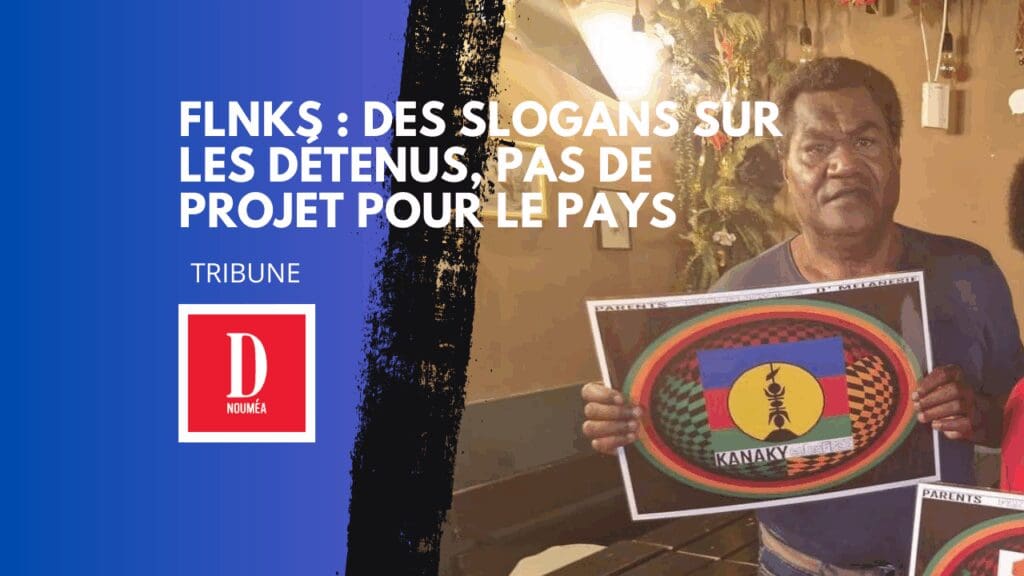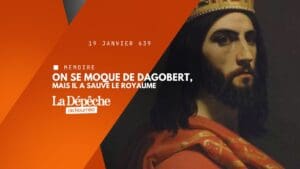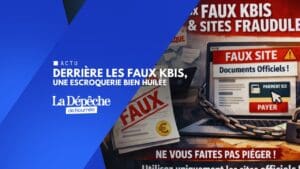Par une plume concernée,
Dans une tribune publiée par Le Monde, l’anthropologue Benoît Trépied estime que l’accord de Bougival, signé en juillet dernier, est déjà voué à l’échec. Selon lui, le rejet du texte par le FLNKS suffirait à condamner le processus. À ses yeux, rien ne peut se construire sans l’aval des indépendantistes.
Mais ce raisonnement oublie une vérité simple : le peuple calédonien a déjà tranché, à trois reprises, contre l’indépendance. Trois référendums, organisés entre 2018 et 2021, ont donné trois fois la même réponse : non. Refuser de prendre en compte ces résultats revient à nier la souveraineté populaire.
Le FLNKS, un acteur central mais pas au-dessus des urnes
Benoît Trépied affirme que le FLNKS est « incontournable ». Personne ne conteste son rôle majeur dans la vie politique calédonienne. Mais être incontournable ne signifie pas être tout-puissant.
Le FLNKS a toujours été présent dans les grandes négociations : aux accords de Matignon en 1988, à l’accord de Nouméa en 1998. Mais dans ces deux cas, les compromis furent bâtis sur un équilibre et non sur une logique de veto.
Aujourd’hui, présenter le FLNKS comme la condition exclusive de tout accord revient à lui donner un droit de blocage illimité. C’est une dérive démocratique. Dans aucun autre territoire de la République, une seule mouvance ne peut imposer son refus à toute la population.
Trois référendums clairs et indiscutables
En 2018, le premier référendum a donné 56,7 % de non à l’indépendance.
En 2020, le deuxième a confirmé ce choix avec 53,3 % de non.
En 2021, le troisième a amplifié l’écart : 96,5 % de non, malgré le boycott du FLNKS.
Trois scrutins, trois fois la même réponse. Ces votes ne sont pas des détails techniques, ils sont l’expression directe de la démocratie. Les relativiser au motif que le FLNKS n’y trouve pas son compte revient à considérer que la voix de la majorité des Calédoniens compte moins que celle d’un mouvement politique.
Des « verrous » ou des garanties indispensables ?
Benoît Trépied décrit Bougival comme un texte hérissé de « verrous ». Il cite la majorité renforcée des deux tiers au Congrès, l’association de l’État à chaque étape, et la consultation finale avec un corps électoral élargi. Mais ce qu’il présente comme des obstacles ne sont, en réalité, que des garanties de stabilité démocratique.
Exiger une majorité large, c’est s’assurer qu’un choix aussi lourd ne soit pas décidé sur un coup de tête. Associer l’État, c’est éviter l’improvisation juridique et financière. Donner la parole à l’ensemble du corps électoral, c’est rappeler que l’avenir d’un territoire appartient à tous, pas seulement à un camp.
Ces garde-fous ne bloquent pas la démocratie : ils l’empêchent de basculer dans l’aventure.
La partition : un risque instrumentalisé
Trépied met en garde contre une partition entre un Sud loyaliste et un Nord indépendantiste. Mais la fracture ne vient pas de ceux qui défendent l’unité de la République. Elle vient de ceux qui refusent d’accepter le verdict des urnes.
Depuis quarante ans, le Sud et le Nord coexistent malgré leurs différences. La République a tenu ensemble ces équilibres, en redistribuant, en investissant, en soutenant les provinces. Agiter la menace de partition, c’est oublier que l’unité de la Nouvelle-Calédonie repose d’abord sur le respect des règles communes. Et la première de ces règles, c’est la démocratie.
Le poids des violences et des refus
Les émeutes de mai 2024 ont laissé une empreinte lourde : 240 milliards de dégâts, 11 000 personnes au chômage, des dizaines d’écoles et d’entreprises détruites. Dans ce contexte, affirmer que le FLNKS devrait disposer d’un droit de veto permanent sur l’avenir institutionnel du territoire est un contresens.
La démocratie ne peut pas s’incliner devant la logique de la rue. Les Calédoniens ont besoin de stabilité, pas d’un chantage permanent.
Des « verrous » ou des garanties indispensables ?
Benoît Trépied dénonce les mécanismes de Bougival comme autant de « verrous » : la nécessité d’une majorité des deux tiers au Congrès, la présence d’un comité de suivi avec l’État, et la validation finale par un référendum au corps électoral élargi. Selon lui, ces conditions rendraient l’indépendance impossible.
Mais ce qu’il décrit comme des obstacles sont en réalité des garanties de stabilité démocratique. Exiger une majorité renforcée, c’est s’assurer qu’une décision aussi lourde ne soit pas prise sur un simple rapport de force ponctuel. Associer l’État, c’est éviter de basculer dans l’improvisation juridique et financière. Élargir le corps électoral, enfin, c’est donner la parole à l’ensemble des citoyens, pas seulement à un cercle restreint.
Ces garde-fous ne verrouillent rien : ils protègent. Ils garantissent que l’avenir du territoire ne basculera pas au gré des pressions, mais dans le cadre clair d’une décision collective et réfléchie.
Respecter le vote, respecter la paix
Les accords de Matignon et de Nouméa ont tenu parce qu’ils reposaient sur un équilibre accepté par tous. Bougival ne doit pas être rejeté d’emblée simplement parce qu’un camp s’y oppose. Le consensus ne naît pas de l’effacement des uns au profit des autres, mais de la reconnaissance mutuelle.
Or reconnaître, c’est aussi accepter les résultats clairs des référendums. La paix civile ne peut pas être garantie si la majorité des citoyens a le sentiment que son choix est nié.
La vérité simple
La tribune de Benoît Trépied oublie l’essentiel : la démocratie repose sur la majorité. La Nouvelle-Calédonie ne peut pas rester prisonnière d’un veto permanent. Trois fois, le peuple a dit non à l’indépendance. Trois fois, il a confirmé sa volonté de rester dans la République française.
Respecter ce choix n’est pas une option. C’est la condition de la stabilité, de la paix et de l’avenir.