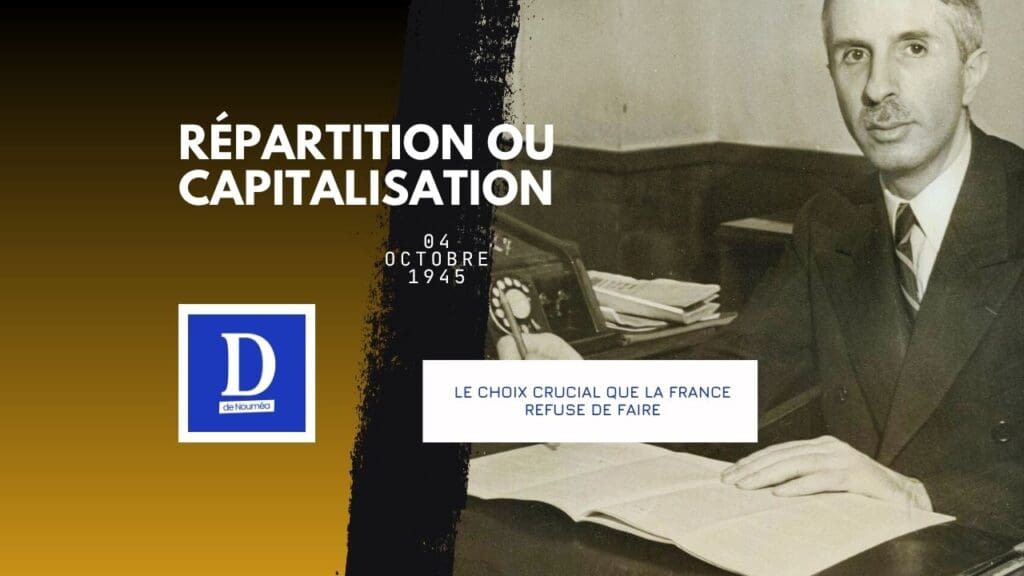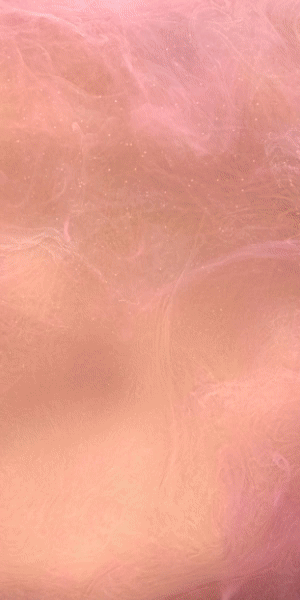Un pays frappé par la terreur rouge. Une armée qui choisit la répression pour sauver l’État d’un chaos annoncé.
Un coup d’État communiste écrasé dans le sang
Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 1965, un groupe d’officiers liés au Parti communiste indonésien (PKI) tente de renverser le pouvoir à Jakarta. Six généraux anticommunistes sont enlevés et assassinés. Le colonel Untung, figure du complot, annonce la création d’un « conseil de la révolution ».
Le président Ahmed Sukarno, au pouvoir depuis l’indépendance de 1945, ne soutient pas ouvertement la tentative. Mais sa proximité avec Pékin et Moscou a nourri la méfiance des militaires conservateurs. Pour eux, le danger est clair : le PKI, l’un des plus puissants partis communistes hors bloc soviétique, cherche à s’imposer dans l’appareil d’État.
Face à ce coup de force, un homme va émerger : le général Mohammed Suharto. Chef des forces stratégiques de réserve, il accuse immédiatement les communistes d’être à l’origine du soulèvement. En quelques heures, il reprend le contrôle de Jakarta, neutralise les insurgés et relègue Sukarno au second plan. Le « mouvement du 30 septembre » est brisé dès le 2 octobre.
Mais pour Suharto, ce n’est que le début. La purge contre les communistes devient implacable.
La purge anticommuniste, fondatrice de l’Indonésie moderne
De 1965 à 1966, l’Indonésie bascule dans une répression sans précédent. Les sympathisants communistes, réels ou supposés, sont arrêtés, exécutés ou envoyés dans des camps. Dans les campagnes, des massacres s’étendent jusqu’en 1969. Les estimations varient entre 600 000 et 1,2 million de morts.
Cette campagne de terreur n’épargne personne : militants syndicaux, intellectuels, paysans, étudiants. Tout individu jugé trop proche de la gauche est suspecté d’être un « rouge ». Les journaux progressistes sont interdits, le PKI est dissous, et les survivants vivent dans la peur d’être dénoncés.
En mars 1966, Sukarno, affaibli et surveillé, est contraint de déléguer ses pouvoirs à Suharto. Deux ans plus tard, celui-ci devient officiellement président. Il lance l’Ordre nouveau, un régime autoritaire où l’armée domine la vie politique. Sa priorité : tourner la page des luttes idéologiques pour se consacrer au développement économique et à l’alignement stratégique avec l’Occident.
L’anticommunisme devient ainsi le socle fondateur de l’Indonésie contemporaine. La purge sanglante, loin d’être condamnée, est présentée comme un acte patriotique.
Une mémoire toujours sous silence
Pendant plus de trois décennies, Suharto impose une propagande implacable : le 30 septembre est enseigné comme la preuve du complot communiste et la répression comme un acte de salut national. Toute contestation est interdite.
Même après la chute de Suharto en 1998, le silence persiste. Les victimes n’ont jamais été réhabilitées, les responsables jamais jugés. En 2023, le président Joko Widodo a reconnu de « graves violations des droits humains », mais sans ouvrir de procès ni offrir de réparations substantielles. Une reconnaissance symbolique, mais pas une justice.
Pourquoi ce déni ? Parce que la légitimité de l’État post-1965 repose encore sur la répression du communisme. Reconnaître un génocide politique, ce serait fragiliser les fondations mêmes de la République indonésienne. De plus, les complicités internationales – notamment celles des puissances occidentales qui craignaient une bascule de l’Indonésie dans le camp soviétique – rendent ce dossier explosif.
Chaque 30 septembre, le pays commémore officiellement la « trahison du PKI ». Les manuels scolaires perpétuent cette version. Les films d’État glorifient l’armée et entretiennent la peur du communisme. Pendant ce temps, des milliers de familles attendent toujours réparation.
Le 30 septembre 1965 reste une date maudite : celle où l’Indonésie a changé de visage au prix d’un million de morts. L’anticommunisme y a servi de ciment national, mais au prix d’une mémoire confisquée.
L’histoire de ce massacre illustre une réalité : lorsqu’un pays se laisse infiltrer par l’idéologie communiste, la réaction peut être d’une violence extrême. Pour Suharto et son camp, il s’agissait de sauver la nation. Pour les victimes, c’était une tragédie sans fin.
Soixante ans plus tard, la plaie reste ouverte. Mais une certitude demeure : sans l’échec du mouvement communiste et la victoire de l’armée, l’Indonésie aurait peut-être sombré dans une dictature rouge, alliée de Pékin et de Moscou. Suharto a imposé un ordre dur, mais il a empêché son pays de devenir un satellite communiste.