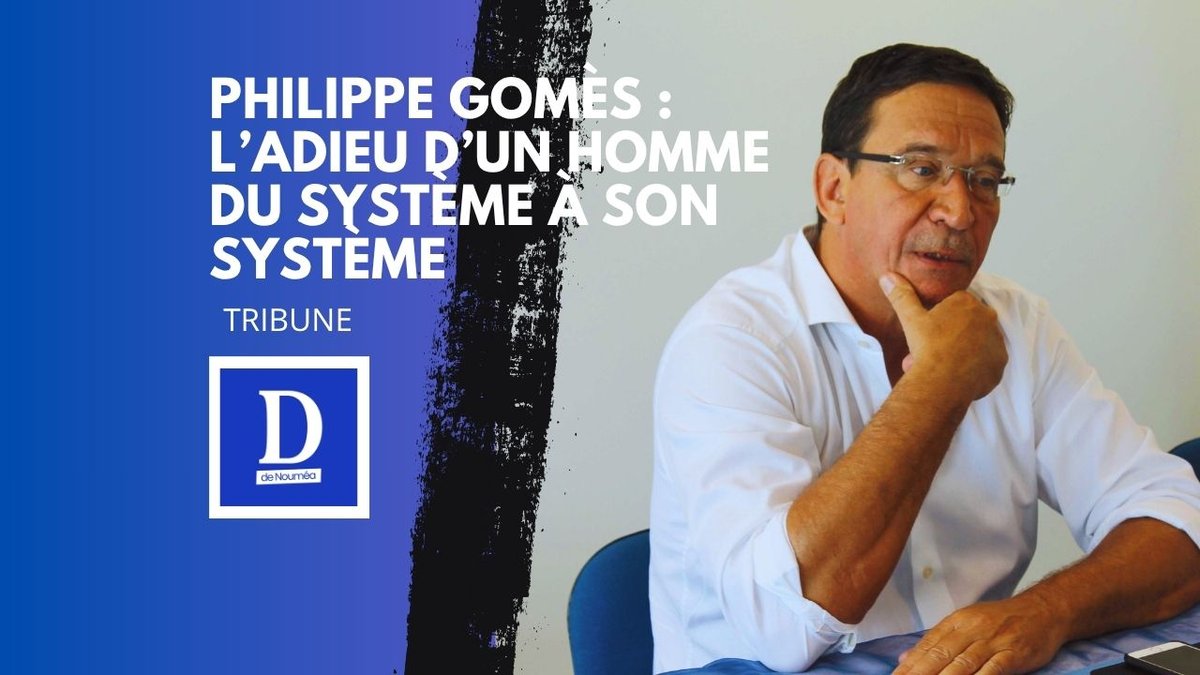Les églises brûlent, la foi vacille

Depuis plus d’un an, les flammes dévorent les symboles du sacré. Et dans l’indifférence générale, c’est la foi des Calédoniens qui vacille.
L’île « la plus proche du paradis » est devenue, selon certains fidèles, « l’île la plus proche de l’enfer ».
Une terre façonnée par l’Évangile
Avant même la colonisation, la Nouvelle-Calédonie était déjà une terre de mission. Au début du XIXe siècle, ce sont les missionnaires protestants de la London Missionary Society (LMS) qui portèrent la foi d’île en île, relayés par des Océaniens eux-mêmes.
En 1840, les premiers évangélistes samoans débarquèrent à l’Île des Pins. Deux ans plus tard, la Société de Marie, catholique, s’installa à Balade, au nord de la Grande Terre. Ainsi, la foi chrétienne avait précédé la colonisation française de treize ans.
À partir de 1853, l’arrivée de la France transforma la mission spirituelle en mission politique. Les Maristes, soutenus par Paris, cherchèrent à encadrer les populations locales. Les protestants, soutenus par les réseaux britanniques, privilégièrent une approche plus libérale et communautaire. De cette dualité naquit un équilibre fragile entre deux traditions : l’une hiérarchique et romaine, l’autre ancrée dans l’autonomie des croyants.
Le XXᵉ siècle vit émerger de grandes figures religieuses : Maurice Leenhardt, missionnaire réformé arrivé en 1902, devint un pionnier du dialogue interculturel. À travers l’éducation, il contribua à la renaissance démographique kanak, après un siècle d’effondrement.
Du renouveau spirituel à la fracture politique
Après la Seconde Guerre mondiale, les missions chrétiennes devinrent le moteur de la montée en puissance des élites locales. Les associations UICALO et AICLF, créées dans les années 1950, réclamèrent l’émancipation des Kanak dans un cadre républicain. C’est grâce à elles que le suffrage universel fut obtenu en 1957. Mais la décennie suivante marqua un tournant : le christianisme devint un levier d’identité politique.
Dans les années 1970, le protestantisme se scinda. L’Église libre, fondée par Raymond Charlemagne, prôna la fidélité à la tradition. L’EENCIL, future Église protestante de Kanaky – Nouvelle-Calédonie (EPKNC), s’engagea, elle, pour l’indépendance.
Sous couvert de foi, le discours théologique se mua en discours nationaliste. En 1979, l’EENCIL prit officiellement position pour l’indépendance, tout en prônant la non-violence.
Cette politisation du spirituel marqua durablement la société calédonienne : certains temples devinrent des tribunes idéologiques plus que des lieux de prière.
À l’inverse, l’Église catholique, plus prudente, resta attachée à la neutralité. Mgr Michel Calvet, ancien archevêque de Nouméa, refusa toute ingérence dans le débat politique, préférant rappeler que :
la foi doit unir, pas diviser.
Mais cette prudence lui valut d’être accusé de complicité avec le statu quo colonial par certains indépendantistes.
Le feu sacré contre le feu de la haine
Aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie compte plus de 80 % de chrétiens : environ 55 % de catholiques, 30 % de protestants et une mosaïque d’autres confessions, évangélistes, mormons, pentecôtistes. Cette majorité écrasante fait du territoire une terre chrétienne au cœur d’un Pacifique largement protestant.
Pourtant, les actes récents montrent une désacralisation inquiétante. Ce qui brûle, au-delà des églises, c’est le ciment spirituel d’une communauté.
Les autorités s’interrogent : ces attaques sont-elles antireligieuses ou politiques ?
Derrière les murs calcinés, certains voient la main de groupuscules nihilistes, d’autres celle d’une jeunesse désœuvrée, sans repères, sans respect du sacré.
Ce qui est certain, c’est que l’État ne peut plus se contenter de condamner. Il doit protéger.
Protéger la foi, c’est protéger la cohésion nationale, dans un archipel où la religion a façonné l’identité, l’école, la paix civile.
Quand la République détourne le regard
La Nouvelle-Calédonie, jadis phare de l’évangélisation océanienne, glisse vers une crise spirituelle et morale. Quand des églises brûlent, ce sont des siècles de mémoire qui s’effacent. Et quand la République détourne le regard, c’est sa propre mission civilisatrice qu’elle trahit.
Il faut dire les choses sans détour : attaquer une église, c’est attaquer la France.
Ces temples, qu’ils soient catholiques, protestants ou mormons, racontent l’histoire d’une Nation qui a bâti des écoles, soigné des peuples, ouvert des horizons. Face à la violence antireligieuse, la République doit réaffirmer la fierté de son héritage chrétien, non par prosélytisme, mais par respect pour ceux qui ont fait de la foi un vecteur d’éducation et de paix.
La France a su bâtir ici un modèle singulier : un christianisme enraciné dans la coutume et un humanisme inspiré de l’Évangile. Le brûler, c’est brûler ce qui, depuis 1840, a donné sens au mot civilisation. Au Mont-Dore, à Nouméa, à Bourail, il ne s’agit plus seulement de reconstruire des murs, mais de rebâtir un idéal.
La foi chrétienne, en Nouvelle-Calédonie, n’est pas un vestige du passé : elle reste le cœur battant d’une identité, d’une histoire et d’une nation.
Et si les églises brûlent aujourd’hui, alors c’est à la République d’allumer de nouveau la flamme du sacré.