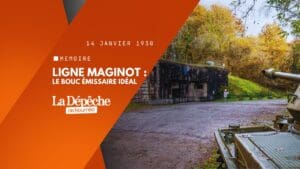Le FLNKS veut financer son rêve politique : une société nouvelle, soutenue par un impôt sur le patrimoine. Mais derrière la théorie de la solidarité, une faille énorme se cache dans la réalité fiscale calédonienne.
LA GRANDE LEÇON DE FISCALITÉ POLITIQUE
À écouter la conférence de presse du FLNKS, on croirait entendre un cours d’économie sociale et solidaire. Les mots sont choisis, le ton professoral : il faut une « réelle réforme fiscale », une « vision cohérente », une « solidarité sur le patrimoine ».
Mais derrière les beaux principes, une réalité s’impose : le projet est inapplicable sur la moitié du pays.
En Nouvelle-Calédonie, près de 28 % du territoire relève du régime coutumier. Ces terres sont inaliénables, insaisissables, imprescriptibles et incommutables. En clair : elles ne peuvent ni être vendues, ni taxées, ni même évaluées fiscalement.
Alors, quand le FLNKS parle d’un impôt sur les patrimoines supérieurs à 100 millions de francs CFP, une question simple s’impose : qui va payer ?
LE FISCALISABLE ET L’INTOUCHABLE
La réponse est limpide : ceux qui ne sont pas sur terres coutumières.
Un particulier propriétaire d’une maison à Nouméa ou un entrepreneur installé à Dumbéa, oui.
Mais un GDPL exploitant des hectares de foncier coutumier, non. Un hôtel tribal sur terre clanique, non plus.
Pourquoi ? Parce que ce patrimoine, aussi prospère soit-il, n’a pas de valeur cadastrale reconnue.
Il n’existe pas aux yeux du fisc.
C’est là toute l’hypocrisie d’un projet présenté comme un effort de « justice sociale ».
La solidarité ne concernerait que les citoyens de droit commun, tandis que les structures coutumières — pourtant souvent dotées d’actifs conséquents — resteraient hors d’atteinte.
Autrement dit, le contribuable européen, wallisien ou métropolitain paiera pour compenser l’exonération coutumière.
UNE JUSTICE FISCALE À GÉOMÉTRIE CULTURELLE
Ce projet, au fond, n’est pas une réforme : c’est une arme politique.
Le FLNKS cherche à opposer symboliquement deux économies, celle du droit commun et celle de la coutume, pour mieux légitimer un modèle séparé — une fiscalité « indépendante » sans en dire le nom.
Mais comment parler d’équité quand un pan entier du territoire échappe à tout impôt ?
Comment prôner la solidarité en fermant la porte à la réciprocité ?
Dans une République, le devoir de contribution est universel.
Or le FLNKS revendique le contraire : une solidarité à sens unique, où la justice fiscale devient un levier idéologique.
Et si les mots “égalité” et “citoyenneté” ont encore un sens, alors cette réforme — soi-disant pour la cohésion — ne fera qu’aggraver les fractures qu’elle prétend corriger.